
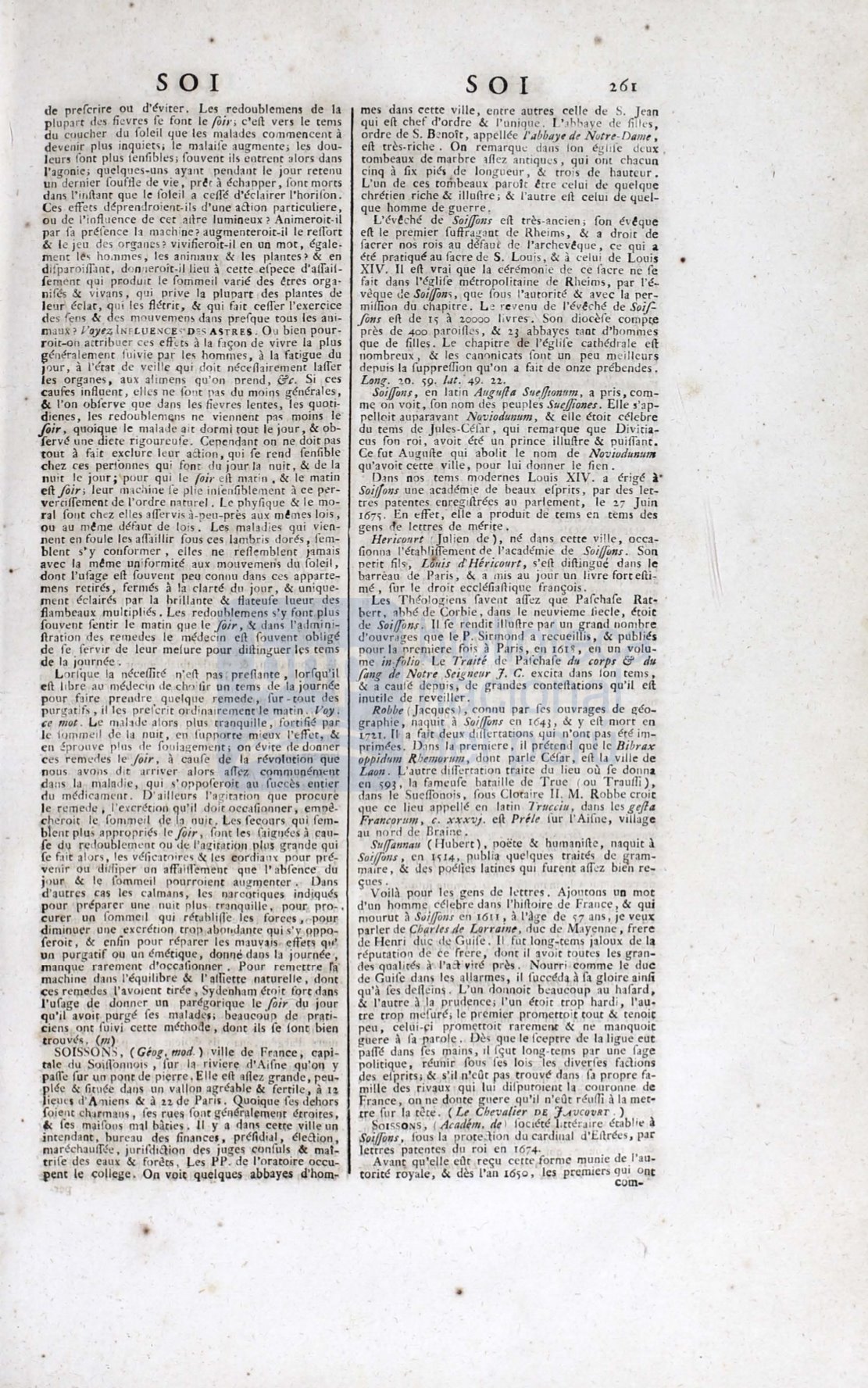
S
O I
de prefcrire ou d'évirer. Les redoublemens de la
p luporr eles ñcvres fe fonr le
(oir;
c'efl vers le rems
ilu coucher du foleil que les malades commencenr
a
devenir plus ioc¡uiet<; le molaiíe augmenre;
lc.s
dou–
Jeurs fonr plus fe nliblcs; fouvenr ils entrene alors dans
l'agonie; quelques-uns ayanr pendanr le jour rcrenu
un
dcrnier fouffl e de vie .
pr~r
a
échopper. fonr mores
d aos l'i11fianr que le íoleil
a
ce{Je d'éclairer l'horiíon.
Ces cffcrs déprendroicnc-ils d'une aélion parciculiere,
ou de l'infl uenre de cec altre lumineux ? Animeroir-il
p ar ía préíence la
m
achine? au(l"menteroir-il le re!rore
&
le jeu des o rganes? viviñerolt-il en un mor, égale–
menr le< homme , les animanx
&
les plantes?
&
en
d1fparoiU:1nt, donnerOÍt-il lieu
a
cette efpece d'afrail–
fe mcnt qui prod01r le íommeil varié des
~tres
orga·
nif6
&
vivans, qui prive la plupart des plantes d.:
leur éclar, q ui les llécrir,
&
qui fa ir ce!rer l'exercice
d es írns
&
des mouvemen; dans prefque rou! les ani–
rnaux? //aytz,lNFLUI!NCI! <"
o qs
ASTR ES .
O u bien pour –
r oir-on acrribuer ces eff:crs
a
la fac:;on de vivre la plus
g énéralemenr fuivie p:l r le< hommes '
a
la fatigue du
JflUr,
a
l'érar de veille qui doir néceOairement laír.:r
les organes, aux alimens qu'on prend,
&c.
Si ces
cauf-es inlluenr, elles ne fo nr pas du moii]S générales ,
&
l'on obíerve que dan¡
l~s
ñevres lentes, les quori–
<fienes, les
redou bl em~:ns
ne viennenr pns ¡noins le
.foir,
quoique le malade
a
ir dormí ¡out le jou r,
&
ob–
fervé une diett> r igoureufe. Cependant on ne doir pas
tour
a
fa
ir cxclure leur aélinn ' qui fe rend fenfible
chez ces per!onncs qui font du jour la nuir,
&
de la
nuir
le
jour; pour qui le
¡óir
ea
marin ,
&
le marin
efl:jóir ;
leur machine fe pl ie inlenliblemenr
a
ce
p~r
verci!remenc de l'ordre nawrel. l e phyfique
&
le mo–
ral íonr chez elles a!rervis a-peu-pres aux m!mes lois,
ou au
m~me
déf.1ur de lois . Les maladies qui vien–
nenr en foule le> afl3illir fous ces b mbris dorés , f"em–
blenr s'
y
conformer , elles ne
reflemblenr ;ama is
avec la
m~me
unifo rmiré aux mouvemens du íoleil,
done l'ufage efl íouvenr peu conuu dans ces apparre–
rnens recirés, fermés
a
la clareé du jour,
&
unique–
rnenr éclairés par la hrílldnte
&
flaceuíe lueur des
fiambeaux h¡ulripl iés. Les redoublemens s'y fonr pl us
fouv~nr
fencir le marin ¡¡ue le
fiir,
&
dans l'admi ni–
flrarion des
ren¡ed~s
le médeci n elt fouvenr obligé
d e fe fervi r de leur mefure pour diltinguer
l~s
cems
de la jou rnéc.
L orfi:1ue la néceflicé n'efl ras preflanre , lorfqu'il
en
l1llre au médecin de cho'!ir un rems de la
journ~e
p our fairc prendre quelque remede, fu r - tour des
purgarif>, il los preferir
ordina~remenc
le mnrin .
1/oy.
~e
mot .
Le
m,1 l:~dc
alors plus rranquille, forriñé par
le lumme1l de la nuir, en l"l1pporce mieux l'effcc,
&
en
~prouve
plus de íoula¡¡-emenc; on évire ele donner
c e
remedes le
joir ,
a
ca ufe de la révolurion que
n ous avons d1t arriver alors
alr~
q-m¡monémenr
d a(IS
la mala,lie , qui s' oppoferoi c
a
u fucd:s enrier
du médi ramenr .
o·
ailleurs
l 'agic~rion
que procuré
le ¡emede , l'excrét101l qu'il doir occalionner, empe–
c heroir le fu¡n¡¡1ei!
le
la oujr , Les feconrs qui fem–
bl enc plus appropriés
le
foir.
fon.r les
(aignée~
:\
e~
n–
fe
dlf
r,cdoublemenc o u
de
l'a!(i¡acion p(us g rande qui
[e f:tir alors, les vélica coires
&
les col'dianx pÓur pré–
vcllir ou ((ílliper un affa1!l"emenc
~ne
1' abfence du
jour
&
le
fommeil pourroient aucm¡enrer . Oans
d'autr!"S cas les
calm~ns,
les nlrcotiques
indjqués
pour prépnrer une nuic plus rranquille, pour pro- ,
curer un fomme1l qui rérabliOe les .
forc~s
, ...
poJ.lrd iminuer une excrérioq rrop
abPild~IJte
qui s'y llPPO–
feroir,
&
enfin pour réparer les mauyais
elfer~
qu'
un p11rgarif ou un émétique, donné
da~s
la journée,
manque raremenr d'occationner • Pour remertre
r~
machine dans l'équilibre
&
1' qflietre narurelle, done
ces re¡;nedes l'avo¡enr tirée, Sydenham éroir (orr daos
l'ufage de donner un parégorique le
flir- du
jour
qu'il
avoi~
purgé fes malade¡; bea ucoup de prari–
ciens onc fu ivi cecrc méchode, done ils fe fonc ,bieo
trouvé~,
((11)
•
·
·
,
SO!SSON!>, (
G~ag,
mad. )
.vijle de France,
o~
pi–
tale du Soiflonnois , fu r
1~ rivier~
d'Aifne ql!'OIJ y
pa(fe (ur un pOnt de pierre. Elle elt anez grande, peu.
pléc
&
firué!!
d~ns
un valla n a¡:réable
&
ferrile '
a
11.
JieUl'S d' h 'lliens
&
a
u
de Pqm . Quoique fes dehors
fqienr
ch,~rmans
, fes
rue~
fo,nt gér¡ilrul"rne'Jt <!Jmites,
f,¡
fes
m~ifons
mal baries .
11
y a <tans certe ville un
inrendaot , bu reau des /inances, préijdid l, éleélion,
maréchau!rée, jurifdiQion
d~s
jug es confuls
&
ma!–
trife de
eaux
&
foret6, j..es PP. de l'oraroire occu–
-!'ent le college . On
voi~ qu~!ques
abbayes d'hom,
SOI
t6l
me_s dans c:rr; ville , entre au tres celle de S. J ean
q01 efl chet d ordre
&
l'u nique. L',thhaye de fi lies ,
ordre de
~·
Benoic , appellée
l'.zbbayt
d~ Notr~-Dume,
ea
tres-nche . On remarque dans Ion églife d<'ux .
romb~aux
de_marbre
~nez
anciques , qui ont chacun
cmq a
fix
p1és .de
longueur,
&
rrois de ha ureur.
L'unde c_es
rom~;>eaux
parolr é rre celu i de quelque
chrénen nche & illuflre; & l'au cre eH celui de que!.
que homme de guerre.
L'év~ché.
de
Soi/Tom
efl
rres-ancien ;
(on
év~que
efl le prem1er fuffrá::ranr de Rhe1ms,
&
a droic de
(acrer
nos rois
a
o défau
de
l'archev~q ue ,
ce qui
a
éré pr-ariqué au facre de
S.
Louis ,
&
a
cel ui de L ouis
X IV.
ll
efl vrai que la cérémonie de ce lacre ne fe
fa ir daos l'églife mécropoliraine de Rheims , par l'é–
veque
<le
SoÍ/Jom,
que fous l'amnricé
&
avec la per–
miflion du chapirre. L
reveno de
l 'év~ché
de
Soif–
flns
efl de
11"
a
2oooo livres-. Son diocefe comp,e
pres de
400
paroiOes ,
&
23 abbayes ranr d'hommes
que de filies. Le chapirre de l'égli(e ca ché.drale cfl
nombreux,
&
les cannnlcars fonr un peo meillcurs
depuis la fuppr
eflion qu'on a fa ir de onze prébendes .
Lollf.
20 .
1"9·
J.tt.·
49.
22.
SoijJo11s ,
en latín
Auguflil S11e/J¡onmn ,
a
p ris , com–
m~
on voir, fon nom des peuples
Sue.lfianes.
Elle s'a p.
pelloir aupaqvanr
N~viadunum,
&
elle éroir célebre
du rems de Jul es-Célar, qui remarque 1JUe D iviria–
cus fon roí, avoir écé un prince illufire
&
pui!ranr.
Ce fue Au"ufle qui abolir le nom de
NoviuduJ:tllfl
qu
'avoircecee ville , pour lui donncr le fi en .
D.msnos rems modernes Louis XIV. a érigé
a•
So
ijfotu
une ncadémie de beaux ef"prics, par des lec.
tres patentes eoreg,flrées au parlemenr,
le
27
Juin
167;.
En tffer: elle a produir de rems en cems des
gens efe lerrres de mérire .
Herico11 rt
r
Ju lien qe ), né dans cene ville, occa–
lionna l'écahlifremenr de l'académie de
Soi(fo11s .
Son
perir fil s·,
Lóuis d' Héricourt ,
s'ert dilling ué dans le
barreau de París ,
&
a
mis au jour un livre forr efii–
mé , fur le droir eccléfi:tf! ique franc:;ois.
Les Théologiens (avene a!rcz que Pafcha fe Rar·
berr, ahbé de Corbie, dans le neuviemc tiecle, écoit
de
Soi/Jonr.
[1
fe reudir illufire par un grand nombre
d'ouvrages que le.P. Sirmond a recuei llis,
&
publiés
pour la premiere foi,<
a
París, en
1618 ,
en un volu–
me
i11:folio .
Le
Traité
de Palchafe
d11 corps
&
diJ
.fm:g de Not>·e Seig ne11r
J.
C.
excita dans Ion tems,
&
a cau fé depuis , de grandes conreHarions qu'il efl:
inurile de reveiller .
Robbe (
J~cq ue
) , connu par fes ouvrages de géo.
graphie, naquir
a
Soi.f[ons
en
164¡,
&
y
efl morr en
1J721.
[1
a fair deu" dtllerrarions qui n'onr pds éré im.
primées. D ans la premiere, il précend que le
Bibrax
pppidflm Rhemomm'
done parle Céfar.
ea
la
V lile
de
Lao11.
¡.:
dutre diírerratiOn traite du lieu ou
(e
donna
en
\"93,
la fa meufe baraille de True
(
ou Tra ufli ),
dans le Suelronois, fous Cloraire 11. M . Robhe croit
que ce lieu appellé en
latín
Tn1~.-iu,
d:tns les
gejla
FraiiC0/"11111 , c.
XJ(XVj.
ea
Pr(le
lur
1'
Aifne, villag e
a
u no'rd de Brai:1e.
.
Suf}rlllnafl
(
1-Tuberc), poece
&
humanifle , naquic
l
Saijjims ,
en
1)14,
Rnbl i~
quelques rraicés de g ram–
ma¡re,
&
¡J~s'
poéties latines qu1 furenr
afrez
bien re–
e:;
u
es.
Voila pour 1es gens de
!~erres
. Ajomons un mot
d'un homme célebre dans l'hifioire de France,
&
qui
mourur :\
Sdijjims
en
1611 ,
i\
l'~ge
de 17 ans, je veux
parler de
(:b(lrles
4e
Larraine ,
rluc de Mayeone , frere
de Henri dtic <le Guife. 11 fur long-rems
j~loux
de la
répucarioo de ce frhe , clone il avoir roures les gran.
des qual irés
a·
l'aél"viré pres . Nourri comme le duc
de Gui fe daos IGs ijllarmes, il
fucc~da
a
fa gloire ainli
qu'a fes
defléin~.
L'un rlonnoic beaucou p au hafard ,
&
l'aurre
a
la prudence; l'un éroi c crop hardi ' l'au–
ue
crop n1dfuré; le premier promerroir tour
&
cenoi~
peu, celui-¡:i pronwrroir raremer>r
&
ne manquoic
guere
i\
fa .r arpfe. D e< que le lceprre de la ligue eut
palré dans fes mains,
,¡
f~ur
long-rems p:tr une fage
politique, réunir fous fes lois
les diverfes fatlioos
des elprics;
&
s' iln'eu r pas rrouvé" daos
(d
propre fa–
Ínille des
rivau~
qui luí difpuroienc la couronne de
Fr3nce, on ne donre guere qu'il n'eOr réuffi
a
lamer–
.í:re fur la rete.
(Le Cheva{ier
DE ].AVCOVRT . )
OISSQNS,
(
Acadim. de l
IOCiété brcéralre érablie
a
""poi,!Jons_,
fous la prore:lion du cardinal d'Eflrées , par
jerrres patentes du ro1 en
1674·
Avanr qu'elle eOr
re~u
cerce forme mu.nie de _l'au–
torité royale,
&
des l'an
1650,
les premJers gm ont
com-
















