
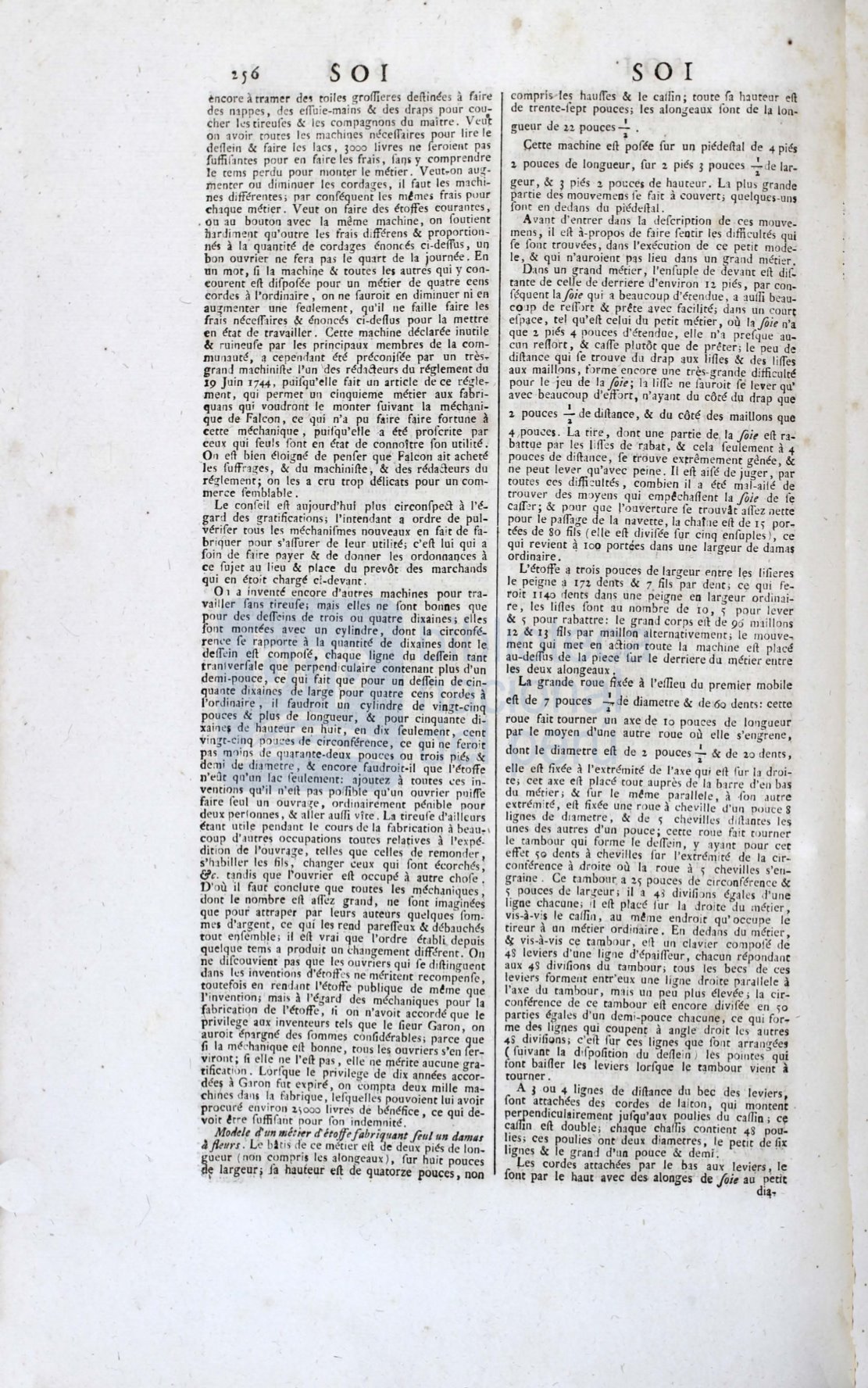
S O I
encare
a
tramer de' toiles gromeres deíl:inées
a
faire
des nappes, des effuie-mains
&
des draps .pour
c~u;
cher ks rircufes
&
les compagnons du manre. Veut
on avoir rnures les machines
n~ceffaires
pour hre le
detlein
&
faire
les
bes, ¡aoo hvres ne fer01ent pas
fuffi fontes pour en fa ire les frAis,
fa~'
y comprentl~e
le rcms perdu pour
mont~r
le mér17r.
Veur.onau
11
1 -
mencer ou diminuer
le~
cordages, 11
f
a ue les mac ,_
nes différences; par conféquent les m.lme• fra1s P"ur
chaque métier . Veur on faire des étojfes eouranres,
. o u au bouton avec la
m~
me machine, on
fou~1ent
hHdime11t qu'our1·e les frais d1fférens
&
_propornon–
nés
a
la quantité de cordages énoncés C!-delfus • En
b on ouvrier ne fe ra pas le quart de la
¡our~ée
·
n
un mor, fi
la machine
&
roures les aurrcs qUJ Ycon–
t:ourent eíl: difpofée pour un mét1er de. quatre <;ens
cardes
1t
l'ordinaire , on ne fauro1t en
uJ.mmue~
m en
augmenrer une feu lement, gu'il ne fa die fa1re les
frai s néceffaires
~
énoncés CJ-detlus pour la '!'eme
en état de trav.ailler . Cene
m~chine
déclarée
mutd~
&
ruineufe par les prir¡cipaux membres de la
co~m unauté,
~
aepenrlant été préconjfée par un tres.
grand machinifle ."un 'des
r~da~eurs
du
régleme.nrdu
19 J uin 174:4, pu1fqu'elle. fa 1t un arncle
de ce ré~le.
.ment, qui permet un Cllll)tlleme méner aux
fabr~quans qui vomlronr
1~
monter fuivanr . la
méch~n'que de Fa!con, ce 'qui . 11'a pu faire
f~~re
forrune
a
cene rJ)échan1qne , pulfqu'elle .a été profcnre. p ar
ccux qui feuls fo nt en érar de connoltre fon ut1l1té.
0•1 etl bien éloigné de penfer
que·
F~lcon
ait acheré
"J~s
l'uffra!{es 1
&
du machinifle,
&
des rédaéteurs du
réglcment
¡
on les a cru trop délicats pour un ·com–
merce femblable .
Le
co~feil
efl anjourd'hul plus circonfpecl
a
l'é–
san l des gratilicarions ; l' intendant a ordre de pul–
vérifer rous les méchanifmes nouveaux en fa1t de fa–
briquer pour s'affurer de leur utiliré; c'efl lui c¡ui a
foin de f>J ire payer
&
de donner les ordonnances
a
ce fuj et au lieu
&
place du prevot des marchands
c¡ui en éroit chargé ci-devant .
O
1
a Ínventé en!!qre d'atJtres machines pour rra–
vail ler fans rireufe ;
m~is
elles ne lonr bonnes que
p our des deffei¡Js de rrois ou quarre dixaines; elles
font montées
~vec
un <?ylindre, dont la circonfé–
·rence fe rapporre
i\
la quanrité de dixaines dont le,
(Jeffeil) ell compole, chaque ligue du deffein
tant
tranlverfale que perpendiculaire contenanr plus d'un
demi-pouce, ce qui fJit que pour un deffein de cin–
quante
~i x~ines d~
large ·pour quatre cens .cardes
a
('ord,nw~
1
11
faudrn1t un
cyhndr~
de v11¡gr-cinq
pouces
&
plus de longueur,
&
pour cinquantc di–
:Xair~eJ
de haureur en h'uir; en dix feulemenr, cent
v ingr-cinq ¡iouees
<k
círconfércnce' ce qui ne feroit
pas
~nins
de
quara~te-deux
pouces oq rrois · piés
&
(:Jenu Je dJantetre ,
&
encare faudroi t·il que l'étoffe
n'<'ut qn'un lac
feulemer~t:
ajourez
~
ronces
~es
in–
ventinns qu'il n'eil pas poflible qu'qri quvrier puirl'e
faire feul un ouvrage , ordinairement
pé~ible
pour
deux perto1mes,
&
aller aufli vire. La tireufe d'a illeurs
~rant
utile pendant le cours de la fabrication ;\ beau.,
coup
u'antre~
occupations toures relarives a l'expé–
dition 'de
l'm¡vr~ge, rell~s
que celles
el~
remoncfer 1
s'habiller les fil s ,' changer ceux qui fonr écorchés '
{ic.,
qridis que l'otivrier eíl: occupé
~
autre chofe ,
p ·ou
,¡
fauc con
el
ure ,que roures les
ll]éc~~niques ,
i.lont le J?Ombre eíl:
atlc~
grand, ne fonr
1magi~ées
c¡ue pour amaper par leurs aurellrs qudques íom.
mes
d~argent'
ce quí les
r~od
pareffeux
&
débauchés
t our eqfemll!e; 11 efl
~ra1
que l'ordre
érabl~ depois
quelque tems a
pr!JdUI~
un !:hangement différent . On
ne difcouvíenr· pas que les ouvriers qui fe diíl:iqguenr
dans les invenrioi1s d'étolres ne méritenr recoinpenfe
t~ute.fois
en
rend~nt,
l'étoffe publique de
m~me qu~
Jmvennon; ma1s a 1égard des méchamques pour la
(abriqiiqn de l'étoffe , Ji on n'avoit accordé que le
privilege aux invenreurs tels que le lieur Garon , on
auro1t !!pugné des fommes conf.dérables; paree que
li
la méchamque eíl: bonne, rous les ouvriers s'en fer–
v.ironr ¡
ft
elle ne l'eil pas, .elle ne ,Périre aucune gra–
tJficar¿nn . Lorfque le priVIIe!?e de dix années accor–
flé~¡
a
G:~ron ft~t
e• piré, on ctlll]pta deux mille ma–
chines dans la fd lmque,
lef~ uelles
pouvoient lui avoir
procuré
en v~ron ~\OOO
livres dé bénéfice, ce qui dé-
voit
~tre
fuffi fa nt rour fon indemnicé.
.
Motl•~e
á'
un
lfJétMr
t!'h~ffe
fabriqu,.nt
fiul un
d4mlu
.l
flettrs .
Le bltis ele ce méner eíl: lle delix piés de
Ion~
¡¡ueur ( non compris les alongeaux ), fur huir pouces
~r lar~eur
¡
J~ h~uí~ur e~
de quatorze pouces, non
S O I
comprí
les haufres
&
le caffin; roure
(a
haut~ur
ell
de trente-fepr pouces; les alongeaux fonr de la lon-
gueur de
2.2
pouces -; .
(:;erre machine efl ·pofée fur un piédeflal de 4 piés
2.
pouces de longueur, fur
~
piés 3 ¡wuces -;de lar–
geur ,
&
~
piés
2
pot:ces de hau teur. La plus grande
partie des mouvemeos fe fai t
a
couvert; quelques-un,
fon t en ,dedans du
pléd~íl::ll.
.
.
·
Avant d'enrrer dans la defcnpnon de ces mouve•
mens
1
il eíl: a-propos de fai!e feotir les ddljculrés qui
fe fonr rrouvées, dans l'exécurion de ce peti t mode"
le,
&
qui n'auroienr pas lieu dans un gr:¡nd métier.
Dans un granJ métier , l'enfup le de devanr eil dif.
tante de celle de derriere d'environ
n
piés, par con.
f~quent
lafoie
qui a beaucoup d'érendue, a :mfli beau–
coup de
refi~ Jrt
&
pr~te
avec faci líté; dd lls un court
efNce, te! qu'efl celui du petit métier, oq la
foie
n'a
que
2
piés 4 pouces d'étendue, elle n'a prefque au–
cun retlort,
&
cafre plutqt que de prérer; le peu de
diflance qui fe trouve du drap
~ux
litles
&
eles liffes
aux mail lons , forme
encare
une
tr~s-grande
difficulré
pour Ie1eu de la
J!.ie;
!1
l iff~
ne fa uroit fe lever qu'
avec beaucou p d'e¡l:ort
1
n'ayanr du coté d\1 drap que
2.
pouces
7
de
di~ance'
&
du
cot~
des maillons que
4 ,pouces. La tire , donr une parrie de, la
(oi~
eíl: ra–
battqe par les litles de r.abar'
&
cela feulement
a
4
pouces de diíl:ance, fe t'rduve
ex~remement
genée,
&
ne peut lever qu'avec peine. ll el¡ ai(é de ¡uger, par
toutes ces dif!icultés , combien il a été mal-ailé de
trouver des moyens qui
cmp~chatlenr
la
fole
de
f~
calfer;
&
pour que l'ou verture fe trouv!t atl'ez nette
pour le paft1ge de la
n~verre,
la ch:1lne efl de 1; por,
rées de So lils (elle eíl: divilée fqr cinq ·enfuples ), ce
qui reviene
~
1oQ portees d,ans ur¡e
l~rgeur
de damas
ordinaire.
·
,
L'étoffe
~
troís pouces de largeur
Pnrr~ l~s
lifi eres
le peigne
~ 1 7~
dents
&
7.
fil s par dent;
e~
qu i fe–
roir 1140 denrs daq> une peigne en largeur ordinai–
re, les li(Jes fon t au nombre de
10 ,
;
pqur lever
& ;
pour ral!attre: le
gra~d
corps e1l: de
96
maill ons
1~
&
13
fll s par f11aillol) alrernqtivement; le mouve.
ment qui met en acti<?n ronre la
m~chine
eíl: placé
au-defl'us de la
piec~
!.ur
le derriere du ''létier entre
les deux alongeaux
La grande roue AKée
a
l'emeu du premler mobile
eíl: de
7
pouces
-!.de
diamerre
&
de
6o
denrs: cerre
•
roue fait tourner un axe de
l o
pouces qe longueur
par le moyen d'une autre roue o
u
elle s'engrene,
dont le diamerre eíl: de
2
pouces
7
&
de
~o
denrs,
elle efl lixée
a
l'extrémité de l'axe qui efl {u r la droi–
te; cet axe efl placé tour aupre5 de la qarre d'en bas
du mérier ;
&
fu r le
m~
me parallel e,
i\
·fon au rre
e.xtrémité' efl fixée un¡; roue
a
chevi lle d'un
pou~e ~
hgnes de d1amerre,
&
de ;
c~evillcs
diflanres les
unes des aurres d'un p\)uce ; cene roue fa it rourner
le rambour qui forme le defl'ein, y ayanr pour cet
effet
)G
dents
a
chevilles fo r l'extrémité de la
Cir~
conférence a .droite ou la roue
a
í
chevill es s'eu–
grau~e
. Ce tambour. a
~~
pouces de
c~rconférence
&
í.
pouces de laril'eur; il a
4:>
divifions égales d'une
hgne chacline; 11 efl placé lur la droire du rnérier,
vis-a-vis le camn , au
rn~me
endroir qu' occupe
le
tireur
a
un mérier ordiriaire . En dedans du mérier,
&
vis-a-vis e; Ul]lbnur, efl un clavier compoli!
de
48 leviers d'une ligne d'épaiffeur, chacun répondant
aux
~S
di vifions du rambour; rous
les bees de ces
levíers forment entr'eux une ligne
droit~
parallele
a
l'axe Ju tambour, niais un peu plus élevée; la cir–
conférence de ce tambour eíl: encare dívifée en ¡o
parti~s
égales d' un demi-pouce
chacun~,
ce qui
for~
'
me des lig!)es q[Ji coupen¡
a
angle droi r les- autres
-4S dJvJfiQns ; c'ell fur ces lignes que
fo,~t ~rrangée!
(
f~1vanc
la d,fpofition du deflein ) lés pointes qui
font baifler les leviers lorfque
1~
qmbour vient
a
ro~rqer .
A l .ou 4 lignes de dillanee du bec des · Ieviers ,
font atmch'ées des cordes de lairon' qui montent
perpendiculairement jufqu'au• poulies du caflio ;
e~
caífin e{l: double ; ·chaque cliaffis contiene 48 pou–
lies; ces poulies. ont deux diametres ' le petir de fix
ligue~
&
le grand d'un pouce
&
demí:
·
·
~es
cordes attachées par le
~ls
aux
levi~rs
1
le
Ú>nt par le haut avec des, alonges
de
foi~
au perlt
di~·
















