
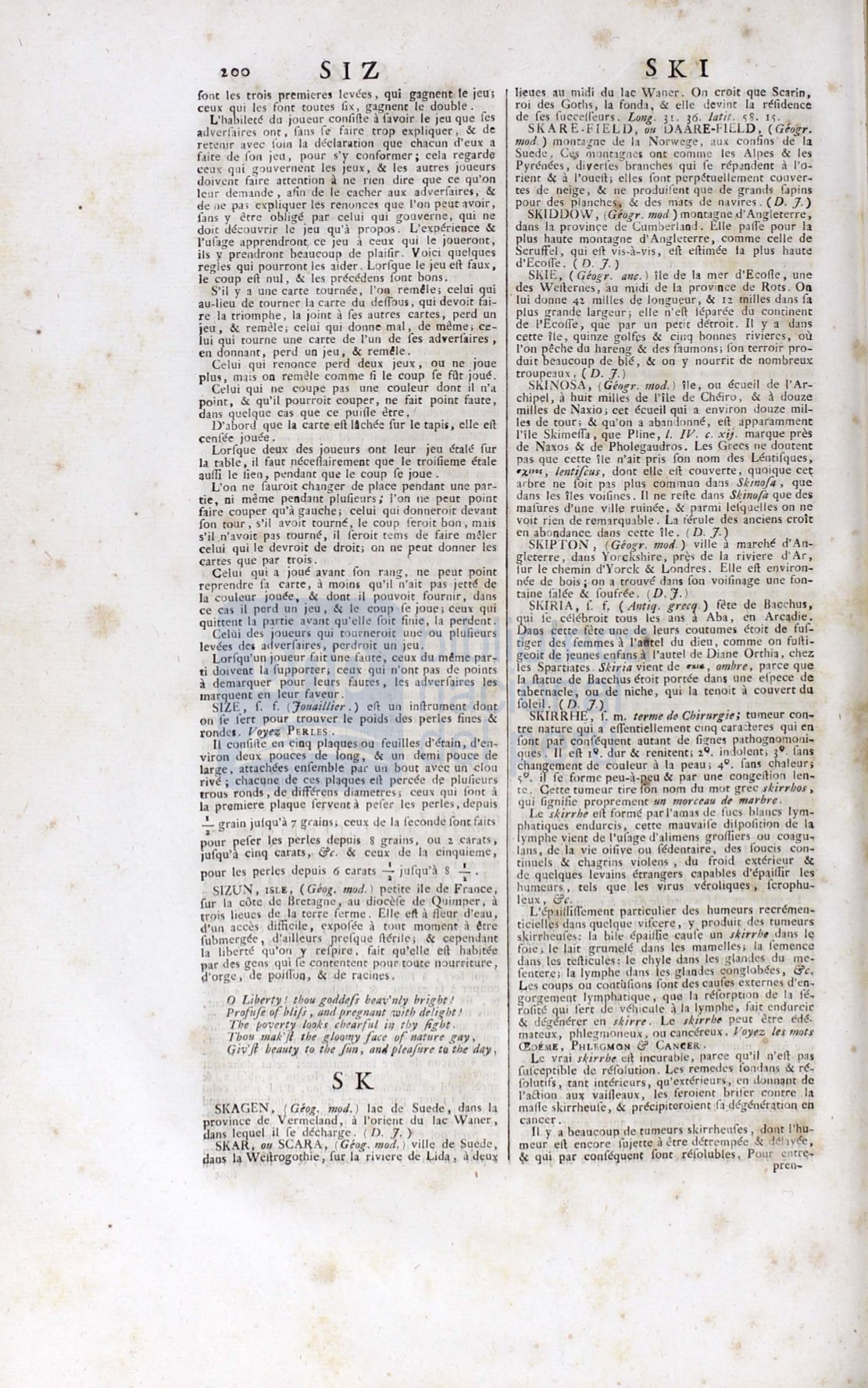
1.00
SI Z
[ont les trois premieres levées, qui gagnent le jeu ;
ceux qui les fo nt touces
Gx,
gagnenc le double.
L'habilecé du joueur conlifte
a
fa voir le jeu que fes
adverlaires onc, fans fe
faire trop expliquer ,
&
de
ret~1ur
avec !oin la
di!clar~rion
que chacun d'eux a
fdite de fon jeu, rour
s'y
conformer ; cela regardc
ceux qui gauvernent les ¡eux,
&
les aurres joueurs
doivcnr faire actencion
a
ne rien dire que ce qu'on
lenr demande, afin de le cacher aux ad verfaires,
&
de
nc pa> cxpliquer les renunces que l'on peL¡t
avoir,
fans y erre obligé par celui qui gouverne , qui ne
doic Uécouvrir le jeu
<J.U'a
propos . L'expérience
&
l'u fage apprendronc, ce ¡eu a ceux qui le joueront,
ils
y
prendronc beaucou¡> de plailir. Voici quelqucs
r egles qui pourront les aider . Lqrfgue le jeu eft fau x ,
le coup eft nul ,
&
les précédens
[une
bons.
S' il y a une caree tournée, l'on
rem~le;
celui qui
au-lieu de rourner la caree du delfous , qui devoir fai–
r e la criomphe , la joint
a
fes
a
ueres carees, perd un
jeu'
&
remele; celui qui donne mal ' de meme; ce–
!ui qui rourne une carre de l' un de fes adved iires ,
en donnanc , perd un jeu,
&
rem~le.
Celui qui renonce perd deux jeux, ou ne joue
· plus, mais on remete comme
{i
le coup fe fílt joué .
C~l ui
qui ne coupe pas une couleur done il n'a
poi
m,
&
qu'il pourroit couper, ne fai t poim fa uce,
dans quelque aas que ce puille erre, '
D 'abon.l que la carte eft lkhée fur le capis, elle eft
cenfée jouéa .
Lorfque deux des joueurs ont leur
jeu étalé fur
la
tal>!
e, il faut néoellairement que le croifieme étale
aulli le fien, p.endant que le coup fe joue .
L'on ne fauroit changer de place pendant une par–
tie, ni meme pendanc plufieurs; l'on
ne
peuc poinr
fairc couper qu'a ¡l'U llche; celui qui donneroit devam
fo n cour, s'il avo1t tourné, le coup feroi t bon, mais
s'il n'avoit pas tt>urné, il feroir ccms de faire
m~ler
celui qui le
devroi~
de droit; on ne peut donner les
carees que par tro1s .
C elui qui a jpué avant fon
rang, ne pe ue point
reprendre
f~
caree,
a
moins qu'il n'ai t pas jené de
),¡
couleur ¡ouée ,
&
done
il pouvoic fournir, dans
ce cas il pard un jeu,
&
le coup fe joue ; ceu• qui
quiccent
la
parcie av1nc qu'clle foic tinie, la perdent.
Celil i des joueurs qui touPneroit uue ou plulieurs
levées dc1 anverfaires, pcrdroit un jeu.
Lorfqu'un joueur fait une fa ute, ceux du
m~me par~
ti doivent la fupporter; ceux qui n'ont pas de points
a
demarquer pour leurs fauces '
les udverfaires les
marquen
e
eu leur favcur .
SIZE ,
f.
f. (
Jouailli•r . )
eli un inftrument dont
on
le lert pour trouver le poids des ¡>erles fines
&
r ondes .
VQJe;_
P ERLES.
ll
con!ifle en cinq plaques ou feuilles d'érain , d'en–
viron deux pouces de long ,
&
un demi pouce de
I.arge , anachées enfemble par un bour avcc un -clou
rivé; chacl¡ue de ces
pl~ques
e11 percée de plufieurs
trous ronds, de dilférens
diame~res;
ceux qui fnnt
a
la promiere plaque fervent
a
pefer les perles' depu is
7
g rain juíqu'a
7
graios;
ceu~
<le la feconde fonc fdits
pour pefer \,es perles depuis
8
g raius, ou
2
cnrats ,
jufqu'a cinq caraes,
&c.
&
ceux de
la
cinquieme,
P
our les perles depuis
6
carats
~
jufqu'a
8 ..!... •
'
1
S!ZUN, ISLE, (
Géog. mod.)
perite ile
d~
F rance ,
[ur
la c3te de Brecagne,
a
u diocefe de O uimper ,
ii
trois lieues de la terre ferme. Elle eJh\ R'eur d'eau,
d'un acces diflicile ' expofée
a
tollt
moment
a
trre
fubmergée
1
d'ai lleurs prefque lléril e;
&
cependanc
la
liberté qu'o
n yrefpira, fait qu'elle ell habitée
par des gens
q~
i.feconcententpour co ute nourriture ,
d'orge, de ¡¡olÍloo ,
&
de racu1es.
O
L iberf.)l! tbou goddifs boav'nly brigbt!
Proji':fl ofbtij.S, tmd preg/Jfmt 1v'itb d.tiubt !
Tbe povert'l look! chearful il; tby /igbt .
71!o" mak:ft tlu g loanJ.y focc of 11at11re g ay,
(jn/Jl
b~auty
to the fim,
mul
pleajitre ta tbe
dny,
SK
SKAGEN, (
G;og. mod. )
lac de Suede 1 , dans
13
p rovince de Vermeland ,
a
l'orienc du
lac .W aner,
,Jan$ lequel
il
fe décharge . (
D.
J .
)
r
SKAR ,
011
SCA~A,
(G¿og. mod. )
ville de Sucde,
ijaos
1~
W el)rogo.¡hie' [ur la
ri~Jere
de 1,-idq '
~
'di¡'U:{
SKI
lleues au midi du lac vVaner. On croit que Scarin
roi des Gochs, la fonda,
&
elle devine la
rélidenc~
de
[es
fuc<'e!leu rs.
Lo11g.
3
r.
36.
/o
ti
t .
58. 15.
SKA R E.FIE LD ,
ou
üAARE-f ! LD ,
( G¿ogr.
mod. )
montagnc de la
1
orwege, aux con!ins de la
Suede, Ce¡; moncagncs onc comme
les Alpes
&
les
Pyrénées, diverles branches qui fe répJndent a l'o–
rienr
&
a
l'ouell; elles fon t pcrpécuellement couver–
res de neige ,
&
ne produifenc que de grands fapi ns
pour des planches ,
&
des ma ts de navireL
(D .
J.)
SI\ IDDOW,
(G¿ogr. mod )
moncao-ne
,J'
Angleterre,
dans la province de Cuml>er!aad. file palfe pour la
plus haute momagne d' Anglecerre , comme cell e de
Scrulfel , qui cft vis-a-vis , efi efiimée la plus haute
d' Ecorre. (
o.
J.
)
Sl{IE, (
(jéog·r.
o>lo. )
ile de la mer d'Ecolle , une
• des Weilernes,
a
u midi de la prov10ce de Rors . On
tui donne
42
mil les
d~ longu~ur,
&
12
milies dans fa
plus g rande largenr
¡
ell e n'eft !i!parée du conrinent
de I'Ecofle , que par un petic décroit.
Il
y
a dans
cen e !le , quinze
golf~s
&
ciuq
bonnes riviercs, ou
l'on pEche du harencr
&
des f.1umons; Ion cerroir pro–
duit bcaucoup de blé,
&
on
y
nourric de nombreux
troupeaux ,
(D. ] .
)
SKI~OS.I\,
(
Géogr. mod. )
ile, o u écueil de
1'
Ar–
chip~l ,
a huir milles de l'ile de Chéiro,
&
~
douze
milies de
1
axio; C?et écueil qui a environ douze mil–
les de tour ;
&
qu'on
a
ab3ndonné, eft apparammenc
l'ile Skimelfa, que Pline,
t.
I V.
c. x;j.
marque pres
de
1
axos
&
de Pholegaudros. Les Gre<'s ne doucent
pas que cette ile n'ait pris fon nom eles Lémifques ,
';t"" ,
lmti./Cu!,
done elle eft couverte, quoique
ce~
arl>re ne foir pas plus aoénmun dans
Skinofo
,
que
dans les !les voilincs.
Il
ne refle dans
Ski11o(a
qoe des
mafures d'une vil le r uinée'
&
ra rmi lelquell es on ne
voit rien de remarquable. La feru le
des
anciens croit
en abondance dnns cene 11e.
( D .
J. ~
SKIPTO!
,
( Géour . moti. )
ville a marché d'An–
gleterre, dans
Yore~shire,
pres de la riviere d' Ar,
lur le chemin d'Yorck
&
Londres. Elle eft environ–
née de l>ois ; on a trouvé dans fon voiíinage une fon–
taine fa lée
&
foufrée.
( D .
J.)
SK!R IA,
C
f, (
Autiq. g recq. )
fe¡e de Bacchus,
qui !e célébroit cous lc::s ans a Aba, en
Arc~die .
Dao~ ~:ette
fete une de
l~urs
coucumes étoit de fu f–
ciger des femmes a l'a!ltel du dieu , comme on fufl i–
geoic de jeunes enfans
a
l'aucel de D iane Orrhia, che¡;
les Spaniates .
Skiria
viene de ,.,. ,
ombre,
paree que
la
ft~tue
de Bacchus écoit ponée dans une efpece de
rabernacle , ou de piche, qui la renoit
~
co uven du
foleil.
(D.
J. )
SKIRR HJ;,
f. m.
terme de Cbirurgie ;
tu meur con–
ere nacure qui a elfemiellemenc c1nq caratleres qui en
fo nt par conféquent aucant de liz nes pathognomoni–
ques.
11
eft rll. dur
&
renitent; 2o. in olenc;
3°.
fa ns
chaqgement de couleur
a
la
peau;
4°.
fans chaleur ;
5° .
il fe forme peu-a-peu
&
par une congeftion len–
ce. Cette cumeur tire
(o n
nom du moc grec
•·1.-ir,.,bo•· ,
gui íignilie propremenr
1111
morceau tfe 11/tZrbre.
Le
skirrbe
eil formé par !'amas de
fu
es blancs lym–
phatiques endurcis, cene mauvai(e dilpoiirion de la
lyrnphe viene de l'uf.1ge d'alimens grolliers ou coagu,
lans, de la vie oi{ive ou fédenrai re, des foucis con–
rinuels
&
chagrins violens , du
froid
e¡¡térieur
&
de q4elques levains écrangers capahles
d'ép~illir
les
l]umeurs, cels que les virus
véroliqu~s ,
fcrophu–
l ~ ux ,
&c.
L'épai!lilfemenc particulier des humeurs recrémen–
ticielles dans quclque vi(cere, y produit des rumeurs
s~irPheufes:
[a bile épaillie ca
uf~
un
1kirrh1
.dans le
(oie; le lait grume_lé dans les mamelles; la Jemence
dans los cellicules: le oh
y
le dans les glanrics du mc–
fencere; la lymphe dans les glandes conglol>ées,
&c.
Les coups ou contiJlions font des caufes excernes d'en,
gorgemeqt lynwhatique, que la réforpti n de la le,
rolité qui lert de véhicule
1i
la lymphe, fait endurcir
&
dégénérer en
1kirre .
Le
1kirrhe-
peu t erre
édé–
maceux, phlegmoneux, ou cancéreux .
Voyez
lts
mots
O!:¡;>~ME,
PHr.EGMON
&
CANC!ER.
Le vrai
1J;irrhe
elt incurable, paree qu'i l n'el1 pas
fnkeptible de réfolucion . Les remedes fondans
&
ré–
(olu~ifs,
cant incérienrs, qu'excérieurs,
.e!l
donna
m
de
l'aa1011 aux vailleaux, les fer01ent bnl er conere la
malle si irrheu(e,
&
précipiteroient f-1
dégénér~ti011
en
cancer .
r
.
Il
y a beaucoup de cumeurs skirrhenfes, dont l'hu–
meur efi encore íj¡jerte
ii
erre détrempée
&
dél1yée ,
~
q<li P'!r conféquenr fonc réfolubles , Pour emrt;-.
pren-
















