
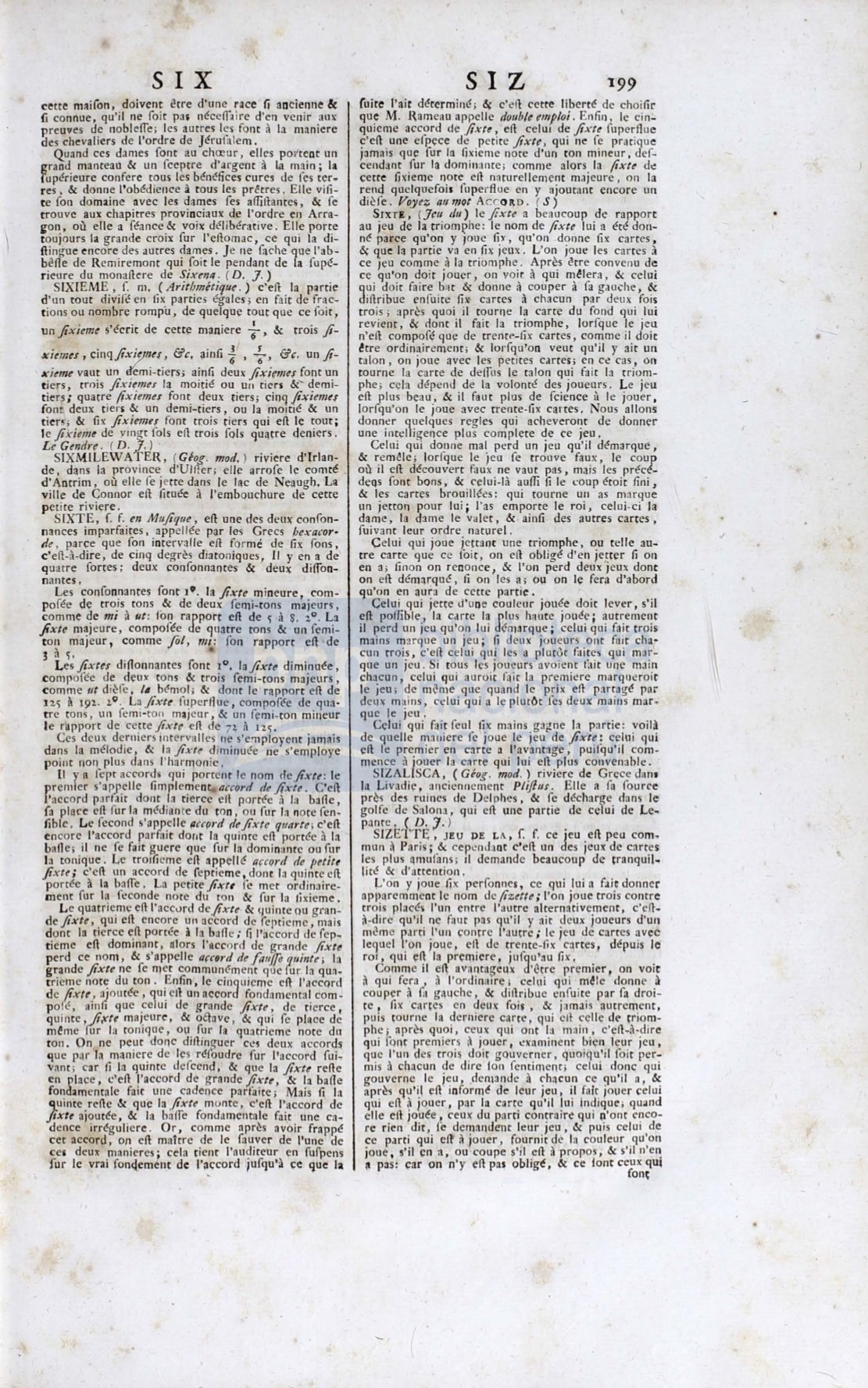
SI X
cette
m~ifon,
doivent <!ere d'une race
li
ancienne
&
fi
connue, qu'il ne foit pas néceflaire d'en venir aux
preuves de nobleíre; les autres les font
a
la maniere
des chevaliers de l'ordre de Jéru!"alem.
Quand ces dames font au choour , elles po¡lcent un
grand manceau
&
un fccpcre d'argene
a
la
main; la
fupérieure confere tous les bénéfices cures de fes ter.
res ,
&
denne l'obédience
a
tous les
pr~tres .
Elle vi!i–
te fon domaine avec les dames fes amllanees'
&
fe
crouvc aux chapitres provinciaux de l'ordre err .A,rra–
gon, ou elle a féance
&
voix délibérative . Elle porte
toujours la grande croix fu r
l'el~omac,
ce qui la di–
fiingue encore des aocres dames. J e ne [ache que l'ab–
bí!fle de Remiremon¡ qui foit le pendant de la
fup~rieure du monallcre de
Sixenq .
1
D.
J. )
SIX!EME,
f.
m, (
11rit/Jmétir¡ue. )
c'ell la parrie
d'un tour divile en lix parcies égales; en fait de frac–
t ions ou nombre romp"u, de quelque tour que ce foi t
1
un
jix icme
s'écrir de <;ette
mani~re
T,
&
trois
ji-
xiemu, <;inq.fixi;;ne¡ , &e,
ainfi
t ,
+•
&c.
un
fi–
x ieme
vaut un {emi-tiers; ainli deux
fixirme¡
font un
tiers, crois
jixtrmes
la moi¡ié o u un tiers
&'
demi–
tiers; qua¡re
(ixiemes
font deux fiers; citJq
Ji.xiemt<
font deux ¡iers
&
un demi-tiers, ou la moltlé
&
un
tien;
&
fix
jixieme¡
font q;ois ¡iers qui efl le tOUt;
le
Ji.xie¡n~
de yingt fols ell crois
[qls
qu~tre
<lenic:rs ,
Le
Gendrr.
( D.¡.
J
S!XM!LEW.A,
fE~,
1
Glog. mod, )
riviere d'Irlan–
de, dans la province d'Ui tfer; elle arrofe le comté .
d' .A.ntrim , oii elle
te
jette dans le
l~c
de
N~"ug~.
La
ville de Connor eft
lituée
a
l'en¡bqucnure de cene
petite riviere .
S!XTE, f. f.
en Mttjiq11e,
ell une des den)( confon–
nances imparfai¡es, appellée par les Grecs
{lcxa,·or·
de'
paree que ron intervalle ell formé de fi x fons'
c'ell-a-dire , de cinq
d~gres
diatoniques,
11
y
en a de
quatre forres; deux confonnaotes
&
deul( diíron–
nantc=s ,
Les cor¡fonnantes (ont
1'.
la
fixte
mipeure
1
com–
po(ée
de
trois tons
&
de deux fen¡r-tons majeurs,
comme de
mi
a
ut:
1on
rappoq ell de
1'
a
~ .
2
°.
La
fixte
ma¡eure, compofée de quacre tons
&
un femi–
tO~I
majeur
1
comme
fol,
"'1.'
fon rapport eil: de
3 a \' •
Les
Jjxte¡
ditlonnantes font
~
0
•
la./ixte
dimi.nuée,
compofée de deux tons
&
trot$ fern i-tons ma¡eurs,
comme
11t
diHe,
/11
bémol;
&
done le' rapport ell de
12.\'
11
l92·
~o . L~
jixte
f~perflue ,
compo(ée de qua·
tre tons, un fem•-ton ma¡eur ,
&
un femi .tol1 mineur
le r'apport de cette
jixt~
ell de
72
a
12;.
Ces deux derniers imervalles ne s'employent
jam~is
dans la mélodie,
&
la
fixte
diminuée ne s'employe
point noQ plus dans l'harmonie ,
11
y
p
fept accords qui portene le nom ele
fixte:
lt:
premier s'appelle fimpl emen
accord de
fixte.
Oel\
l'accord parfair done la tierce el! portée
a
la bafle
fa place ell fu r la médiante du ton , ou (ur la no¡e fen:
fible. Le fecond s'appelle
pccprd r/efixte q111¡rte;
c'ell
encore l'accord parfait done la quince en portéc
a
la
ba(Je ; il ne
(e
fait g uere que fur la dominante ou (ur
la tonique . Le troiiieme ell appeil é
l{fcord (le
petite
jixte ;
e'e(! un accord de J eptieme, donr la quince ell
poreée
a
1~
baíre. La pem e
jiJ(tt
fe mee ordinaire–
ment fur la feconde note du ton
&
(ur la lixieme.
L e quatrie_me ell l'aec<Jni
de.(ixte
&
quince QUgt•an–
de
jixte ,
qut eil: eneore un accord de feptieme mais
done la tierce ell portée
a
la bafie;
(j
l'accord
d~
fep–
ti~me
ell: do¡ninant , lflors l'accord de grande
jixt~
perd ce nOI)l,
&
s'appelle
OfC9nl
de
fau¡p
quinte;
la
grande
.fixte
ne fe met communémem que (ur. la qun.
crieme note du ton . Entin, le cinquieme ell l'accqrd
de
fixte!
ajoutée,
qu~ ~~~un
act'ord fo nda mental com–
pol é, amfi que .celut de grande
fixte,
de tierce ,
quince,
/i¡rte
ma¡eure ,
&
oétave,
&
qu i
(e
place de
m
eme !Úr la tont<¡tte,
o~
fur la quatrieme note du
ron . On ne peut doqc dillinguer
c~s
deux
accord~
que p•ll'
1~
maniere de
l~s
réfoudre fur l'accord fui"
va
m ;
car li la quince
d~fcenll,
&
que la
fixte
re!le
en place , c'ell !'aecord de g rande
.(!xte,
&
la bafle
fondamene~le
fair une cadence Parfaite ; l\1ais fi la
c¡_uin'te
_rell~
&
qui! la
.fixte
monte, c'ell l'accord de
jtxte
a¡ourée ,
&
la baíre fondamenrale fai.t une ca–
dence irréguliere . Or, comme aprés avoir
fr~ppé
cet accord, on ell maitre de le fauver
de
!'une de
ce& deux manieres; cela ¡iene l'audireur
~n
fufPens
fur le vrai fonqemént de
l'~_ccord
jufc¡u'a ce que la
SI Z
199
(uire l'air déterminé ;
6¡
c'ell cerre liberté de choiiir
que
M.
Rameau appelle
doub/e
emploi .
Enfin , le cin–
quieme
a~cgrd
de
fixte,
ell celu1 de
jixte
fuperf!ue
c'etl une el pece de petice
fixtr,
qui ne fe pratique
¡amais que fur la lixieme note d'un ton mineur ' def–
cend:¡nt fur
1~
domin;tnte; comme alors la
jixte
dt:
cecee C,xien¡e note ell narurellement maj eure, on la
ren<l quelquefois fuperflue en
y
ajoucant encare un
di
efe .
Voyez
qtnnot
AcCOfi.D. ( S)
SJXTi,
(]rll
du)
le
jixte
a beaucou p de rapport
au jeu de la trioml?he : le nom de
jixte
lui
a
été don–
né paree qu'on y ¡ouc fir, qu'on -donne fix carees,
6>
que la partie va en
lix
jeux. L'on jou
e
les carees
a
ce ¡eu con1me
~ la
triomphe . Apres l!rre convenu
de
ce qu'on doir jouer
1
on voit
a
qui
m~lera ,
&
celui
qui doir fai re bat
&
donne " cou per
a
fa gauche'
&
dillribue enfuite fi x carees
a
chacun par deux fois
rrois ;
apr~s
quoi il tour11e
1~
caree du fond qui lui
reviene,
&
done il fait la triomphe, lorfque le jeu
n'ell compofll que de trentP-!ix carees, comme il doit
~tre
ordil)airement;
&
lorfqu'on veut qu'i l
y
ai t un
talan, on joue avec les petites carees; en cecas , on
rourne la caree de de{fus le talon qui fai t la triom–
phe; cda dépentl de la volonté des joueurs . Le jeu
ell plus beau,
&
il fau t plus de fcience
ii
le jouer,
lorfqu'on le joue
avec
rrente-fi x qnes , Nous allons
donner quelques regles qui acl¡everont de donner
une
i nt~lliger¡ce
plus complete de ce jeu .
Celui qui donne mal perd un jeu qu'il démarque,
&
rem~le ;
lorfque le jcu fe trouve fau x, le cou p
ou il ell découvere faux ne vau t pas, mais les précé–
d¡;qs (ont bons '
&
celui.lii aum
ti
le coup étoit
fini,
&
les
cart~s brouill~cs;
qui rQurne u11 as marque
1111
jettor1 pour luí¡ l'as emparre le roí, celui-ci la
dame, la di!me le va let,
&
ai nfi des
a
utres carees ,
fuivane leur ordre naturel .
C elui qui joue je¡caQt une triomphe , ou telle au–
tre caree que ce loi¡ , on ell obligé d'en ¡e,tter
(i
on
en a; finon o n reoonce,
&
l'on perd deux jeux done
on ell démarqué, fi on les a;
o~
on le fera d'abord
c¡u'on en aura de cen e pareic.
<;elui qui jecre cl'ul)e couleur jouée doit lever,
s'il
ell poffible, la caree la plus haute jouée
¡
aucrement
il perd un jeu qu'on luí démarque ; celui qui fai t trois
rnains marque un jeu;
li
tlenx joueurs onc fu ir eha¡
cun trois, c'ell celui qni les a plurot faites qui rnar–
que un jeu . Si rous les joueurs avoient táit U11e m3in
chacun
1
celui qui auroir
f~it
la premiere marqueroit
le jeu; de
m~n¡e
que qua nd le prix ell pareagé par
deq~
mai ns, celui qui
a
le plutót fes (leux mains mar .
que le jeu,
Celui q\li fai¡ feul iix mains gilgne la parrie: voila
de quelle mauiere fe joue le ¡eu de
jixte:
celui c¡ui
ell le premier en caree
a
l'avantage, puilqu'il com–
mence
a
jouer la caree qui lu í ell plus convenable.
S!ZAU SCA, (
Géog.
mod.
l
riviere de Gr.;ce dan•
la Livadie
1
ilqcienncment
Plijf11s .
j::lle
a
fa fource
pre~
des ruines de D elphes,
&
(e
déc~arge
dans le
gol fe de Salona, qui ell 11ne partie de celui de Le.
pante, (
D .
J. )
SlZElTE;,
Jl!u
pi!
u ,
f.
f. ceJ'eu eil peu com.
rnun
~
París ;
&
cependaot c'ell un es jeux de carees
les plus amulans;
il
demande beau;:oup de tranquil–
lité
&
d'anention ,
!.:on
y
joue
Í¡x
perfonnes , ce qui luí a fain donner
appqreniment le nom de
{tzette;
l'on joue trois com re
trois placés l'un entre l'autre alternativeq¡ent, c'efi.
~-dire
qu'il ne faut pas qu'il
y
ait c{eux joueurs d'un
ml!me puri l'un con¡re l'autre; le jeu de can es avcc
lequel l'on joqe, eil de
~reme-fix
cqrres
1
dépuis le
ro•, qt¡i el\ la premiere , jufqu•au iix,
·
Comme
il
e(\ avaqta¡l'éux d'etre premier
1
on voit
~
qui fera '
a
l'ordinam~;
cel\ti qu i
m~le
donne
a
cou per
a
fa g:¡uche'
&
dillribue
~n(uite
par fa droi–
¡e, fix cartes en
d~ux
fois ,
&
jamais ªu crement,
puis ¡ourne la derniere carre, qui ell celle. de ¡riom–
phe
¡
apres quoi, ceux qui onr la main, c'ell,it-dire
qui ront premierS
~
jouer
1
<!Xaminent biell
~~Ur
jeu
1
que l'un des trOÍ$ doit gouverner, quoiqu•il loit per–
mis
a
chaoun de dire Ion fentiQtent; celui done qui
gouverne le jeu, .den¡ande
i\
chacun ce qu'il
a,
&
apres qu'i\ ell
inform~
de leu r jeu, il fair jouer celui
qui ell
~
jouer, par la caree qu''(l lui (ndicjue;
qu~nd
elle ell jouée , ceux du partí contrairc qu i n'on t enca–
re ríen 'die ,
!e
d~maqdf!(lt
leur jeu,
&
pt¡is celui de
ce parti qui efl
~
jouer , fournit de la coQieur qu'on
joue , s'il
~n
a , ou ·coupe s'i'l ell
ii
pr-opos,
&
s'il
n'e~
;t
pas:
~ar
on
n'Y
ell pas obligé,
&
ce lont ceux qu1
font
.-
















