
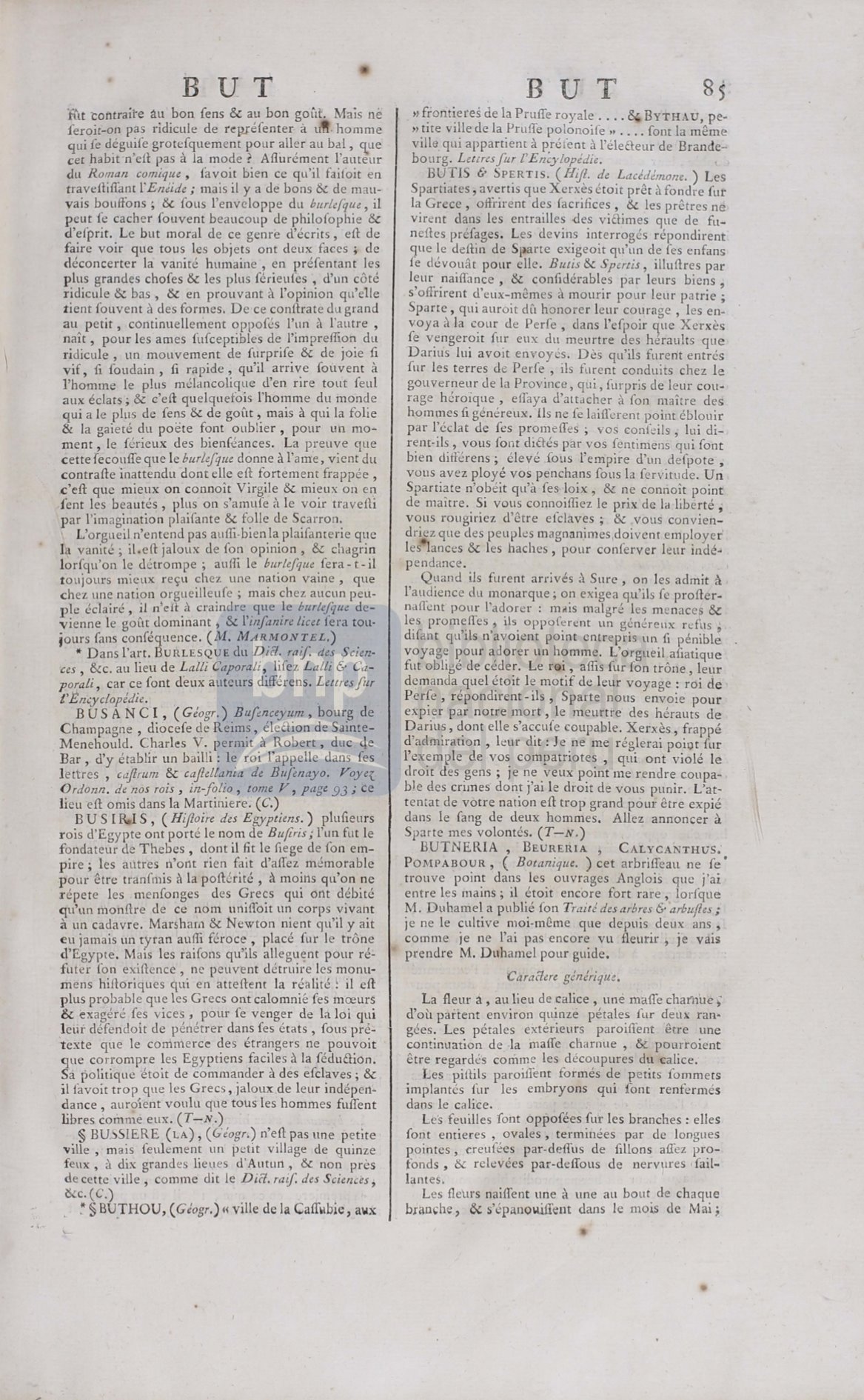
BUT
R'tt
tofitraíl·e áu bon feos
&
au bon goi1t. Mais
ne
Íeroic-on pas ridicule de l'ep.réfenter
a
u
homme
qui
{e
déguife grotefquement pour aller au bal , que
cet
habit n'eít pas
a
la mode
?
Afiurément l'auteur
du
Roman comique,
favoit bien ce qu'il faifoit en
traveíl:iífanr
l'Enéide;
mais
it y a de bons
&
de
mau–
vais bouffons ;
&
fous l'envcloppe du
burle(que,
il
peut fe cacher fouvent beaucoup de philofophie
&
d'efprit. Le but moral de ce genre d'écrits, eíl: de
faire voir que tous les objets ont deux faces ; de
déconcerter la vaniré humaine , en préfentant les
plus
grand~s
chofes
&
les plus férieufes ' d'un coté
ridicule
&
bas'
&
en prouvant
a
l'opinion qu'elle
tient fouvent
a
des formes. De ce confirate du grand
au petit ' continuellement oppofés l'un
a
l'autre '
nait, pour les ames fufceptibles de l'
impreill.ondu
ridicule , un mouvement de {urprife
&
de joie fi
vif
fi foudain' fi rapide' qu'il arrive fouvent
a
l'h~mme
le plus mélancolique d'en rire tout feul
aux éclats;
&
c'efi quelquefois l'homme du monde
qui a le plus de feos
&
de goí'tt ; mais
a
qui la folie
&
la gaieté du poete font oublier , pour un mo–
ment, le férieux des bienf-éances. La preuve que
cette feconífe que le
burlefque
donne
a
l'ame' vient du
contrafie inattendu dont elle efi fortement frapp ée ,
c'eíl: que mieux on connoit Virgile
&
mieux on en
fent les beautés ' plus on s'amufe
a
le voir travefii
par l'imagination plaifante
&
folle de Scarron.
L'orgueil n'entend pas auffi-bienla plaifamerie que
1
vaniré; il.efr jaloux de fon opinion,
&
chagrin
lorfqu'on le détrompe ; auHi le
burlefque
fera-
t-
il
toujours mienx res:n chez une nation vaine , que
chez une nation orgueilleufe ; mais chez aucun peu–
ple
édairé,
}l
n~efi:
.a
craindre, .que
~e
h.urlefque
de–
víenne le gottt dommant,
&
1
mfanzre hcet
fera tou–
jours fans conféquence.
(M.
MARMONTEL,)
*
Dans l'art. BuRLESQUE du
Dia. raif. des S
cien~
ces
&c. a
u
lieu de
Lalli Caporali,
lifez
Lalli
&
Ca–
por~li,
car ce font deux auteurs différens.
Lettres fur
i,Encyclopédie.
,
BU
S
A
N
C I, (
Géogr.) Bufenceyum,
bourg de
Champacrne , diocefe de Reims, éleél:ion de Sainte–
Meneho~ld.
Charles
V.
permit
a
Robert, duc qe
Bar, d'y érablir un bailli : le roi l'appelle dans fes
l ettres ,
cajlrum
&
caflellania de Eu{enayo. Yoyez
Ordonn. de nos rois, in-folio, tome
V,
page
93;
ce
lieu eft omis dans la Martiniere.
(C.)
BU
S
1 I
S , (
Hijloire des Egyptiens.
)
pluíieurs
rois d'Egypte ont porté le nom de
Bufiris;
l'un fut le
fondateur de Thebes, dont il fit le íiege de fon em–
pire; les autres n'ortt rien fait d'alfez mémorable
pour etre tranfmis
a
la poftérité '
a
moins qu'on ne
répete les menfonges des Grecs qúi oñt débité
qu'un monfi:re de ce nom uniífoit un corps yivant
a
un cadavre. Marsham
&
Newton nient qu'il
y
ait
eu
jamais un tyran auffi féroce , placé fur le trone
d'Egyp te. Mais les raifons qu'ils alleguent pour ré–
futer fon exifrence , ne peuvent détruire les monn·
mens hi.fioriques qui en atteftent la réalité
~
il eíl:
plus probable que les Grecs ont calomnié fes mreurg
&
exagéré fes
vices
,
pour fe venger de la loi
qui
leur défendoit de pénétrer dans fes érats , fous pré·
texte que le commerce des étrangers ne pouvoit
<¡ue corrompre les Egyptiens faciles
a
la féduél:ion.
Sa politique étoit de commander
a
des efclaves;
&
il favoit trop qLte les Grecs, jaloux de leur indépeñ·
dance , auro'ient voulu que tous les hommes fuifent
libres comme eux.
(T-N.)
§BU
SIERE (LA),(Géogn)n'efrpasune petite
ville , mais feul ment un p tit village de quinze
feux,
a
dix grandes lieues d'Auturt,
&
non pres
de
cette ille, comme dit le
Dill.
raif. des Sciencés,
&c.(C.)
.
~
§
BUJHOU, (
Géogr.)
H
ville
de
la
Caífkibie,
a~,tx
BUT
H
~ro ~eres
de la Pruífe royale . . . .
BYTHAu,
pe~
>>
ute Ille de la Pruífe polonoife, .... fonr la meme
ville qui appartienr
a
prétent
a
1
éleél:eur de Brande–
bourg.
Leur sfur L'Enéylopédie.
Bt..!TlS
&
SP~RTI
. (
Flijl.
~e
_LacédJmone.)
Les
Spart1ates, averns que Xerxes eto1t prer
a
fondre fur
la Grece , offrirent des facrifices ,
&
les pretres ne
virent daos les entrailles
<les
viél:imes que de fu–
nefies pr 'fages. Les devins interrogés répondirent
que le deítin de Sparre exigeoit qu'un de fes enfans
fe dévouat pour elle.
Butis
&
Spertis,
illufires par
leur naiífance ,
&
coníidérables par leurs biens
'
Lr.
•
d'
1\
).
•
'
s
orrnrent . eux-:nemes
a
mounr pour leur patrie;
Sparre,
qm
aur01t dí\ honorer leur courage , les en.
voya
a
la cour de Perfe, daos l'efpoir que Xerxes
fe v.enger?it fu.r eux
du
meurtre des heraults que
Danus lm avo1t envoy 's. Des qu'ils furent entrés
fnr les terres de Perfe , ils furent conduits chez le
gou
ver~e~r
de la Provine;, qui, furpris de leur cou–
rage h roique ' effaya
d
attacher
a
fon ma1cre des
homwes fi généreux. Ils ne fe laiít rent point éblouir
par l'éclat de
Ji
s
prome!fes ; os confeils
lui
di–
rent-ils, vous font diétés par vos fentimens qui font
bien différens; élevé fous l'ernpire d un defpote ,.
vous avez ployé vos penchans fous
la
fervitude.
Un
Spartiate n'obéit qu'a fes loix,
&
ne connoit point
de maitre ..
~i
vod;t; conn_,..oi
1
ffiez le prix de
la
liberté ,
vous rougmez etre e1c aves ;
&
vous convien–
dri!z que des peuples magnanimes ,doivent .employer
les lances
&
les haches, pour conferver leur indé..
pendance.
Qnand ils furent arrivés
a
Snre , on
les
admit
a
l'au_dience du monarque; on exigea qu'ils fe profrér–
naílent pour
l'a~orer
: mús malgré les menaces
&
l~s prom~.ífes
,;
1ls_
oppof~rent
un générenx r f\ts
>
d1fant qu Ils n avOient pomt entrepris
un
fi.
pénible
voyag~ ~our ~dorer
un h?mme. L'orgueil afiatique
fut obhge de ceder. Le
ro1,
affis fur fon tróne leur
d~manda
,quel
~teit
17
motif
de
leur voyage: ;oi
de
Per~e,
repondtrent -1ls ,
S
parte nous envoie pour
exp1er par notre mort, le meurtre des hérauts de
J:?ariu~, ~ont
elle s'ac.cufe coupable. Xet·xes, frappé
d admrrat10n, leur d1t: Je ne me réolerai poiot fur
l'exemple de vos compatriotes ,
ql~i
ont violé le
droir des .gens ; je
~;
_veux P?int me rendre coupa–
ble cles cnmes doqt
J
a1le dro1t de vous punir.
L'at~
tentat de votre nation eíl: trop grand pour etre expié
dans le fang de deux hommes. Allez annoncer
a
Sparte mes volontés.
(T-N.)
,
BUTNERIA ,
BEURERIA ,
CALYCANTHus:
PoMPABOUR, (
Botanique.
)
cet arbriffeau ne fe'
trouve point dans les ouvrages Anglois que
j'ai
entre les mains;
il
étoit encore fort rare , lorfque
M. Dnhamel a publié fon
Traité des arbres
&
arbujles;
je ne le cultive moi-meme que depuis deux ans ,
comme je ne l'ai pas encore
vu
fleurir ,
je
vais
prendre
M.
Duhamel pour guide.
Caraélere générique.
La fleur
á,
au lieu de calice, uné maife
chal"'n'ue~
d'o1t paiient enviren quinze pétales
fur
deux ran•
gées. Les pétales extérieurs paroiífent erre
une
continuation de la maífe charnue ,
&
pou.rtoient
etre regardés comme les découpures du calice.
Les piitils paroiífent formés de p-etits fommers
implantés fur les embryons qui fonr renfermés
daos le calice.
Les feuilles íont oppofées fur les branches : elles
font entieres , ovales , terminées
par
de longues
pointes, creufées par-cleífus de fillons aifez pro–
fonds ,
&
relevées par-deífous de nerv tres •fail–
lames.
Les fleurs naiffent une
a
une au bout de chaque
b,ran,he,
&
s'épano1.liffent
dans
le mois de Mai
i
















