
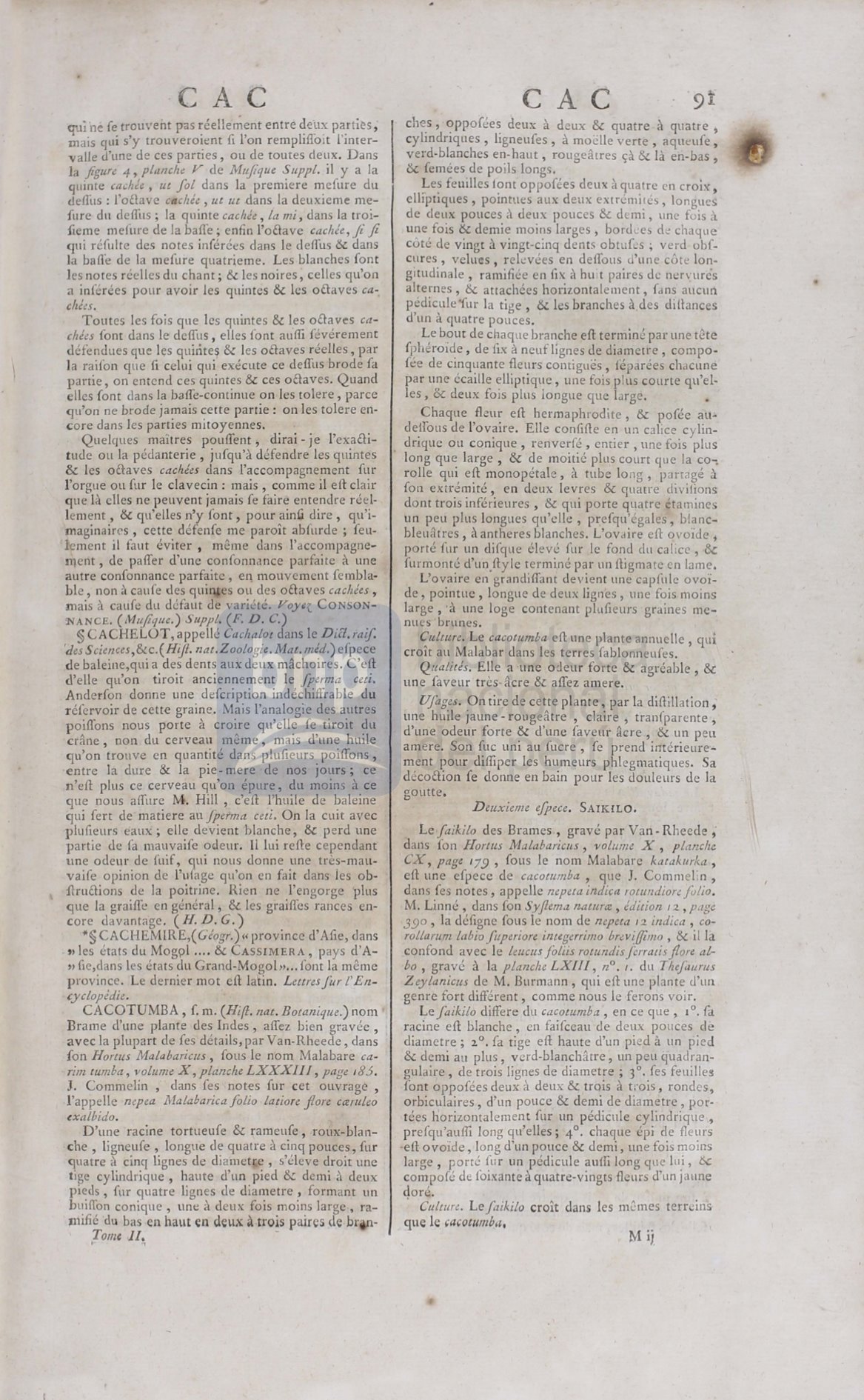
CAC
qui ·ne
fe trouvent
pas
~éellement
entre
~eu~ P~.rties ,
mais qui s'y trouverotent
fi
l'on rempldfo1t
l
mrer–
valle d'une de ces parties, ou de toures deux. Dans
la
figure 4 , pltznchr: V
de
Mujique Suppl.
jl
y
a la
quinte
cachJe
,
ut fol
dans la premiere mefure du
deífus: l'oél:ave
caclzée, ut ut
.dans la deuxieme me–
fure dn deífus · la quin te
cachée , La mi ,
dans la troi–
:íieme mefure de
la
baífe; enfin l'oél:ave
cachée,
Ji
ji
qui
réfulre des notes inférées dans le deífus
&
dans
la
bafie de la rnefure quatrieme. Les blanches font
les no res réelles du chant;
&
les noires, celles qu'on
a
iníi'rées pour avoir les quintes
&
les oétaves
ca–
eMes.
Toutes les
fois
que les qnintes
&
les
oél:a ves
ca–
chées
font dans le deífus, elles font auffi févérement
défendues que les quirite$
&
les oél:aves réelles, par
la
raifon q ue
fi
celui qui exécute ce deífus brode fa
partie on entend ces quintes
&
ces oél:aves. Quand
elles
f~nt
dans la baífe-continue on les tolere, paree
qu'on ne brode jamais cecte parrie : on les tolere en–
core dans les parries mitoyennes.
Quelques ma!tres pouífent, dirai- je l'exaél:i–
tude o
u
la pédanterie , jufqu'a d 'fendre les quintes
&
les oél:aves
cachées
dans l'accompagnement fur
l'orgue o
u
fur le
el
avecin : mais, comme il eft clair
que
la
elles ne peuvent jamaís fe faire entendre réel–
lement,
&
qu'elles n'y font, pour ainíi dire, qu'i–
maginaires , cette défenfe me paroit abfurde ; feu–
lement il faut éviter ' meme dans l'accompagne–
IJ1ent' de paífer d'une confonnance parfaite
a
une
autre confonnance parfaite, eq mouvement fembla–
ble' non
a
caufe des quintes ou des oaaves
cachées'
mais
a
caufe du défaut de variété.
Voyez
CoNSON–
NANCE.
(Mujique.)
Sttppl.
(F. D. C.)
§
CACHELOT,appellé
Cachalot
dans le
Dill.raij.
'des S ciences ,
&c. (
Hijf. nat.Zoologie. Mat. méd.)
efpece
de baleine,qui a des d.enrs aux deux machoires. C'eíl:
d'elle qu'on tiroit anciennement le
fperma ceti.
Anderfon donne une defcription indéchiffrable du
réfervoir de cett.e graine. Mais l'analogie des autres
poiílons nous porte
a
croire qu'elle fe tiroit du
cr~ne
, non du cerveau meme, mais d'une huil.e
qu'on trouve en quantité dans plufieurs poiífons,
entre la dure
&
la
pie- mere de nos jours ; ce
n'eíl: plus ce cerveau qu'on épure, du moins
a
ce
que nous alfure
M. Hill ,
c'eíl: l'huíle de baleine
qui fert de matiere
au
fperma ceti.
On la cuit avec
plufieurs eaux; elle devient blanche,
&
perd une
partie de fa mauvaife ocdeur. Illui refre cependant
une odeur de fuif, qui nous donne une tres-mau.–
vaife opinion de l'ufage qu'on en fait dans les ob–
:íhuél:ions de la poitrine. Rien ne l'engorge plus
que la graiífe en général,
&
les graiífes rances en–
core davantage .
(H. D.G.)
*§CA
CHEMIRE,(
Géogr.)
H
province
d'
Afie, dans
"les états du Mogpl ....
&
CASSIMERA, pays d'A–
»
fie,dans les états du Grand-Mogol
»...
font la meme
province. Le dernier mot efi latín.
Lettres fur l'En–
cyclopédie.
CACOTUMBA,
f.
m.
(Hifi. nat. Botanique.)
nom
Brame d'une plante des Indes, aífez bien gravée,
avecla plupart de fes détails,parVan-Rheede, dans
fon
Hortus Malabariws
,
fous le nom Malabare
ca–
rim tumba , volume X ,planche
LXXXIII,
page
18.5 .
J.
Commelin , dans fes notes fur cet ouvrage ,
l'appelle
nepea Afalabarica folio latiore flore ccemleo
exalbido.
D'une racine tortueufe
&
rameufe,
roux~blan
che ' ligneufe ' longue de quatre
a
cinq pouces' fur
quatre
a
cinq lignes de diametre ' s'éleve droit une
tige cylindrique ' haute d'un pied
&
demi
a
deux
pieds , fur quatre lignes de diametre , formant un
buiffon conique ' une
a
deux fois moins large. ra–
nlifié du bas en
haut en deux
a
trois
paires de
br -
Tome
JI.
-
1
CAC
9
che_s ,
<?ppofée~
deux a deux
&
quatre
a
quatre ,
cyhndnques' hgneufes'
a
moelle verre , aqut"ufe'
verd-blanches en-haut, rougeiitres
~a
&
la
en-has,
&
femées de poils longs.
Les feuilles font oppofées deux
a
quatre en croix
ellíptiques, pointues aux deux extrémi1 ' ,
longue~
de deux pouces
a
deux pouc
S
&
d mi , une fois
a
une fois
&
demie moins larges , bordees de chaque
COté de VÍngt a vingt-cinq dentS obtuf
S
;
verd obf–
cures '
velu~s'
relevées en deífous 'une cote lon–
gitudinale' ramifiée en
fix
a
bu·t
paires den rvures
alternes ,
&
attachées horizonta lement , fdns aucun
pédicule fur la tige '
&
les branches a,des diítances
d'un
a
quatre pouces.
Le bout de chaque branche eft termin ' par une tete
fpl
éroide, de
ft.. '{
a
neuflignes de diamerre' compo–
fée de cinquante fleurs contigues , íé Jarées chacune
par une écaille elliptique, une fois plus courte qu'el..
les,
&
deux fois plus longue que large.
Chaque fleur eíl: hermaphrodite,
&
pofée
att~
deifous de l'ovaire. Elle confiíl:e en
un
calice cylin–
drique ou conique , renverfé, enrier , une fois plus
long que large,
&
de moitié plus court que la co-:.
rolle qui eft monopétale '
a
tube lo ng ' partagé
a
fon extrémité, en deux levres
&
quarre diviíions
donr trois inférieures
>
&
qui porte quatre ¿tamine
un peu plus longues qu'elle , prefqu'égales , b!anc–
bleuatres,
a
antheres blanches. L'ovaire efr ovo!de ;
porté fur un difqlle élevé fur le fond du calice ,
&
furmonté d'un.ftyle terminé par un ftigmate en lame.
L'ovaire en grandiífant devient une capfule ovo!–
de, pointue , longue de deux lignes, une fois moins
large, ·a une loge contenant pluíieurs graines me–
nues brunes.
~ulture.
Le
cacotumba
efi:
une plante annuelle , qui
crott
au
Malabar dans les terres fablonneufes.
Quaütés.
Elle
a
une o deur forre
&
agréable ,
&
une faveur tres-acre
&r.
a!fez amere.
llfages.
On tire de cette plante, par la difiillation,
une huile jaune-
rouge~tre
, claire , tranfparente,
d'une odeur forre
&
d'une faveur &ere,
&
un peu
amere. Son fue uni au fuere, fe prend irrtérieure·-.
ment pour diffiper les humeurs phlegrnatiques. Sa
décoél:ion fe donne en bain pour les douleurs de
la
goutte.
Deuxieme efpece.
SAIK!LO.
Le
faikilo
des Brames , gravé par Van- Rheede ;
dans fon
Hortus Malabaricus
,
volume
X
,
planclze
ex'
page
IJ9
'
fous le nom Malabare
katakurka
'
eíl: une efpece de
cacotumba
,
que
J.
CommeEn ,
dans fes notes, appelle
nepeta indica rotttndiore foLio .
M. Linné , dans fon
S
y
flema naturce
,
édition
12 ,
page
390
,
la défigne fous le nom de
nepeta
12
indica
,
co–
roLLarum labio jitperiore integerrimo br¿v{(Jimo
,
&
illa
confond avee le
leucus foliis rotundis ferratis flore al–
bo
,
gravé
a
la
planche LXIII, n° .
'·
du
Thefaurus
Z eylanicus
de M. Burmann, qui eíl: une plante d'un
genre fort différent, comme nous
le
ferons voir.
Le
faikilo
differe du
cacotumba,
en ce que ,
1°.
fa
racine eíl: blanche , en faifceau de deux pouces de
diametre;
2
o.
fa rige eft haute d'un pied
a
un píed
&
demi a
u
plus, verd-blanchatre, un pe
u
quaclran–
gulaire, de trois lignes de diametre ;
3
o.
fes feuilles
font oppofées deux
a
deux
&
trois a t.-ois' rondes,
orbiculaires, d\tn pouce
&
demi de diametre, por–
tées horizontalement fur un pédicule cyliodrique,
prefqu'auffi long qu'elles;
4°.
chaque 'pi de fleurs
eíl: ovo1de, long d\m pouce
&
demi, une fois moins
large , porté fur un pédicule auífi long que luí,
&
compofé de foixante a quatre-vingts fleurs d un jaune
doré.
.
Culture.
Le
faikilo
cro1t dans les memes terr ins
que le
;a~otumba,
















