
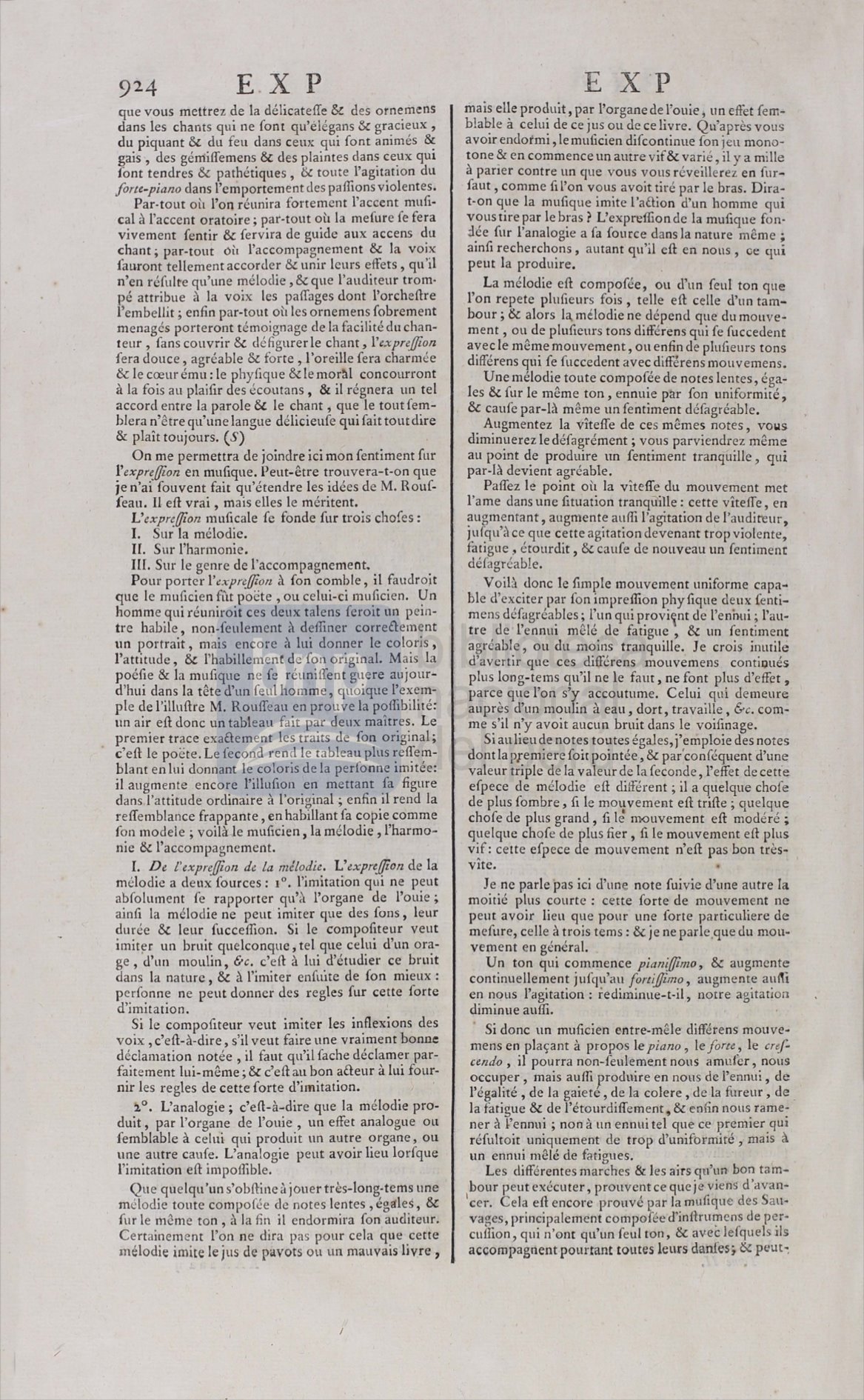
/
EXP
que vous mettrez de la délicateífe
&
des
orn~mens
dans les chants qui ne font qu'élégans
&
grac1eux,
du
piquant
&
du feu dans ceux qui font animés
8:
gais , des gém.iífemens
&
des plaintes dans
ce~x
qut
font tendres
&
pathétiques ,
&
toute
l'agit~twn
du
forte-piano
dans l'emportement des paffions v10lentes.
Par-tout
Otl
l'on réunira fortement l'accent mufi–
cal a l'accent oratoire; par-tout
Oll
la mefure fe fera
vivement fentir
&
fervira de guide aux accens du
chant; par-tout
oit
l'accompag~ement
&
la
vo!~
fau-ront tellement accorder & umr leurs effets , qu 1l
n'en réfulte qu'une mélodie ,&que l'auditeur trom–
pé attribue
a
la voix les paífages dont l'orchefire
1
1
embellit ; enfin par-tout oitles ornemens fobrement
menagés porteront témoignage de la facilité duchan–
teur, fans couvrir
&
défigurer le chant,
l'expre.fjion
fera douce, agréable
&
forre, l'oreille fera charmée
&
le creur ému: le phyfique
&
le
mor~l
concourront
a
la fois a
u
plaifir des écoutans'
&
il régnera un tel
accord entre la parole & le chant , que le tout fem–
hlera n'etre qu'une langue délicieufe qui fait tout dire
&
plait toujours.
(S)
On me permettra de joindre ici mon fentiment fur
1'
expre.fjion
en mufique. Peut-etre trouvera-t-on que
je n'ai fouvent fait qu'étendre les idées de
M.
Rouf–
feau.
11
efi vrai , mais elles le méritent.
L'expr~(fion
muficale fe fonde fur trois'chofes:
l.
Sur la mélodie.
JI.
Sur l'harmonie.
III.
Sur le genre de l'accompagnement9
Pour porter
l'expreJ/ion
a
fon comble,
il
faudroit
que le muficien
fí'tt
poete, ou celui-ci
mu~cien. ~n
homme qui réuniroit ces deux talens ferott un pem–
tre habile' non-feulement
a
deffiner correétement
un portrait' mais encore
a
lui donner le
col~ris'
l'attitude,
&
l'habillement de fon original. Mats
la
poéfie & la mufique ne
fe
réuniífent guere aujour–
d'hui dans la tete d'un feul homme, qnoique l'exem–
ple de l'illnfire
M.
Rouifeau en prouve la poffibilité:
un air efi done un tablean fait par deux ma!tres. Le
premier trace exaél:ement les traits de fon original;
c'efi le poete. Le fecond
ren~
le tablea
u
plus
:eífe~blant en luí donnant le colons de la perfonne 1m1tee:
il augmente encore l'illufion en mettant _fa figure
dans l'attitude ordinaire
a
!'original ; enfin
11
rend la
reífemblance frappante, en habillant fa copie comme
fon modele; voilaJ.e muficien, la mélodie, l'harmo–
nie
&
l'accompagnement.
l.
De
l'
expre.fjion de la mélodie.
L'
expreJ!ion
de la
mélodie a deux fources:
1°.
l'imitation qui ne peut
abfolument fe rapporter qu'a l'organe de l'ouie;
ainíi la mélodie ne peut imiter que des fons, leur
durée & leur fucceffion.
Si
le compofiteur veut
imit~r
un bruit que!conque, tel que celui d'un
or~ge ' d'un moulin'
&c.
c'efi
a
lui d'étudier ce brmt
dans la nature' &
a
l'imiter enfuite de fon mieux :
perfonne ne peut donner des regles fur cette forte
d'imitation.
Si le compoíiteur veut imiter les ir:flexions des
voix, c'efi-a-dire, s'il veut faire une vratment bonne
déclamation notée , il faut qu'il fache dédamer par–
faitement lui-meme;
&
¿efta.u bon aél:eur
a
lui four-
nir les regles de cette forte d'imitation.
·
2
°.
L'analogie; c'eíl-a-dire que la mélodie pro–
duit, par l'organe de l'oLÚe , un effet analogue ou
femblable
a
cetui qui produit un autre organe' ou
une autre caufe. L'analogie peut avoir lieu lorfque
l'imitation eB: impoffible.
Que quelqu'uns'obíl:it1e
a
jouer tres-long-tems une
mélodie toute compofée de notes lentes, égales, &
fur le meme ton' a la fin
il
endormira fon auditeur.
Certainement l'on ne díra pas pour cela que cette
rnélodie imite
le jus
de pavots ou un
mauvais livre ,
E X P
mais elle produit, par l'organe de l'ouie, un effet fem–
blable
a
celui de Ce jus
OU
de Ce livre. QLl'apn!s
VOUS
avoir endot'mi, le muficien difcontinue fon jeu mono–
tone
&
en commence un autre vif& varié, il
y
a mille
a parier contre un que vous vous réveillerez en fur–
faut, comme fi l'on vous avoit tiré par le bras. Dira–
t-on que la mufique imite
1
'aélion d'un homme
qui
vous tire par le bras? L'expreffion de la mufique fon–
.:lée fur l'analogie a fa fource dans la nature meme;
ainfi recherchons, autant qu'il eft en nous , ce qui
peut la produire.
La mélodie efi compofée,
ou
d\m feul ton que
l'on repete pluíieurs fois, telle eft celle d'un tam–
bour;
&
alors la. mélodie ne dépend que du monve•
ment, ou de plufieurs tons diíférens qui fe fuccedent
avec le meme mouvement, ou enfin de pluíieurs tons
différens qui fe fuccedent avec différens mou vemens.
Une mélodie toute compofée de notes lentes, éga–
les
&
fur le meme ton' ennuie par fon uniformiré'
&
caufe par-la meme un fentiment défagréable.
Augmentez la viteffe de ces memes notes, vous
diminuerez le défagrément ; vous parviendrez meme
au point de produire un fentiment tranquille ,
qui
par-la devient agréable.
Paífez le point o1t
la
viteffe du mouvement met
l'ame dans une útuation tranqu'lle: eette viteífe, en
augmentant, augmente auffi l'agitation de l'audireur,
ju
fqu'a ce que cette agitation devenant trop violente,
fatigue, érourdit,
&
caufe de nouveau un fentiment
défagréable.
Voila done le fimple mouvement uniforme capa–
ble d'exciter par fon impreffion phyfique deux fenti–
mens défagréables; l'un qui provi,nt de l'ennui; l'an·
tre de l'ennui melé de fatigue '
&
un fentiment
agréable, ou du moins tranquille.
J
e crois inutile
d'avertir que ces différens mouvemens contiuués
plus long-tems qu'il ne le faut, ne foflt plus d'effet,
paree que l'on s'y accoutume. Celui
qui
demeure
a
upres d'un moulin
a
ea
ll'
dort' travaille ,
&c.
com–
me s'il n'y avoit aucun bruit dans le voifinage.
Si aulieude notes toutes égales,j'emploie des notes
dont la p¡emiere foit pointée,
&
par~conféquent
d'une
valeur triple de la valeur de
la
feconde, l'effet de cett·e
efpece de méiodie efi différent; il a quelque chofe
de plus fombre, file mou vement efi trifie; quelque
chofe de plus grand, fi
1~
mouvement efi m
odéré ;
quelque chofe de plus fier,
ú
le mouvement
e.fiplus
vif: cette efpece de mouvement n'eft pas bon tres–
vite.
Je ne parle pas ici d'une note fuivie d'une autre
Ia
moitié plus courte : cette forte de mouvement ne
peut avoir lieu que pour une forte particuliere de
mefure, celle a trois tems:
&
je
ne parle.que du mou–
vement en général.
Un ton qui commence
pianiflimo,
&
augmente
continuellement jufqu'au
fort:iifimo,
augmente autft
en nous l'agitation : rediminue-t-il' notre agitaúon
diminue auffi.
Si done un muficien entre-mele différens mouve·
mens en
pla~ant
a
propos le
piano'
le
forte'
le
cref–
cendo,
il
pourra non-feulement nous amufer, nous
occuper, mais auffi produ.ire en nous
de
l'ennui, de
l'égalité, de la gaiete, de la colere, de la fureur, de .
la fatigue
&
de l'étourditfement,
&
en
fin
nous rame;
ner a 1'ennui; non
a
un enmti tel que ce premier
qm
réfultoit uniquement de trop d'unifbrmité ' mais
a
un ennui melé de fatigues.
Les différentes marches
&
les airs q111'un bon tam–
bour peut exécuter, prouventce quej€ v.íens d'avan-
1cer. Cela efi encore pronvé par
la
mufique des San–
va
~res
principalement compofée d'inftru_mens de per–
cuffio~,
qui n'0nt qu'un feul ton,
&
avec lefquels
ils
accompagnent pourtant toutes leurs
da·nfe.s;
&
peut;
















