
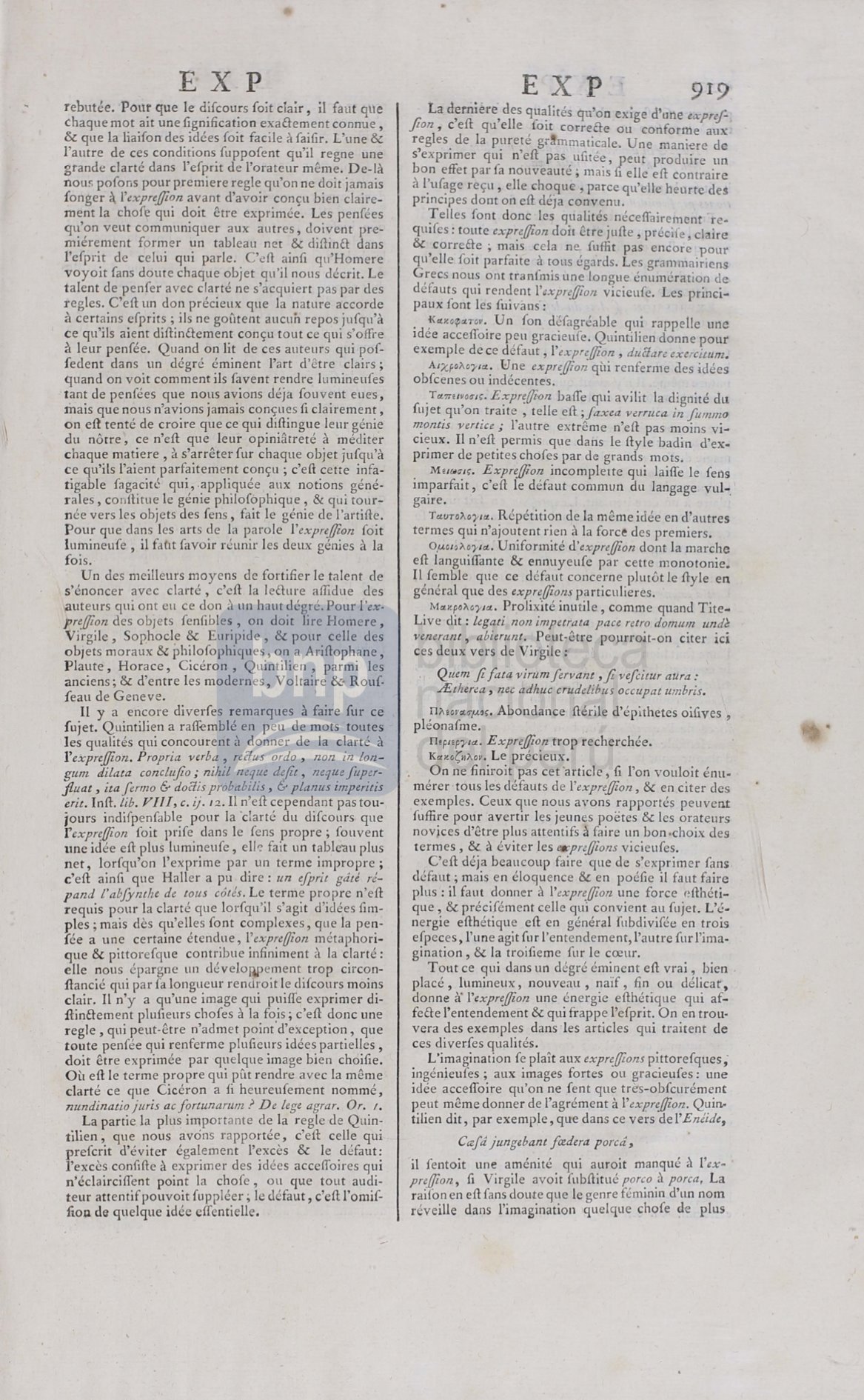
EXP
rebutée. Pour que le difcours foit dair,
ii
faut que
chaque mot ait une fignification exaétement connue ,
&
que la liaifon des idées foit facile
a
faiGr. L une
&
l'autre de ces conditions fuppofent qu'il regne une
grande clarté dans l'efprit de l'orateur meme. De-la
nour. pofons pou
rpremiere regle qu'on ne doit jamais
fonger
a
l'expre.f!
i.onavant d'avoir
con~u
bien claire–
ment la chofe qui doit etre exprimée. Les penfées
qu'on veut communiquer aux atJtres, doivent pre–
miérement former un tableau net
&
difiinél: dans
l'efprit de ceJuj qui parle. C'efl: ainíi qu'Homere
voyoit fans doure chaque objet qu'il nous décrit. Le
talent de penfer avec clarté ne s'acquiert pas par des
regles. C'efi un don précieux que la nature accorde
a
certains efprits ; ils ne gotitent aucun repos jufqu'a
ce qu'ils aient difiinél:ement con<_;:u tout ce quí s'offre
a
leur penfée. Quand on lit de ces auteu rs qui pof–
fedent dans un dégré éminent l'art d'etre clairs ;
quand on voit comment ils favent rend re Iumineufes
tant de penfées que nous avions déja fou vent eue'S,
mais que nous n'avions jamais cons:ues íi clairement'
on eft tenté de croire que ce qui dífl:ingue
Ieur
génie
du nórre' ce n'efi que leur opiniatreté a méditer
chaque matiere 'a s'arreter fur chaque objet jufqu'a
ce qu'ils l'aient parfaitement con<_;:u ; c'efl: cette infa–
tigable fagacité qui, .appliquée aux notions géné–
rales, conílitue le génie philofóphique,
&
qui rour–
née vers les objets des fens, fait le génie de !'artille.
Pour que dans les arts de
la
parole
1'
exprejfion
foit
lumineufe ' il fatlt favoir
r
1
unir les deux génies
a
la
fois.
Un des meílleurs moyens de fortifier le talent de
s'énoncer avec clarté , c'efr la leél:ure affidue des
auteurs qui ont eu ce don
a
un haut dégré. Pour
l'ex–
pre.flion
des objets feníibles, on doit lire Homere,
Virgile, Sophocle
&
Euripide,
&
pour celle des
obJets moraux
&
philofophiques, on a Ariíl:ophane,
Plaute, Horace, Cicéron , Quintilien , parmi les
anciens;
&
d'entre les modern es , Voltaire
&·
Rouf.
{eau de Geneve.
'
U
y
a encore diverfes remarques
a
faire fur ce
fujet. Quintilien a raífemblé en peu de mots toutes
les qualités qui concourent
a
donner de la clarté
a
1'
exprejfion. Propria verba
,
reélus wdo
,
non in lon–
gum dilata conclujio; nihil neque dejit
,
neque fup er–
jluat
,
ita Jermo
&
doélis probabilis
,
&
planus imperitis
erit.
Inll.Líb.
PI/I,
c.
ij.
12 .
Il n'efi cependant pas tou-
jours indifpenfable pour la 'clarté du difcours que
fexpreflion
foit prife dans le fens propre; fonvent
tme idée efr plus lumineufe,
ell~
fait un tableau plus
net, lorfqu'on !'exprime par un terme impropre;
c'efi ainíi que Haller a pu dire:
un efprit gáté ré–
pand l'abfynthe de tous cótés.
Le terme propre n'efr
requis pour la clarté que lorfqu'il s'agit d'idées íim–
ples; mais des qu'elles font complexes, que la pen–
fée a une certaine étendue,
I'expre(Jion
métaphori–
que
&
pittorefque contribue infiniment
a
la clarté:
elle nous épargne un déveloJWement trop circon–
ftancié qui par fa longueur renclroit le difcours moins
clair. Il n'y a qu'une image qui
puiífe exprimer di–
frinétement plufieurs chofes
a
la
fo.is;c'eíl: done une
regle, qui peut-etre n'admet point d'e'x ception, .que
toute penfée qui renferme pluíieurs idées partielles ,
doit erre exprimée par quelque image bien choiíie.
Ütl
efi le terme propre qui pftt rendre avec la meme
clarté ce que Cicéron a
:fi
heureufement nommé,
nundinatio juris ac fortunarum
?
De lege agrar. Or.
1.
La par
ti
e la plus i111portante de la regle ·de Q uin–
tilien, que nous avóns rapportée, c'efi eelle qui
prefcrit d'éviter également l'exces
&
le défaut:
l'exces confiíte a exprimer des idées acceiJoires qui
n;éclairciífent point la chofe, ou que tout audi–
teur atrentif pouvoit fuppléer; le défaut, c'efr l'omif–
fiop. de quelque idée eífentielle.
EXP
. t
La clerniere eles quali
rés qu'onexige d\me
.xpr:f-
fion ,
c'efi qu'elle ,foit
corre.ae ou confortne aux
r.,egles. de la
p~tre; g~
mmattcale. Une maniere de
s expnmer qut n efr pas , uG.
é~
'[eut produire un
bon effer par fa nouveaute; ma1s
elle eíl: contraire
a
l'ufage res:u' elle choque' paree
qu
elle heurte des
príncipes dont on eft déja convenu.
!elles font done les quaütés néceífairement re..
qmfes: toute
expreJ/ion
doit etre juíl:e' pr
' cife
claire
& ,
corre~e
;
ma~s
c,ela ne, fuffit pas encor; pour
qu elle fOit parfatte a tous egards. Les grammairiens
G;ecs
nou~
ont tranfmis une longue énum ' rarion de
defauts
qm
rendent
l'exprdfion
vicíeufe. Les princi–
paux font les fuivans:
•
!<aKc~!I.Tov
•.
Un
fon defagréable qui rappelle une
tdee acceífo1re peu gracieufe . Quintilien donne pour'
exemple dece défaut,
I't!xpr~(Jion,
duélareexercitum.
A1x_po>..o-r,a.
Une
expre(/ion
qui renferme des idées
obfcenes ou indécenres. ·
_Tct-7Tu~o¡¡-¡~. E~pr~(fiwz
baífe
qui
avilit la d.ignité du
fu¡et .qu on .traite , telle efi
;faxea vermca m fiwzm.o
m_ontts
ver~tce;
1
au!re extreme n'eít pas moins vi–
Cl~ ux.
Il
n efi permts que dans le fiyle badin d'ex–
pnmer de perites chofes par de grands mots.
•
ME/r.~'~·
ExprefJio';
incomplette qui laiífe le fens
tmparfc·ut, c'eíl: le defaut commun dn langage vul-:
gatre.
TctUTOAOJ'Ict.
Répétition de la meme idée en d'autres
termes qui n'ajoutent ríen
a
la force des premiers.
OfA..oloA.o-rtr.t.
Uniformité
d'exprejfion
dont la marche
efr languiífante
&
ennuyeufe par -cette monotonie.
Il femble que ce défaut concerne plurót le fryle en
général que des
expr~(Jions
particulieres.
Mr.t.Y.po'A"J'ICL.
Prolixité inutile, comme quand Tite–
Live dit:
le.gati non impetrata pace retro domwn unde
venerant, abierunt.
Peut-etre
po..urroit~on
cite.r
ici
ces deux vers de Virgile:
Quem
Ji
/ata virum fervant
,ji
vefcitur aura:
A!.therea, nec adhuc crudelibas occupat umbris.
nA.~ovr.tvfA..o~.
Abondance fiérile d'épithetes oifives ,
pléonafme.
fiepHp-rir.t.
Expreflion
trop recherchée.
Ka~to,
l1A.ov.Le précieux.
On ne finiroit pas cet ·article,
fi
l'on vouloit 'nu.
mérer tous les défau ts de
l'expreflion,
&
en citer des
exemples. Ceux que nous avons rapporté$ peuvent
fuffire pour avenir les jeunes poetes
&
les orateurs
novices d'etre plus attentifs
a
faire un bon ·choix des
termes,
&
a
éviter
les
e«pre.flions
vicieufes.
C'efr déja beaucoup faire que de s'exprimer fans
d 'faut; mais en éloquence
&
en poéGe il faut faire
plus: il faut donner a
l'expreffion
une force efthéti–
que,
&
précifément ce1le qui convient au fujet. L'é..
nergie efihétique efi en général fubdivifée en trois
efpeces, l'une agit fur l'entendement, l'autre furl'ima–
gination,
&
la troifierne fur le creur.
Tmit ce qui dans un dégré éminent efi vrai, bien
placé , lumineux , nouveau , naif, fin ou délicat,
donne
a:
l'expre.flion
une énergie eíl:hétique qui af–
feél:e l'entendement
&
qui frappe l'efprit. On en trou–
vera des exemples dans ·les articles qui traitent de
ces diverfes qualités.
L'imagination fe plait aux
expreflions
pittorefques;
ingénieufes ; aux images fortes ou gracieufes: une
idée acceífoire qu'on ne fen t que tres-obfcurément
peut meme donner de l'agrément
a
l'expreflion.
Quin..
tilien dit, par exemple, que dans ce vers de
1'
Enéide,
Ccefá jungebant fadera porcá,
il fentoit une aménité qui auroit manqué
a
!'ex..
preflion,
fi
Vírgile avoit fubíl:itué
P,or~o
.a
p~rca,
La
raifon en efi fans doute que le genre femmm d un nom
r 'veille dans l'imagination quelque chofe de plus
















