
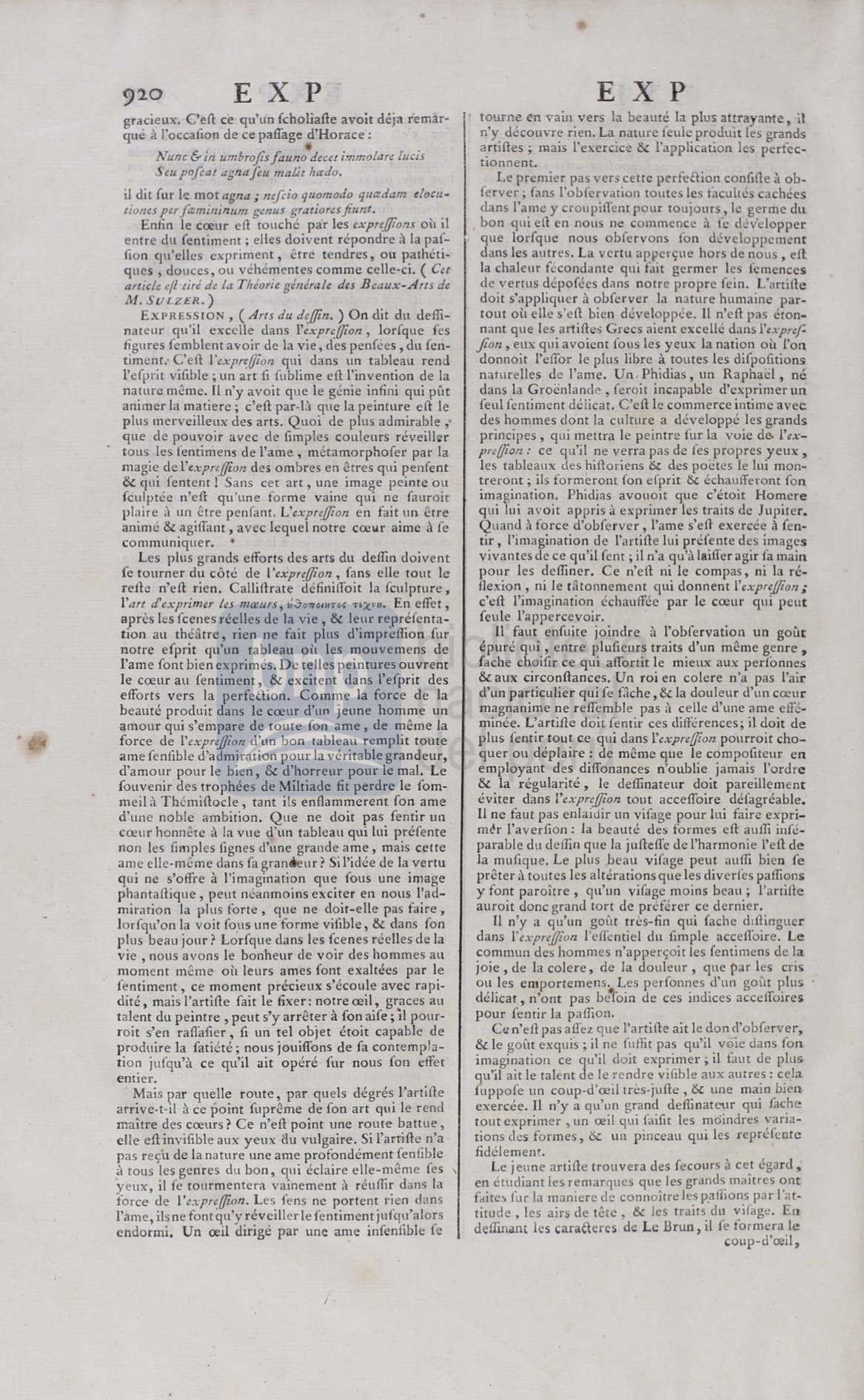
EXP
gracieux.
C'efi
ce qu'un fcholiafl:e avoit déja remar-
1
qué
a
l'occafion de ce paiTage d'Horace :
N une
&
in umbrofofauno decet immolare lu is
eu pofcat agnafeu mallt hcedo.
il
dit fur le mot
agna; nifcio quomodo qucedam
dtJcu–
tiones perft2mininum genus gratiores fiunt.
Enfin le creur eft touché par les
expreffions
oit
il
entre du fentiment ; elles doivent répondre
a
la paf–
fion qu'elles expriment ' etre tendres' ou pathéti–
ques , do
u
ces, o
u
véhémentes comme celle-ci. (
Cet
areicle efl tiré de la Théorie générale des
B
eaux-Arts de
M.
SULZER.)
EXPRESS ION'
e
Ares du def!in.
)
On
dit
du deffi–
nateur qu'il excelle dans
l'expre(fion,
lorfque fes
figures femblent avoir de la vie, efes penfées, du fen–
timent.· C'eft
l'expr~{fion
qui dans un tableau rend
l'efprit viúble ; un art fi fub lime eft l'invention de la
nature meme. Il n'y avoit que le génie infini qui pflt
animer la matie re; c'eíl: par-la que la peinture eíl: le
plus merveilleux des arts. Quoi de plus admirable
i
que de pouvoir avec de fimples couleurs
réveill~r
·
tous. les fentimens de l'ame, métamorphofer par la
rnagr~
de
l'e:r:prejjion
des ombres en etres qui penfent
&
qm fe ntent! Sans cet art, une image peinte ou
fculptée n'efr qu'une forme vaine qui ne fauroit
plaire
a
un etre pen fant.
L'expreffzon
en
fait un etre
animé
&
agiífant, avec fequel notre cre'l.lr aime
a
fe
communiquer.
•
Les plus grands efforts des arts du deffin doivent
fe tourner du coté de l
'expr~{fion'
fans elle tout le
refte n'eíl: rien. Calliíl:rate défini(foit la fculpture,
1'
are
d'
exprimer üs me2urs,
~:.Jo?TomTo~
-ré;tva.
En effet,
apres les
[cenes
réelles de la vie,
&
leur repréfenta–
tion au théatre, rien ne fait plus d'impreffion fur
notre efprit qu'un tableau Otl les mouvemens de
l'arne font bien exprimés.
D~
telles peintures ouvrent
le creur au fentiment'
&
excitent dans eefprít des
efforts vers la perfeél:ion. Comme la force de la
beauté produit dans le creur d'un jeune homme un
amour qui s'empare de toute fon ame' de rneme la
force de
l'exprejjion
d'uo bon tableau remplit toute
ame fenfible d'admiration pour la véritable grandeur,
d'amour pour le bien,
&
d'horreur pour le mal. Le
fouvenir des trophées de Míltiade fit perdre le fom–
rneil
a
Thémifiocle, tant ils enflammerent fon ame
d'une noble ambition. Que ne doit pas fenrir un
creur honnete
a
la vue d'un tablean qui lui préfente
non les fimples fignes d'une grande ame, mais cette
ame elle-meme dans fa grantteur? Sil'idée de la vertu
qui ne s'offre
a
l'imagination que fous une image
phantafiique, peut néanmoins exciter en nous l'ad–
miration la plus
forte, que ne doir-elle pas faire,
lorfqu'on la voit
fo.usune forme vifible,
&
dans fon
plus beau jour? Lorfque dans les fcenes réelles de la
vie , nous avons le bonheur de voir des hommes au
moment meme
oit
leurs ames font exaltées par le
fentiment, ce moment précieux s'écoule avec rapi–
dité, mais l'artiíl:e fait le fixer: notre reil, graces au
talent du peintre 'peut s'y arreter
a
fon aife; il pour–
roit s'en raífafier, fi un tel objet étoit capable de
p roduire la fati ' té; nous jouiífons de fa contempla–
tion jufqu'a ce qu'il ait opéré fur nous fon e:ffet
enrier.
Mais par quelle route, par qu els dégrés l'a-rtifie
arrive-t-il
a
ce point fupr eme de fon art qui le rend
rnaitre des comrs? Ce n'eíl: point une route battue,
elle eft in ifible aux yeux au vulgair-e. Si l'artiíl:e n'a
pas re<;u de la nature une ame profondément fenfible
a
tous les genres du bon' qui éclaire elle-meme
[es
yeux, il fe tourmentera vainement
a
réuffir dans la
force de l
'expr~(fion.
Les fens ne porrent ríen dans
l'ame, ils ne fontqu'yréveiller lefentimentjufqu'alors
endormi. Un
~il
dírigé par une ame infenfible fe
EXP
toun e en vain ver
la beauté la plus attra ·ante
it
n
Y.
d
'couvr~
rien. La. nature
_f
ul .
pr~duit
les
gra~ds
a.rtlÍies ; mats
1
exerc1ce
&
1
apph atlon
1
s p rtec–
twnnenr.
Le premier pas ver cette perfeélion conúíte
a
ob–
ferver
; fansl'obfervation toutes les tacuhe cach es
dans l'
a.mey croupiífent pour toujours,
1
germe du
bon qnt eíl: en nons ne commence
a
fe d -velopper
que lorfque nous obfervons fon d 'velopp ment
dans les autres. La vertu appercrue hors de oous eft
la chaleur
fi /
condante qui fait germer les
feme~ces
de vertus dépofées dans notre propre fein. L anifie
doit s'appliquer
a
obferver la nature humaine par–
tour oit elle s'efi bien développée. Il n'efi pas éton–
nant que les artiíl:es Grecs aient excellé dans
l'expref-
Jion,
eux qui avoient fous les yeux la nation ou Ion
donnoit l'effor le plus libre
a
toutes les difpofitions
naturelles de !'ame. Un
1
Phidias, un Raphael, né
dans la Groenlande, feroit incapable d'exprimer un
feul fentiment délicat. C'efi le commerce intime avec
des homrnes dont Ja culture a développé les grands
príncipes, qui rnettra le peintre fur la voie de
l'ex–
pre{fion:
ce qu'il ne verra pas de fes propres yeux,
les tableaux des hiíl:oriens
&
des poetes le lui rnon–
treront ; ils formeront fon efprit
&
échauffe1:ont fon
imagination. Phidias avouoit que c'étoit Homere
qui lui a voit appris
a
exprimer les traits de Jupiter.
Quand
a
force d'obferver' l'ame s'efr exercée
a
fen–
tir, l'imagination de l'artiíl:e luí préfente des images
vivan tes de ce qu'il fent; il n'a qu'a laiífer agir fa main
pour les deffiner. Ce n'eíl: ni le compas, ni la ré–
flexion, ni le tatonnement qui donnent
l'expreffion ;
c'eft l'imagination échauffée par le creur qui peut
feule l'appercevoir.
Il faur enfuite joindre
a
l'obfervation un gout
épuré qui' entre plufieurs traits d'un rneme genre
fache choifir ce qui aífortit le mieux aux perfonne;
&
aux circonfiances. Un roi en colere n'a pas l'air
d'un particulier qui fe fache,
&
la douleur d'un creur
rnagnanime ne reífemble pas a celle d'une ame effi'–
rninée. L'arriíl:e doit fentir ces di:fférences; il doit de
plus fentir tout ce qui dans
l'expreflion
poürroit cho–
quer ou déplaire : de rneme que le compofiteur, en
employant des diffonances n'oublie jamais l'ordre
&
la régularité , le deíiinateur doit pareillement
éviter dans
l'expreffion
rout acceífoire défagréable.
Il ne faut pas enlaidir un vifage pour lui faire expri–
m~r
l'averfion: la beauté des formes efi auffi infé–
parable du deffin que la juíl:eífe de l'harmonie l'efi de
la mufiqu e. Le plus beau vifage peut auffi bien fe
pretera toutes les altérations que les diverfes
paffion~
y
font paroirre , qn'un vifage moins beau ; l'artiíl:e
auroit done grand tort de préférer ce dernier.
Il n'y a qu'un gout tres-fin qui fach e dríl:inguer
dans
1'
expref!ion
l'eili ntiel du fimple acceífoire. Le
commun des hommes n'appercroir les fentimens de la
joie , de la colere, de la douleur , que par les cris
ou les emportemens. Les perfonnes d'un gotLt plus
délicat, n'ont pas befoin de ces índices acceífoires
pour fentir la paffion.
c(t
n'efr pas aífez que l'artiíl:e ait le don d'obferver,
&
le gof'lt exquis ; il ne fuffir pas qu'il voie dans fon
imagination ce qu'il doit exprimer; il faut de plus
qu'il ait le talent de le rendre viúble aux autres : ce_Ia
fuppofe un coup-d'reil tres-jufie,
&
une main bjen
exercée. Il n'y a qu'un grand deffinateur qui fache
tout exprimer , un reil qui faifit les rnoindres varia–
tions des formes,
&
un pinceau qui les repréfeote
fidélement.
Le jeune artifie trouvera des fecours
a
cet égard;
en étudiant les remarques que les grands maltres ont
faite~
fur la maniere de connoicre les p,affions par
1
'at–
titude , les airs de tete ,
&
les
rrairs du viíage. En
deílinant les caraéteres de Le Brun, il fe formera le
coup-d'~il,
















