
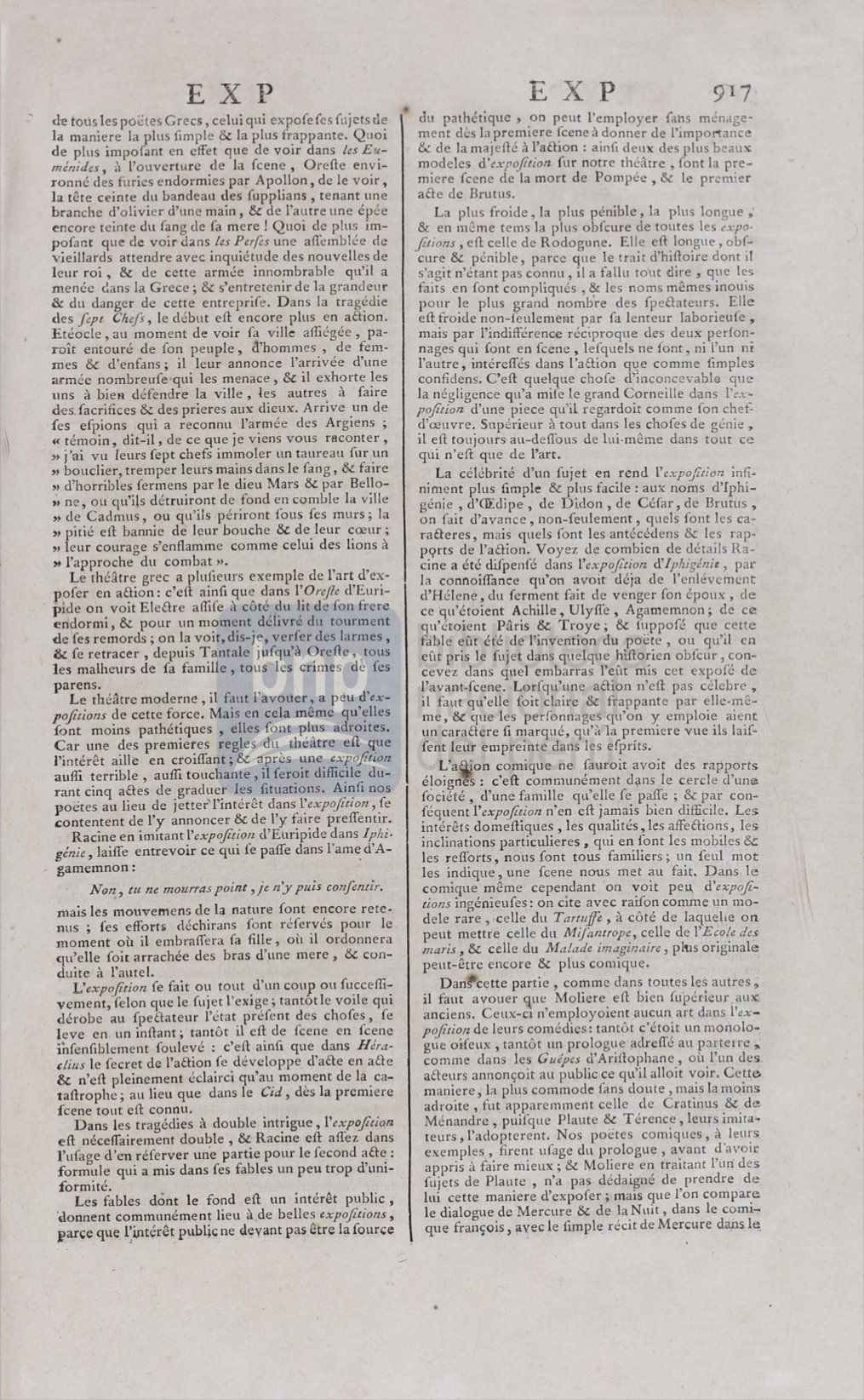
EXP
de tous les poetes Grecs, celui qui expofe fes fujets de
la maniere la plus fimple & la plus frappante . Q uoi
de plus irnpo fant en effet que de voir dans
Les Eu–
ménides ,
a
l'ouvertttre de la fcene , O refie envi–
ronné des furies endormies par
A
pollon, de le voir,
la tete ceinte du bandeau des fupplians , tenant une
branche d'olivier d'une main,
&
de l'autre une épée
encore
teinte du fang de fa mere! Quoi de plus im–
pofant que de voir dans
les Pet{es
une aífemblée de
vieillards attendre avec inquiétu de des nouvelles de
leur roí ,
&
de cette armée innombrable qu'il a
menée clans la Grece;
&
s'entretenir de la grandeur
&
du danger de cette entreprife. Dans la tragédie
des
fept Chefs,
le début efi encore plus en aétion .
Etéode, au moment de voir fa ville affiégée, pa–
roit entouré de fon peuple , d'hommes , de fem–
mes
&
d'enfans; il leur annonce l'arrivée d'une
armée nombreufe qui les menace,
&
il exhorte
!es
uns
a
bien défendre la ville ,
¡es
autres
a
faxre
des.facrifices & des prieres aux diem,. Arrive un de
fes efpions qui a reconnu l'armée des Argiens ;
(( témoin, dit-il, de ce queje viens vous raconter,
,
j'ai vu Ieurs fept chefs immoler un taureau fur un
" bouclier, tremper leurs mains dans le fang,
&
faire
" d'horribles fermens par le dieu Mars
&
par Bello–
,. ne, ou qu'ils détruiront de fond en comble la ville
, de Cadmus, o u qu'ils périront fous fes murs; la
"pitié efi bannie de leur bouche
&
de leur creur;
, leur courage s'enflamme comme celui des lions a
>t
l'approche du combat "·
Le théfttre grec a plufieurs exemple de l'art d'ex–
pofer en aélion: c'efi ainfi que dans
l'Ore.fte
d'Euri-
. p ide on voit Eleétre affife
a
coté du lit de fon frere
endormi,
&
pour un rnoment délivré du tourment
-de fes remords; on la voit, dis-je, verfer des larmes,
&
fe retracer, depuis Tantale jufqu'a Oreile, tous
les malheurs de fa famille , tous les crímes
d ~
fes
parens.
Le
thé~tre
moderne,
i1
faut l'avoúer, a peu
d'ex–
pojitions
de cetre force. Mais en cela meme
qu'~lles
font moins pathétiques , elles font plus adroltes.
Car une des premieres regles du théatre efi que
l'intéret aille en croiífant; & apres une
expojition
auffi terrible , auffi touchante, il feroit difficile du–
rant cinq a8:es de
.gradu~! I~s" fituati~ns.
A!I?íi nos
poetes. au lieu de Jetter
1
rnteret dans
1
expojztzon,
fe
contentent de
l'y
annoncer
&
de l'y faire preífentir.
Racine en imitant
l'expofúion
cl'ELtripide dans
lplzi.
génie,
laiífe entrevoir ce qui fe paífe clans
l'am~
d'A–
gamemnon:
Non,
ttt
ne mourras point, je ny puis confentir.
mais les mouvemens de la nature font encere
rete~
nus ; fes efforts déchirans font réfervés pour le
moment ou il embraífera fa ñlle,
Otl
il ordonnera
qu'elle foit arrachée des bras d'une mere,
&
con–
duite
a
l'autel.
L'
expofition
fe fait
0':1
to;lt .d'un cou,p ou fu.cceffi:
vement, felon que le fu jet
1
extge; tantotle VOile qm
dérobe au fpeél:ateur l'état préfent des chofes, fe
leve en un infiant ; tantot
il
efi de fcene en fcene
infenfiblement foulevé : c'efi ainfi qué dans
H éra·
ctius
le fecret de l'aélion fe développe d'aél:e en aéte
&
n'efi pleinement éclairci qu'au moment de la ca–
tafirophe; au lieu que dans le
Cid,
des la premiere
fcene tout eft connu.
Dans les tragédies
a
double int:igue,
1'
expojition
efi nécef.fairement double ,
&
Racme efi aífez dans
l'ufage d'en réferver un·e ·partie pour le fecond aéte:
for·mule qui a mis dans fes fables un peu trop d'uni–
formité.
Les
fables dont le fond efi un
intér~t
public,
'donnent communément lieu
a
de belles
expofitions'
J?.arce que.
l:intéret
pnbljc;
ne
c¡\~y~nt
pas etre la fource
EXP
du pathétique
;
oo peut l'employer fans m ·nage–
ment d
S
la premiere fcene a donner de l'importance
&
de la majefté
a
l'aaion : ainfi deux des plus beaux
modeles
d'expojition
fur notre théatre, font la pre–
miere fcene de la mort de Pompée ,
&
le pr mier
aéte de Brutus.
La plus froide, la plus pénible, la plus longue ;
&
en meme tems la plus obfcure de toutes les
expo·
fitions ,
eft celle de Rodogune. Elle efi longue , obf–
cure
&
pénible, paree que le trait d'hifioire dont il
s'agit n'étant pas connu, il a fatlu toü t dire
~
que les
fairs en font compliqués ,
&
les noms memes inou is
pour le plus grand no
mbredes fp eétateurs . Elle
eíl_froide non-feulemelílt p.ar fa lenteur laborieufe,
mais par l'indifférence réci.proque des deux perfon–
nages qui font en fcene
~
lefquels ne font, ni l'un ni
l'autre, intéreifés dans
1
'aétion que comme íimples
confide ns. C'efr quelqtle chofe d,inconcevable que
la négligence q u'a mife le grand Corneille dans
l'ex •
pojition
d'une piece qu'il r egardoit comme fon chef–
d'renvre. Supérieur
a
tout dans les cho fes de génie,
il efi to ujours·an-deífous de lui-meme dans tout ce
qui n'efi qu e de l'arr.
La célébrité d'un fu jet en rend
1'
expofition
infi...
niment plus fimple
&
plus facile: aux noms d'fphi–
génie , d'CIEdipe, de Didon, de Céfar , de Brutus,
on fait d'avance, non-feulement, quels. font les ca–
raB:eres, mais quels font les antécédens & les 1·ap–
p9rts de l'aa.ion. Voyez de combien de détails Ra–
cine a été difpenfé dans
l'expofition d'lplzigénie,
par
la connoiífance qu'on avoit déja de l'enlévement
cl'Hélené
~
du ferment fait de venger fon époux, de
ce qu'étoient Achille, Ulyífe , Agamemnon; de ce
qu'étoient
P~ris
&
Troye;
&
fuppofé que cette
fable eut été de l'invention du poete ' ou qu'il en
efn pris le fu jet dans quelque hiftorien obfcur, con–
cevez dans qttel embarras l'efit mís cet expofé de
l'avant-fcene. Lorfqu'une aél:ion n'efi pas célebre
~
il fant qu'elle foit claire
&
frappante par elle-me–
me,
&
que les perfonnages qu'on
y
emploie aient
un caraétere fi marqué, qu'a la premiere vue ils laif·
fent leur empreinte dans les efprits.
L'a ion comique ne fauroit avoit des rapports
é!ojgnes : c'efr communément
d~ns
le cercle d'une.
fociété, d'une famille qu'elle fe paife ; & par con–
{'équentl'expofition
n'en efi jamais bien clifficile. Les
intérets domefiiques, les qualités, les affeélions, les
inclinations particulieres
~
qui en font les mobiles
&
les reíforts, nous font tous familiers; un feul mot
les indique, une fcene nous rnet au fait, Dans le
comique meme cependant on voit peu.
d'e-x:poji–
tions
ingénieufes: on cite avee raifon comJne un mo–
dele rare , eelle du
T
artujfi
,
a
coté de laquehe on
peut rnettre celle du
Mij'antrope,
celle de
l'Ecole
d es·
maris ,
& celle du
Malade imaginaire,
plus
original~
pent-etre encere
&
plus comique.
Dan cette partie, comme dans toutes les autres ;
il fant avouer que Moliere eíl bien fupérieur ame
anciens. Cenx-ci n'ernployoient aucun art dans
l'ex–
pofition
de leurs comédies: tantot c'étoit un monolo-.
gue oifeux , tantot un prologue adreífé au partetre.;.,
comme dans les
Guépes
d'Arifiophane, ott l'un des.
aéteurs annonc;oit au public ce qu'il alloit
voir.
Cette.
maniere, la plus commode fans doute, mais la moins
adroite , fut apparemment celle de Cratinus
&
de
Ménandre, puifque Plaute
&
Térence, leurs imira–
teurs, l'adopterent. Nos poetes comiques,
a
leurs.
exemples , ñrent ufage dtt prologue , avant d 'avoir
appris
a
faire mieux;
&
Moliere en traitant l'uri des
fujets de Plaute , n'a pas dédaigné de prendre de
luí cette maniere d'expofer; mais gue l'on
compa~e.
le dialogue de Mercure
&
de la Nmt dans le cotru–
que
fran~oi~,
avec le fimple récit de Mercure
dap~ 1~
















