
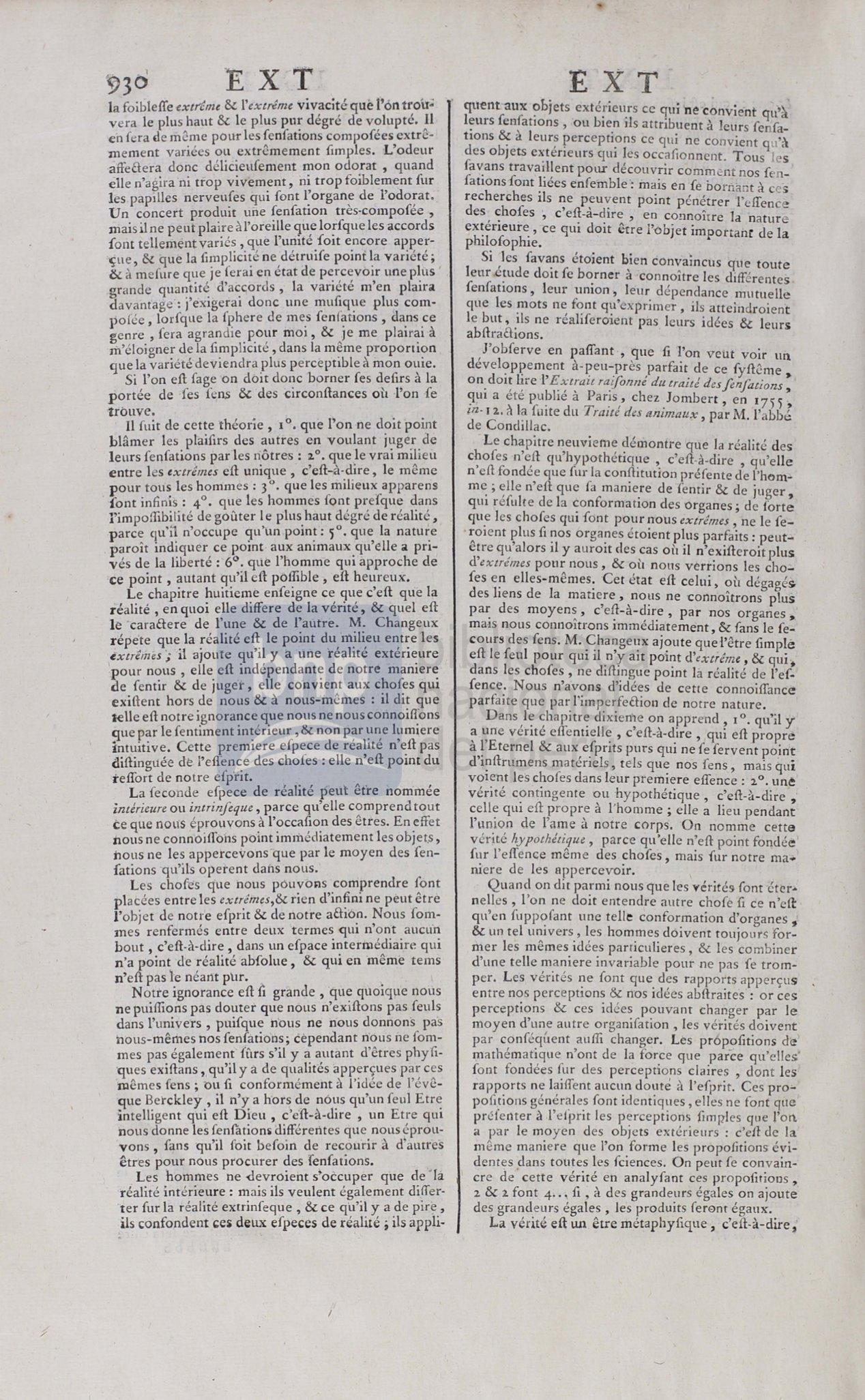
/
~3o
E
X
T
la
foibieffeextlime
&
l'extrime
vivaeitéque l'ón tro'it,;;
vera le plus haut
&
le plus
pu~
dégré de v?lupté.
!l
en[, ra de
m
eme pour les fenfatiOns compofees extre–
rnement variées
Oll
extremement fimples. ·L'odeur
affeB:era done délicieufement mon odorat , quand
elle n'agira ni trop vivement, ní trop foiblement fur
les papilles nerveufes qui font
l:organ~
de
l'odo~at.
Un concert produit une
~enfanon
tres-compofee ,
maisil ne peut
plai.r~
al'
orel~le
qu,e
lo~fque
les accords
font tellement vanes , que
l
umte Ío1t eneo re apper–
~ue,
&
qué la
fimplici~é ne,dét~uife poin~ ~a
variété;
&
a
mefure que je {eral en etat de percevoir une plus
grande
qua~tit~ . cl'~~corels
, la variété m'en plaira
davanfage·: J'eXIgerai done une mufiq:1e .plus com–
l)o{ee
lorfque la fphere ele mes fenfatlOnS, oans ce
genre ', fera agrand1e.
p_O~lr
inoi,
&
)e
me
plair~i
a
m'éloi<rner de la fimphctte, elans la meme proporuon
que la
~ariété
devienclra plus perceptible a mon ouie.
Si 1'on eft fage on doit done borner fes deúrs a la
portée de fes
{¡
ru
&
des ·eireonfiances
Ott
·l'on fe
tróuve.
,
•
.,
.
.
11 fuit de eette theone,
1°.
que 1on ne do1t pomt
bH1mer les. plaifirs des
-~u
tres
e~
voulant Ít;-ge_r.
él
e
leurs feqfauons par les notres :
2
•
que le vrat mtheu
entre les
extrimes
efr unique; c'efr-a-dire' le meme
pour tous les horrimes : 3
o.
que les milieux apparens
{ont infinis: 4°. que les hommes font prefque dans
l'impoffibilité de gouter 1e plus haut dégré de réalité
~
paree qu'íl n'occupe 9u'un
poin~:
5°.
qu~
la
natu~e
. paroit incliquer ce pomt ame anrmaux qu elle a pn–
vés de la liberté : 6°. qüe l'homme qui ápproche de
ce point , autant qu'íl efi póffible, eft heureux.
Le chapitre huitieme enfeigne ce que c'eft que la
réalité , en quoi elle differe de la vérité,
&
quel eft
le
·caraB:ere de l'une
&
de l'aütre. M. Changeux
répe"te que. la !éalité
e~
le
~oi_nt
d_u,
m_il~eu e~t~e
les
¿xtremes;
11 a¡oufe qu Il
y
a une reahte exteneure
'.pour nous , elle efi
indépendant~
de
notr~ mani€r~
de fentir
&
de juge·r, ell,e
co·avi.e~t
aux
c~o~es
qUI
exifient hors de nous
&
a nous-memes : 1l dlt que
telle efi notre ignoranee que nous ne nous connoia:-ons
que par le fentiment in!érieur,
&
non
p~r ';~e l~m1ere
intuitive. Cette prem1ere efpece de reahte n eft pas
difiinguée de l'eífence des chofes: elle n'eft point du
teífort de no tre efp'rit.
La feconde efpece de réalité peut etre hommée
intérieure
ou
intrinfeque,
paree qu'elle comprend tout
te que nolfS ép_rouvons_a
l'?cc~~o_n
des ettes. En _effet
nous ne connóiífohs point Immecliatement les ob¡et.s,
nous ne les appercevonsque par le moyen des fen–
fations -qu'ils opetent clañs nous.'
Les chofes que nous póu
vo~s
comprendre font
placées entre les
ext~emes,&
ríen d'in?ni ne p€ut etre
l'objet de notre efpnt
&
de notre aB:10_n.
~ous fo~mes renfermés entre deux termes
qlll
n ont aucun
bout c'eft-a-elire dans un efpace intermédiaire qui
'
'
•
1\
n'a p0int ele ·réalíté abfolue,
&
qut en
in
eme tems
n'eft
pas
le néartt pur.
.
.
Notre ignorance eft
ii
grande , que qu01que nous
ne puiffions pas douter que nous n'exifions pas feuls
dans l'univers , puifque hous ne nous donnons pas
nous-memes nos fenfátions; éepenclant nous ne fom–
mes pas également {fus s'il y a autant d'etres pbyú–
ques exiftans ,,qu'il y a de qualités appen;ues par ces
memes fens;
t>U
fi conformément a l'iclée de l'éve–
que Berckley, il
n'y
a
h'or~ ~e nó~s
qu'un feul
Etr~
intelligent qui efi Díeu , c'efi-a-d1re , un Etre qut
nous donne les f.eniatiom différerites que nous éprou–
vons
fans ·qu'il fuit befoin de recourir a d'aurres
etres
~our
nous procurer des fenfa tíons.
Les hommes ne <levróient
s~occuper
que de
#Ta
réalité intérieure: mais ils veulent également
diífer~
ter fur la réalité exrrinfeque,
&
ce qh'il y a de
pir~ ,
ils 'onfondent
~e¡
deux efpe,es de réalité; ils appli-
E X
T
~
qttent·ctux
?bjets exté!·ieu_rs ce qui
ne ·c~nvient
qu;a
~~llfS
fel'l[atlOnS,
OU
bte.n
Ils
attribuent
a
leurs fenfa–
tlOnS
~
a
leurs percepuons ce qui ne convient q
1
'a
des ob¡ets extérieurs qui les occafionnent. Tous
1
s
fa~ans trava~llent
pour découvrir comm nt nos
fe _
fatiOns{ont hées enfemble ': mais en fe borrüit tace
recherches ils ne peuvent point pénétrer 1
elien
e
des,
~hofes
, c'eft-a-dire , en connoirre 1a natur
ex~eneur~,
ce qui doit etre l'objet irnportanc de la
ph1lofoph1e.
Si
,Jes
fava.nsétoient bien convaincus
que
toute
lenr etude dott fe borner
a
·connoitre les différentes
fenfations, leur union, leur dépendance mutuelle
que les mots ne font qu' xprimer , ils atteindroient
le but, ils ne réalíferoient pas leurs iclées
&
Ieurs
abfiraB:ions.
·
J'obferve en paífant ·, que fi I'on veut voir un
dével<;>pJ.>em;nt
a-~eu-:rres
,Parfait de ce (yfieme:.
on dott lire
1
Extrau raifonne du traité desfen[ations
qui a été publié a Paris, chez Jombert
en 175
5:
in.¡
2.
a
la fui te du
Traité des animaux,
p;r
M.
l'abbé
de Condillac..
Le chapitre neuvietne démontre que la réalité des
chofes n'efi qu'hypothétique , c'efi-a-dire
qu'elle
n'e:ll: fondée que fur l
a confiitution préfente de l'hom–
m~; ~lle
n'efi que fa
manie.rede fentir
&
de juger,
qm refulte ele la
~onformat10n
des organ·es; de forte
que les chofes qm font pour nous
extremes
ne le fe–
roient plus finos organes étoient plus parf;its: peut–
etre qu'alors il
y
auroit des cas O
ti
il n'exifieroit plus
d'e xtrémes
p-onr nous,
&
oir nons verrions les cho.:.
fes
e~
elles-memes.
Cet
état eft celui,
0~1
dégag 'S.
des hens de la matiere
~
nous ne -connoitrons plus
PCU: des
moyen~, c'e~-a-~ir.e
, par nos organes
~,
ma>~s
nous conno1trons rmmedtatement,
&
fans le fe..
cours des fens. M.
~ha?ge~x
aj?ute quei'etre fimplé
eft le fenl pour qm il_n
y
ait po1nt
d'extréme,
&
qui •
dans les chofes, ne d1fimgue point
la
réalité de l'ef–
fence. Nous n'avons d'idé"es de cette connoiífance
parfaite que par l'imperfeB:ion de notre nature.
Dans le chapitre dixieme on apprend, r
0 •
qu'il
y
~ ~rre
véúté
eifentiell~
, c'efi-a-el_ire , qui efi propre
a} Eternel
&
aux,e[pnts purs qm ne fe fervent
po_in~
d I?firumens matenels, tels que nos fens, ma1s qut
vo1ent les chofes dans leur premiere eifem::e :
2
°.
une
vérité contingente ou hypothétique, c'efi-a-dire ;
celle qui efr propre a l'homme;
elle
a lieu pendant
l'union de l'ame
a
notre corps. On nomme cette
vér-¡r.é
hypotlzétique,
paree qu'elle n'eft point fonclée
fur l'eífence meme des chofes' mais fur notre ma.
niere de les appercevoir.
,
Quand on dir parmi nous que les vérités font ·éter...
nelles, l'on ne doit entendre autre chofe
:fi
ce n'eft
qu'en fuppofant une telle conformation d'organes.,
&
un tel univers, les hommes dóivent toujo urs for–
mer les memes idées parriculieres'
&
les combiner
d'une telle maniere invariable pour ne pas fe trom–
per. ·Les vérit 's ne font que des rapports
appers;u~
entre nos pereeptions
&
nus idées abíhaites : orces
perceptions
&
ces idées pouvant thanger par le
rnoyen d'une antre organifation., les vérités doivent
par conféqúent auffi changer. Les própofitions de
marhémariq ue n'ont de la force que par-ce qu'elles:
font fondées fur des perceptions claires , dont les
rapports ne laiífent aucun doute
a
l'efprit. Ces pro""
pofi tions générales font identiques, elles ne font que
préfenter
a
.l'eiprit les perceptions !imp.les que l'on
a par le moyen eles objets extérieurs :
c'eft
ele la
meme maniere que l'on forme les propofitions évi–
dent~s
_elans toutes les fciences. On peur fe convain–
cre de cette vérité en analyfant ces propofirioos
~
2
&
1
font 4· .. fi '
a
des graneleurs égales on ajoute
des grandeurs égales, les produits ferenr égaux.
La vérité eíl un etre métaphyúque, c'efi-a-dire,
















