
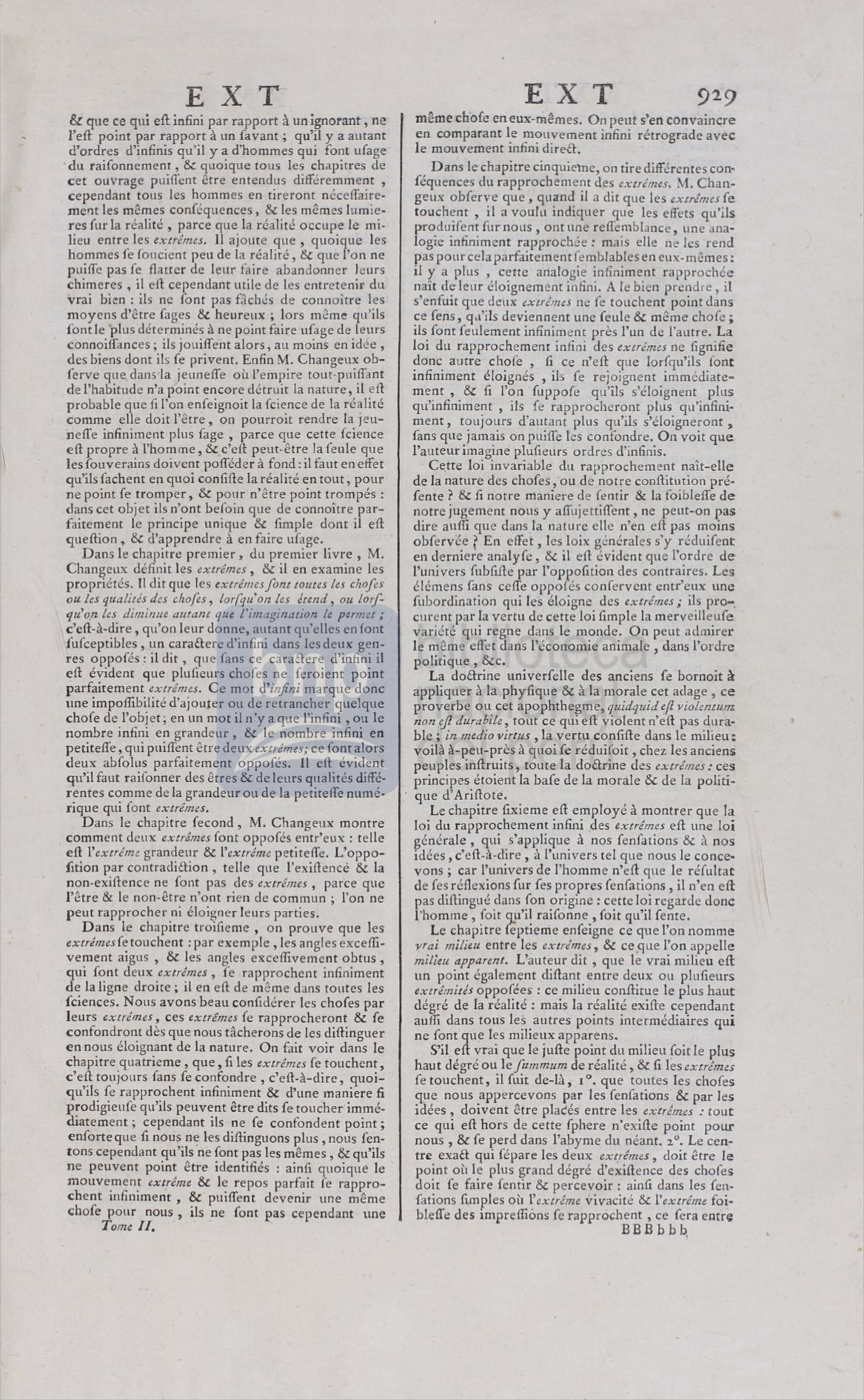
EXT
&
que ce qui eíl: infini par rapport
e\
un ignorant, ne
l'eft point par rapport
a
un favant ; qu'il
y
a autant
d'ordres d'infinis qu'il y a d hommes quí font ufage
du raifonnement , & quoique tous les chapitres de
cet ouvrage puiífent etre entendus différemment '
cependant tous les hommes en tireront néceífaire·
me'1t les memes con{¡' quences,
&
les memes }umíe–
res fur la réalité, paree que la réali té occupe
le
mi–
lieu entre les
~xtrémes.
11 ajoute que , quoique les
hommes fe foucient peu de la réaliré,
&
que l'on ne
puiífe pas fe flatter de leur faire abandonner Jeurs
chimeres
~
il efi cependant utile de les entretenir du
vrai bien : ils ne font pas fachés de conno1tre les
moyens d'etre fages & heureux ; lors meme qu'ils
font le "plus déterminés
a
ne point faire ufage de leurs
connoiífances; ils jouiífent alors, au moins en idée ,
des biens dont ils fe privent. En fin M. Changeux ob–
ferve que dans la jeuneífe ou l'empire tout-puiífant
de l'habitude n'a point enc0re détruit la nature, il eft
probable que fi l'on enfeignoit la fcience de la
ré~lité
comme elle doit l'etre, on pourroit rendre la Jeu–
neífe infiniment plus fage ' paree que cette fcience
eft propre a l'homme'
&
c'eft peut-etre la fe ule que
les fouverains doivent poíféder
a
fond: il fant en effet
qu'ils fachent en quoi confifie la réalité en tout, pour
ne point fe tromper,
&
pour n'etre point trompés :
dans cet objet ils n'ont befoin que de conno1tre par–
faitement le príncipe unique
&
fimple dont il eft
queftion ' & d'apprendre
a
en faire ufage.
Dans le chapitre premier, du premier livre, M.
Changeux définit les
extrémes,
&
il en examine les
propriétés. Il dit que les
extrémes font torues les chafes
o
u les qualités des chafes, lor{qu'on Les Üend, ou lorf–
qu'o.n les diminue autant que l'imagination le permet;
c'eft-a-dire, qu'on leur donne, autant qu'elles en font
fufceptibles, un caraétere d'infini daos les deux gen–
res oppofés: il dit , que fans ce caraétere d'infini il
eft évident que pluíieurs chofes ne feroient point
parfaitement
extremes.
Ce mot
d'infini
marque done
une impoffibilité d'ajouter ou de retrancher quelque
chofe de l'objet; en un motilo
'y
a que l'infini , ou le
nombre infini en grandeur, & le nombre infini en
petiteífe' qui puiífent erre deux
extrémes;
ce font alors
deux abfolus parfaitement oppofés. 11 eft évident
qu'il faut raifonner des etres & de leurs qualités diffé–
rentes cornme de la grandeur ou de la petiteífe numé–
rique qui font
extrémes.
Dans le chapitre fecond , M. Changeux montre
comment deux
extremes
font oppofés entr'eux: te!le
eft
l'extréme
grandeur
&
l'extréme
petiteífe. L'oppo–
:fition par contradiétion, telle que l'exifience
&
la
non-exifience ne font pas des
extremes
,
paree que
l'etre
&
le non-etre n'ont ríen de commun ; l'on ne
peut rapprocher ni éloigner leurs parties.
Daos
le
chapitre troiíieme , on prouve que les
extrémesfetouchent:
par exemple, les angles exceffi–
vement aigus ,
&
les angles exceffivement obtus,
qui font deux
extrémes,
fe rapprochent infiniment
de la ligne droite; il en efi de meme daos toutes les
fciences. Nous avons beau confidérer les chofes par
leurs
extrémes,
ces
extrémes
fe rapprocheront
&
fe
confondront des que nous tfi.cherons de les difiinguer
en nous éloignant de la nature. On fait voir daos le
chapitre quatrieme, que,
íi
les
extrémes
fe touchent,
eefi tonj-ours fans fe confondre ' c'efi-a-dire' quoi–
qu'íls fe rapprochent infiniment
&
d'une maniere
fi.
prodigieufe qu'ils peuvent etre dits fe toucher immé–
diatement; cependant ils ne fe confondent point;
enforte que fi no
u$
n~
les diftinguons plus, nous fen–
tons cependant qu'ils ne font pas les memes'
&
qu'ils
ne peuvent point etre identifiés : ainfi quoique le
mouvement
extréme
& le repos parfait fe rappro–
cbent infiniment,
&
puiífent devenir une meme
chofe pour nous , ils ne font pas cependant
1.meTome 11.
EXT
m~me
chofe eneux-memes. On peut s'en convaincre
en comparant le mouvement infini rétrograde avec
le mouvement infini direél.
Dans le chapitre cinquieme, on tire différentes con
féquences du rapprochement des
extrémes.
M. Chan–
geux obferve que , quand il a dit que les
extrémes
fe
touchent , il a voulu indiquer que les effets qu'ils
produifent fur nous, ont une reífemblance, une ana–
logie infiniment rapprochée: mais elle ne les rend
pas pourcela parfaitementfemblablesen eux-memes:
il
y
a plus , cette analogi_e infiniment rapprochée
nait de leur éloignemenr infini. A le bien prend re, il
s'enfuit que denx
extrémes
n fe touchent point dans
ce fens' qu.'ils deviennent une feule
&
meme chofe;
ils font feulement infiniment pres l'un de l'autre. La
loi
du rapprochement infini des
extrémes
ne íignifie
done autre chofe ,
fi ce n'efr que lorfqu'ils font
infiniment éloignés , il
fe rejoignent immédiate–
ment ,
&
fi l'on fuppofe qu'ils s'éloignent plus
qu'infiniment , ils fe rapproch ront plus qu'infini·
ment, toujours d'autant plus qu'ils s'éloigneront
~
fans que jamais on puiífe les confondre. On voit que
l'auteur imagine pluíieurs ordres d'infinis.
Cette loi invariable du rapprochement nait-elle
de la nature des chofes, ou de notre coofritution pré·
feote
?
& fi notre maniere de fentir
&
la foibleífe de
notre jugement nous y aífujettiífent, ne peut-on pas
dire auffi que dans la nature elle n'eiJ eft pas moins
obfervée
~
En effet , les loix générales s'y réduifent
en derniere analyfe,
&
il eft évident que l'ordre de
l'univers fubfifte par l'oppoíition des contraires. Les
élémens fans ceífe oppofés confervent entr'eux une
fubordination qui les éloigne des
extrémes;
ils pro-.
curent par la verru de cette loi fimple la merveille.ufe
variété qui regne dans le monde. On peut adm1rer
le meme effet dans l'économie animale' dans l'ordre
politique , &c.
La doétrine univerfelle des anciens fe bornoit
a
appliquer a la phyfique & a la morale cet adage ' ce
proverbe ou cet apophthegme,
quidquidejl víolentum.
non
ejl
durabile,
tout ce qui efi violent n'eft pas dura•
ble ;
in
medio virtus
,
la vertu coníifie daos le milieu:
voila a-peu-pres
a
qnoi fe réduifoit 'chez les anciens
peuples infrruits, toute la doétrine d s
extrémes:
ces
príncipes éroient la bafe de la morale
&
de la politi–
que d'Ariftote.
Le chapitre fixieme efi employé a montrer que la
loi du rapprochement infini des
extrémes
eft une loi
générale ' qui s'applique
a
nos fenfations
&
a
nos
idées' c'eft-a-dire'
a
l'univers tel que nous le conce·
vons; car l'univers de l'homme n'efr que le réfultat
de fes réflexions fur fes propres fenfations, il n'en eft
pas difiingué daos fon origine : cette loi regarde done
l'homrne, foit qu'il raifonne, foit qu'il fenre.
Le chapitre feptieme enfeigne ce que l'on nomme
yrai milieu
entre les
extrémes,
&
ce que l'on appelle
milieu.
apparent.
L'auteur dit , que le vrai milieu efl:
un point également diftant entre deux ou plnfieurs
extremités
oppofée.s : ce milieu conilitue le plus haut
dégré de la réalité : mais la
r~alit~
exiíl:e,
c.ependan~
auffi daos tous les autres pomts mtermedia1res qu1
ne font que les milieux apparens.
S'il eft vrai que le jufte point du milien foit le plus
haut dégré ou le
fummum
de réalité,
&
fi
les
extrémes
fe touchent, il fuit de-la,
1°.
que toutes les chofes
q_ue nous appercevons par les fenfations
&
par les
idées ' doivent etre placés entre les
extremes :
tout
ce qui eft hors de cette fphere n'exifie point pour
nous,
&
fe perd dans l'abyme du néant.
2°.
Le cen–
tre exaa qui fépare les deux
extrémes'
doit etre le
point o1tle plus grand dégré d'exiftence des chofes
doit fe faire fentir & percevoir : ainíi daos les fen–
fations fimples ou
l'extdme
vivacité &
l'extréme
foi·
bleife des impreffións fe rapprochent , ce fera
entr~
BBBbbb
















