
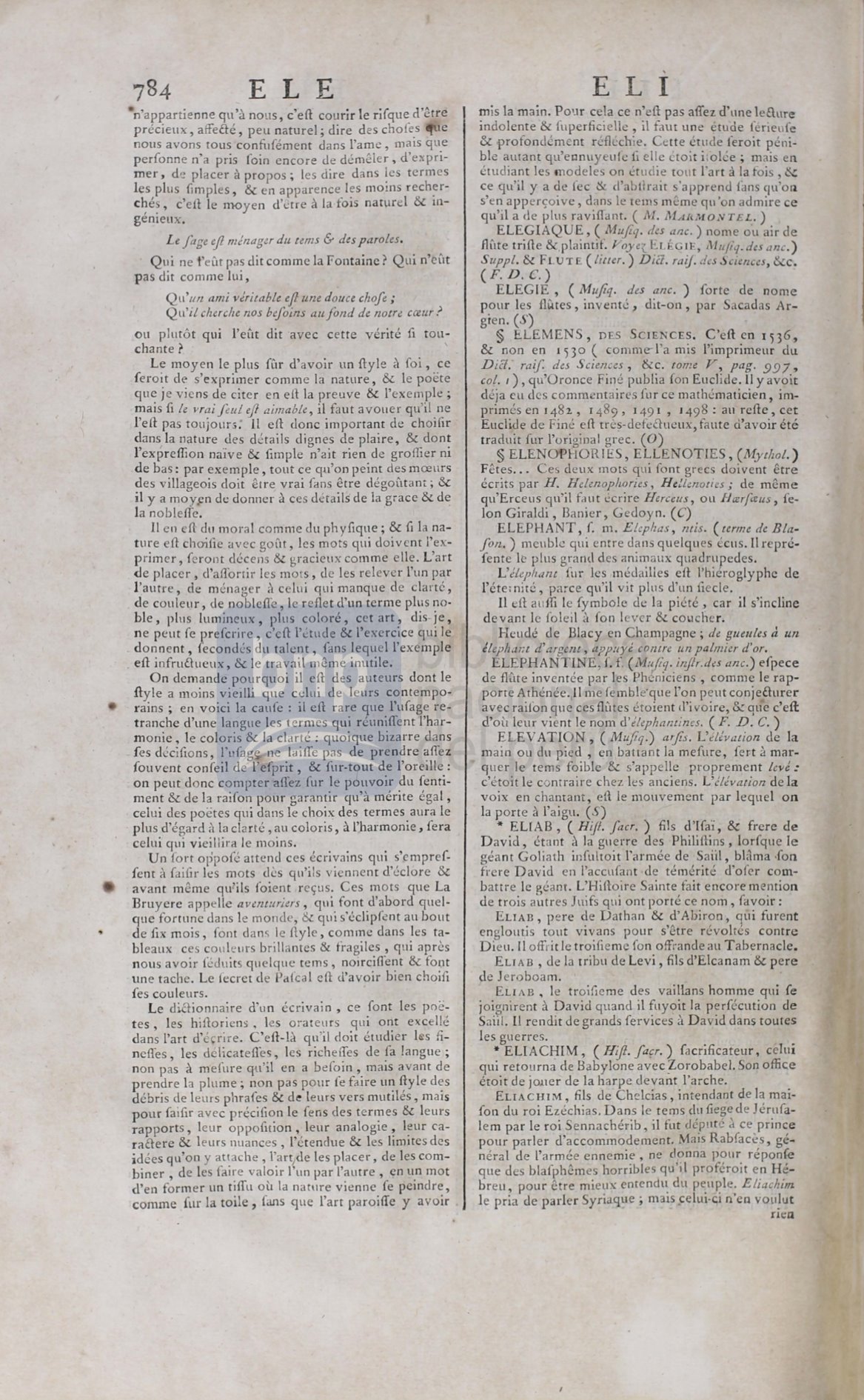
EL E
n'appartienne qu
'a
nous, c'efr courir le rifque d'etre
précieux, affeB:é, peu naturel; dire des chofes
te
nous avons tous confufément dans
1
ame, mais que
perfonne n'a pris foin encore de dém "ier, d,expri–
rner, de placer
a
propos; les dire dans !es termes
les plus fimples,
&
en apparence les moms recher–
c~é.
' c'efi le moyen d'etre
a
la fois nat\lrel
&
in–
gemeux.
Le fage
ejl
ménagtr du tems
&
des paroles.
Qui ne
t'eut
pas die comme la Fontaine? Qui n'eí'tt
pas dit comme lui,
Qu'un ami vüitable ejl une douce chofe;
Qu'il cherche nos befoins au fond de notre cczur?
ou plurot qui l'etit dit
·avec
cette vérité
fi
tou–
chante?
Le moyen le plus
fUr
d'avoir un fiyle
a
foi, ce
feroit dE' s'exprimer comme la nature,
&
le po..te
qu~
je viens de citer en efi la preuve
&
l'exemple;
ma1s
file
vrai flul
efl
aimable,
il faut avouer qu'il ne
l'efr pas toujours.
il
eO: done importanr de choi(ir
dans la nature des d
1
tails dignes de plaire,
&
dont
l'expreffion na!ve & fimple n'ait rien de groffier ni
debas: par exemple, tout ce q.u'on peint des mcenrs
des
i
llageoisdoit erre vrai fans etre dégotttant;
&
il
y
a
moy.ende donner
a
ces détails de la grace
&
de
la nobleífe.
Il en eft du moral comme
el
u ph yfique;
&
fila na–
tu re eO: chai.fie avec goftt, les mo s qui doivent l'ex–
primer, feront décens & gracieux comme elle. L'art
<fe placer, d'aíforrir les mots, de les relever l'un par
I'.aun·e' de ménager
a
celui qui manque de clarté'
de couleur, de nobleífe, le reflet d'un terme plus no–
ble, plus lumineux, plus coloré, cet art, dis-je,
ne peut fe prefcrjre, c'eíl: l'étude & l'exercice qui le
donnent, fecond és du talent, fans lequell'exemple
eft infruélueux'
&
le travail meme inutile.
On demande pourquoi il eft des auteurs dont le
ftyle a moins vieilli que celui de leurs contempo–
rains ; en voici la caufe : il eft rare que l'ufage re–
tranche d'une langue les termes qui r 'u niífent l'har–
rnonie, le coloris
&
la clarté : quoique bizarre dans
fes d 'cifions,
1\
fag~
ne laiífe pas de prendre aífez
fouvent confeil de l'efprit,
&
fnr-tqut de l'oreille:
on peut done compter aífez fur le pouvoir du fenti–
ment
&
de la raifon pour garantir qu'a mérite égal,
celui des poetes qui dans le choix des termes aura le
plus d'égard
a
la clarté 'au coloris'
a
l'harmonie' fera
celui qui vieil lira le moins.
Un fort oppofcl attend ces écrivains qui s'empref–
fent
a
faiíir les mots des qn'ils viennenr d'éclore
&
avanr meme qu:ils foient res:us. Ces mots que La
Bruyere appelle
aventuriers,
qui font d'abord quel–
que fortune daos le monde,
&
qui s'éclipfent au bout
de fix rnois, font daos le ftyle , comme daos les ta–
bleaux ces couleurs brillantes
&
fi·agiles , qui apres
nous avoir íeduit qnelque rems, noirciífent
&
font
une tache. Le (ecret de Pafcal eft d'avoir bien choifi
fes couleurs.
Le di.c1:ionnaire d'un écrivain , ce font les poe–
tes , les hifioriens • les orareurs qui ont excellé
daos l'art d ' rire. C'efi-la qu'il doit étudier l&s
fi–
nefies, les délicatefies, les richeífes de fa langue ;
non pas
a
rnefure qu'il en a befoin, mais a ant de
prendre la plume; non pas pour fe faire un fiyle des
débris de leurs phrafes
&
de leurs vers mutilés, mais
pour faiíir avec
pr~cifion
le fens des termes
&
leurs
rapports, Ieur oppoútion, leur analogie
~
leur ca–
raélere
&
leurs nuances,
1'
' tendue & les limites des
id
1
es qu'on
y
at~ache,
l'.art
1
de les placer, de les com–
biner , de les fa1re valotr lun par l'autre , en un mot
d'en former un tiffu ou la na ure vienne fe peindre,
comme fw· la toile, fans que l'art paroiíie
y
avoir
EL 1
mis la main. Po'Jr cela ce n'
ft
pas atfez d\me leé\.ure
indolente
&
fuperfi 1elle
il
t
ut
une
tude
f
net fe
&
profon
l l
m nt n:flechie.
ette étude feroit p ' ni–
ble amanr qu'eom yeufc
11
ell
toit
i.ol·e ; mais en
étudjant les
odele on érudie tOllt rart aJa
fois
&
ce qu'il
y
a de fec
&
d'abitrait s'appreod fan
qu
on
s'en
apper~oive,
daos le tems m"me
qu'
n admire ce
qu'il a de plus raviífant.
(.M.
ALt.It.MONTEL.)
ELEGIAQUE, (
Mujiq. d s
arzc.)
nome ou
air
de
flute trifie
&.plainri~
.
.Voyez.
~LÉG~
,
Mufiq.
d·s anc. )
Suppl.
&
FLUT E
e
luter.) Dlél. raij. des Sciencu,
'C.
(F. D. C.)
ELEGIE , (
Mujiq.
des anc.
)
forte de nome
pour les flQres, inventé, dit-on, par
cadas Ar-
gren. ( )
§
ELEMENS, DES SciENCES. C'efi en
1
536,
&
non en
1530 (
comme-l'a mis l'imprimeur du
Diél.
raif des Scien
es ,
&c.
tome
V,
pag.
997,
col.
1),
qu'Oronce Finé publia fon Euc1ide . ll y avoit
d
lja e
u des commentair
fur ce math
1
rnaticien, im–
primés en 1482 ,
I
489 ,
I
491 ,
J
498 : au refie, cet
Eucli.dede Finé eft tres-defeB:ueux, faute ci'avoir été
traduit fur !'original grec.
(O)
§
ELENOPHORJES, ELLENOTIES,
(Mythol.)
Fetes... Ces deux mot qui foot grec doivent erre
écrits par
H.
Helenoplwries'
HetLenoti
S;
de meme
qu'Erceus qu'il faut ¿crire
Herceus,
ou
H(/!.rf(l!.us,
fe–
Ion Giraldi , Banier, Gedoyn. (
C)
ELEPHANT,
f.
m.
Elephas,
mis.
e
terme deBla–
fon.)
meublc quí entre dans quelques
1
cus. I1 repré–
fente le plus granel de animaux quadrupedes.
L'élephant
fur les médailles efi: l'hiéroglyphe de
l'éte¡njté, paree qu il
vit
plus d'un úecle.
Il eft auffi le fymbole de la piété, car il s'incline
de vant le foleil
a
fon lever
&
couclier.
Heudé de Blacy en Champagne ;
de gumles
á
un
élephalil d'
argent, appuyé contre un palmier
d'
or.
ELEPHANTINE,
f. f. (
Mufi.q.
injlr.des anc.)
efpece
de fl{'tte inventée par les Pheniciens , comme le rap–
porre Athénée.
1
rl
me femble·que l'on peut conjeélurer
avec raifon que ces flutes étoient d'i voire,
&
que c'eft
d'oú leur vient le nom
d'élephanúnes.
(F. D. C.)
ELEVATION, (
Mujiq.) arjis. L'élévation
de la
main ou du pied ' en battant la mefure, fert
a
mar–
quer le terns foiblc
&
s'appelle proprement
levé:
e'' toit le comraire chez les ancien . L'
élévation
de la
voix en chanrant, ea le mouvement par lequel on
la porte
a
l'aigu.
(S)
*
ELlAB, (
Hifl.
facr.
) fils d'Ifa!,
&
frere de
David, étant
a
Ja guerre des Philifiins, lorfque le
géant Goliath infultoit l'armée de Saiil, blama ·fon
frere David en l'accufant de témérité d'ofer com–
battre le géant. L'Hifroire Sainte fait encore mention
de trois autres Jnifs qni ont porté ce nom, favoir:
ELIAB, pere de Dathan
&
d'Ahiron, qui furent
englouüs tout vivans pour s'etre révoltés contre
Dieu.
Il
offrit le troifieme fon offrande au Tabernacle.
E
u
AB ,
de la tribu de Levi, fils d'Elcanam·
&
pere
de Jeroboam.
ELIAB, le troifieme des vaillans homme qui fe
joignirent
a
David quand il fuyoit la perfécution de
Saill. I1 rendit de grands fervices
a
David daos toutes
les guerres.
*
ELIACHIM,
e
Hift.
facr.)
facrificateur, celui
qui retourna de Babylone avec
~oro
babel. Son offic.e
étoit de jo.uer de la harpe devant l'arche.
ELIACHIM, fils de Chelcias, intendant de la mai–
fon du roí Ezéchias. Daos le teros du úege de
J
érufa–
lem par le roi Sennachérib, il fut dépnté
a
ce prince
pour parler d'accommodement. Mais Rabfaces, gé–
néral de l'armée ennemie, ne doona pour réponfe
que des blafphemes horribles qu'1l proféroit en Hé–
breu, pour erre mieux
enrend1~
du peuple.
Eliachim
le pria de parler Syriaque; ma1s celui-ci n,en vou!u t
nta
















