
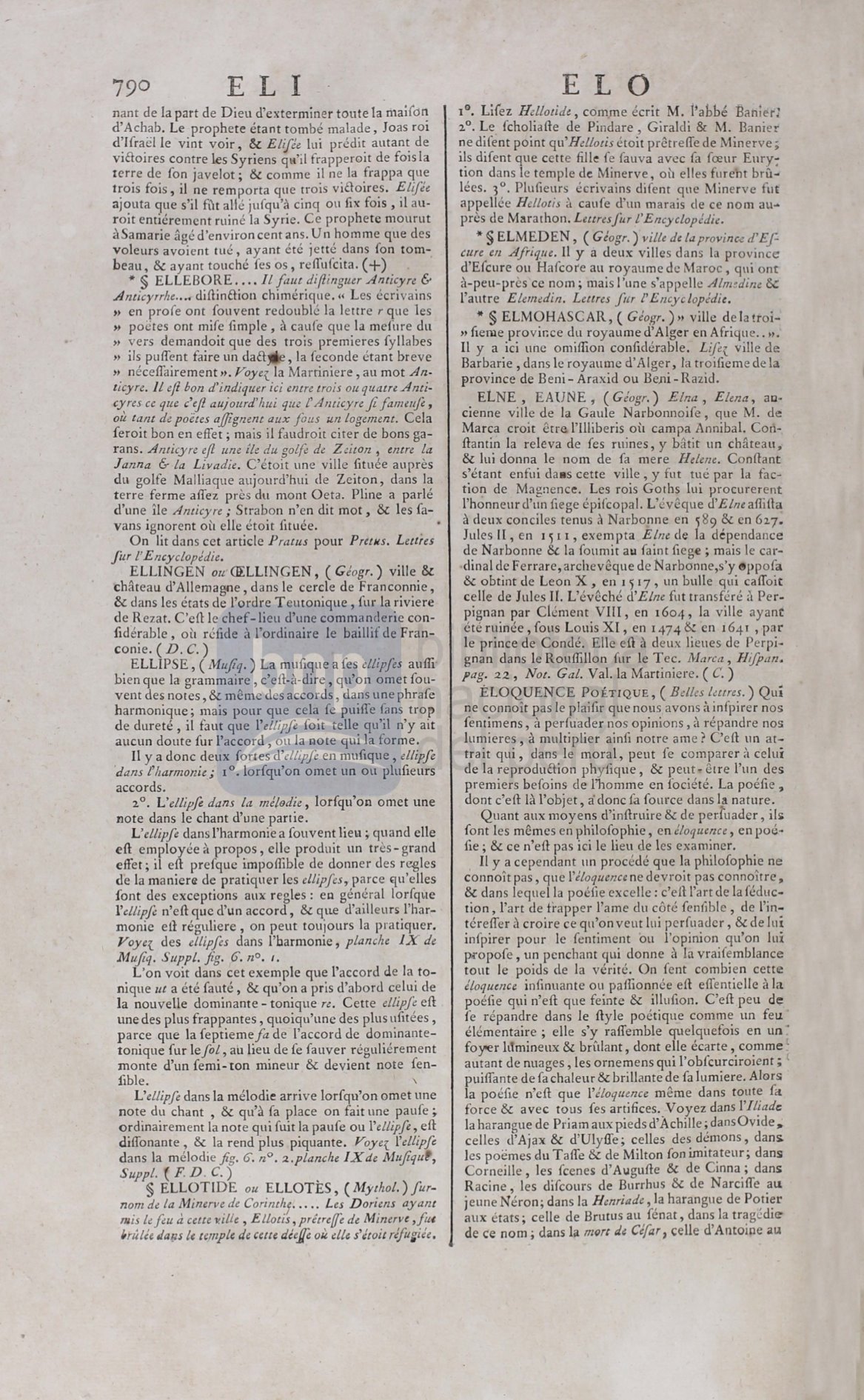
EL 1
naot de la part de Dieu d'extermioer toute
la
mai(dn
d'Achab. Le prophete étant tombé malade, Joas roí
d:Ifr~el
le vint voir,
&
Elifée
lui
prédi~ autao~
de
VIél:o1res contre les Syriens qa'il frapper01t de fo1s la
terre de fon javelot; & comme il ne la frappa que
t~ois
fois,
il
ne re
m
porta que trois viél:oires.
Elifée
a;outa que s'il fUt aHé jufqu'a cinq ou fi.x fois , il au–
roit entiérement ruiné la Syrie. Ce prophete mourut
aSama-rie
agé
d'environ cent ans. Un homme que des
voleurs avoient rué, ayant été jetté dans fon tom–
beau,
&
ayanr touché fes os, reífufcita. (
+)
*
§
ELLEBORE ..•.
ll
faut d{fiinguer Anticyre
&
Anticyrrhe.. ..-
difrinél:ion chimérique.
H
Les écrivains
)>
en pro(
e
ont fouvent redoublé la lettre
r
que les
»
poetes ont mife :íimple' a caufe que la mefure du
»
vers demandoit que des trois premieres fyllabes
»
ils puífent faire un daB: e, la fe conde étant breve
>>
néceífairement
H.
Voye{
la Marriniere, au
motAn–
ticyre.
ll
efl bon d'indiquer ici entre trois ou qttatreAnti–
cyres ce que
c'ejl
aujourd'lzui que L'Amicyre
Ji
fameufi,
ou
t~nt
de poites a.flignent aux fous
un
logement.
Cela
feroit bon en effet; mais il fdHdroit cirer de bons ga–
rans.
Anticyre
ejl
une lle du golfe de Zeiton, entre la
Janna
&
la Livadie.
C'étoit une ville fituée aupres
du golfe Malliaque aujourd'hui de Zeiton, dans la
terre ferme aífez pres du mont Oeta. Pline a parlé
d'une ile
Anticyre;
Strabon n'en dit mot,
&
les fa–
vans ignorent o1r elle étoit fituée.
On lit dans cet article
Pratus
pour
Pret~ts.
Lettres
Ju_r
l'
Encyclopédie.
ELLINGEN
ou
GELLlNGEN, (
Géogr.)
ville
&
chateau d'Allemagne, dans le cercle de Franconnie,
&
dans les érats de l'ordre Teutonique, fur la riviere
de Rezat. C'eíl: le chef-lieu d'une commaoderie con–
fidérable'
Otl
ré.fide
a
r'ordinaire le baillif de Fran–
conie.
(D. C.)
ELLIPSE, (
Mujiq.)
La mufique
a
fes
ellipfes
auffi
bien que la grammaire, c'efr-a-illre, qn'on omet fou–
vent des notes,
&
meme des accords, daos une phrafe
harmonique; mais pour que cela fe puiífe fans trop
de dure té,
il
faut que
1'
elLipfe
foit telle qu'il n'y ait
aucun doute fur l'accord, ou
la
note quila forme.
11
y a done deux fortes
d'ellipfe
en mufique,
ellipfe
'dans L'lzarmonie;
I
0
.lorfqu'on omet un ou pluíieurs
accords.
2°.
L'ellipfe dans la mé/edie,
lorfqu'on omet une
note
daos le chant d'une partie.
L'
ellipfe
dans l'harmonie a fouvent lielil; quand elle
eft employée
a
propos' elle produit un tres- grand
effer; il eíl: prefque impoffible de donner des re-..gles
de la
manier~
de pratiquer les
ellipfes,.
paree
~u'elles
font des exceptions aux regles : ea général lorfque
l'ellipfe
n'efr que d'un accord, &
ql~e
d'ailleurs l'har,–
rnonie efi réguliere, on peut toujours la pratiquer.
'Voye{
des
ellipfes
dans l'barmonie,
planche
IX
de
Mujiq. Suppl. jig.
6.
n°.
1.
L'on voit daos
cet
exemple que l'accord de lato–
nique
uta
été fauté,
&
qu'on a pris d'abord celui de
la nouvelle dominante- tonique
re.
Cette
ellipfe
efi:
une des plus frappantes, quoiqu'une des plus ufitées,
paree que la
feptiemefa
de l'accord de dominante–
toruque fur
lefol,
au lieu de fe fauver réguliérement
monte d'un femi- ton mineur
&
devient note fen-
fible.
"
L'ellipfe
dans la mélodie arrive lorfqu'on omet une
note du chant ,
&
qu'a fa place on fait une paufe;
ordinairement la nore qui fuit la paufe ou
l'ellipfe,
efi:
diífonante,
&
la rend plus piquante.
Voye{ l'ellipfe
dans la mélodie
fig.
6.
n°.
:z..planche
IX
de Mujiqu
,
Suppl.
(
F D . C.)
§
ELLOTIDE
ou
ELLOTES, (
Mythol.) fur–
nom
d~
la Minerve de Corinth¡...
..
Les Doriens ayant
mis
le
fiu
a
cette t!ille, Ellotis ,pretre/fe dt Minerve ,fut
[.rúlle dap.s te
te¡n.ple
de cette d¿ej[e olt elle
s'étoit rifugiée.
ELO
1°.
Li(ez
Hellotide ,
comme écrit M. 1'abbé
Banier~
2°.
Le fcholiafte de Pindare, Giraldi
&
M. Banier
ne difent point
qu'Hellotis
étoit pretreffe de Minerve–
i!s difent que cette
filie
fe fauva avec fa fceur Eury:
t10n dans le temple de Minerve
Otl
elles furenr bru--
1 ,
'
ees.
3
~. Plufie~rs, écrivai~s
difent que Minerve fut:
appellee
HellottS
a caufe d
un
marais de ce nom al-1-
pres de Marathoo.
Lettresfur L'Encyclopédit:.
*
§
ELM~DEN,
(
~éogr.)
v_ille de laprovinc.e
d'
EJ–
cure
e!l
Afru¡_z¡e.
Il
y a deux villes dans
la
province
d'E{cure ou Hafcore au royaume
de
Maroc, qni ont
a-peu-pres 'ce nom; mais
1
'une s'appelle
Alm::dine
&
l'autre
Elemedin. Lettres jttr
l'
Encyclopédie.
*
§
ELMOHASCAR'
e
Géogr.)
H
ville
de
la
troi–
»
fieme provicce du royaume d'Alger en Afrique.. "·
11
y a ici une omiffion confidérable.
LiJe{
-ville
de
Barbarie, dans le royanme d' Alger,
la
troifieme de
la.
province de Beni- Araxid o
u
Beni- Razid.
ELNE,
EA
UNE
1
(
Géogr.) Elna, Elena,
ac–
cienne ville de la Gaule Narbonooife, que M. de
Marca croit erre l'Illiberis oit campa Annibal. Coo–
ftantin la releva de fes ru1nes, y batit un chatea
u,
&
lui
donna le oom de
fa
mere
Helem.
Coníl:ant
s'étaot enfui dass cette ville, y fut tué par la fac–
tion de Magnence. Les rois Goths luí procurerent
l'honneur d'un fiege épifcopal. L' 'veque
d'ELne
affifra
a
deux conciles
tem.lSa
Narbonne en
~89
&
en
627·
J
u
les
li,
en
1
5
r
1,
exem pta
Elne
de la dépendance
de Narbonne
&
la fonmit au faint fiege; mais le car–
dinal de Ferrare, archeveque de :Narbonoe,s'y eppofa
& obtint de Leon
X ,
en
1
5
17 ,
un bulle qui caífoit
celle de Jules
11.
L'éveché
d'Elne
fut transféré
a
Per–
pignan par Clément VHI, en
1604,
la ville ayant:
été ruinée, fous Louis
XI,
en
1474
&
en
1641,
par
le prioce de Condé. Elle efi a deux lieues de Perpi-–
gnan dans le Rouffillon fur le Tec.
Marca,
Hifpan~
pag.
22,
Not. Gal.
Val. la Martiniere.
(C.)
ÉLOQUENCE
POÉTIQUE,
(Be/les Üttres.)
QuÍ
ne connoit pas le plai:íir que nous avons ainfpirer nos
fentimens'
a
perfu'ader nos opinions'
a
répandre nos
lumieres,
a
multiplier ainfi notre ame? C'efi
tm
at–
trait qui' dans le moral' peut fe comparer
a
celui
de la reproduél:ion phyfique'
&
peut- etre l'un des
premiers befoins de l'homme en fociété. La poéfie?
dont c'efr la l'objet,
a
done
f.a
fource dans la nature.
Quant aux moyens d'infrruire
&
de per-fuader,
il~
font les memes en philofophie, en
éLoquence,
en poéd
fie; & ce n'eft pas ici le lieu de les exarniner.
,
Il
y a cependant nn procédé que la philofophie oe
conno1t pas, que
l'éloquence
ne devroit pas conno1tre,
&
daos lequella poéfie excelle: c'eill'art de la féduc–
tion' l'art de trapper l'ame du coté fenfible' de l'in–
téreífer
a
croire ce qn'onveut lui perfqader' &de luí
infpirer pour le fentiment ou l'opiruon qu'oo lui
propofe' un pcnchant qui donne
a
la vraifemblance
tout le poids de la vérité. On fent combjen
cett~
éloquence
infinuaote ou paffionnée efr eífentielle
a
la
poéfie qui n'efr que feínte
&
illufion. C'efr peu
d~
fe répandre dans le fiyle poétique comme un feu
élémentaire ; elle s'y raífemble quelquefois en un ·
foy-er luminenx & brúlant, dont elle écarte, comme
autant de nuages, les ornemens qui l'obfcurciroient;
puiífante de fa chaleur
&
brillante de fa lumiere.
Alors
la poéüe n'efi que
l'éloquence
meme dans toute fa
force
&
a vee tous fes artífices. Voyez dans
l'Iliade
la harangue de Pr.iam aux pieds d'
A
chille; dansOvide,.
celles d'Ajax & d'Ulyífe; celles des démons, dan$.
les poemes clu Taífe
&
de Milton fonimitateur;
dan~
Corneille, les fcenes d'Augufie
&
de Cinoa; dans
Racine,. les difcours de Burrhus & de Narciífe att
jeune Néron; daos la
Henriade,
la harangue de Potier
aux états; celle de Brutus au fénar, dans la tragéille
de 'e nom; daos la
nwrt
de Céfar,
'elle d'Antoine au
















