
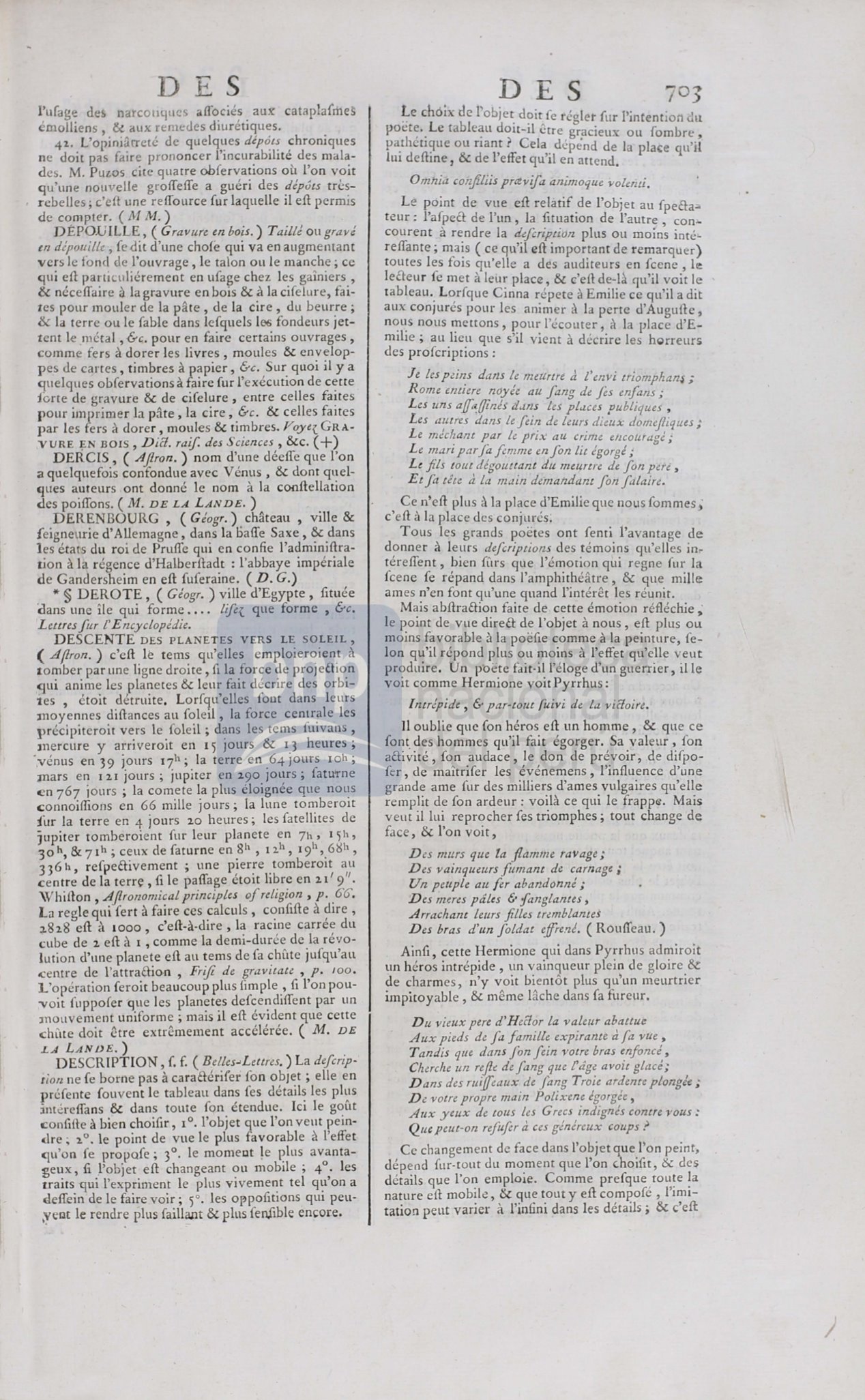
rufage deb narcouqncs aífoci
1
S
a
UK
cataplafme
1
molliens ,
&
aux remedes diurétiques.
42.
L'opinía rreté de quelques
dépóts
chroniques
ne doit
pas
faire prononcer l'incurabilité des mala–
des.
M.
PuLOS cite quarre obfervations ou l'on voit
qu'une nouvelle groífeífe a guéri des
d
épóts
tr '
s–
rebelles;
c'e {t
une reífource fur laquelle il e.fi permis
de compter. (
/ltllt1.)
DÉPOlJIL E, (
Gravure en bois.) Tailld
ou
gravé
en dtpouille ,
fe
<lit
d'une chofe qui va en augmentant
vers le fond de l'ouvrage, le talon ou le manche;
ce
qui efr particu líérement en ufage chez les gainiers ,
&
néceífaire
a
la gravure en bois
&
a
la cifelure, fai–
tes pour mouler de la pate , de la cire , du beurre ;
&
la
terre o u le fable dans lefquels le6 fondeurs jet–
tent le métal ,
&c.
pour en faire cerrains ouvrages ,
comme fers
a
dorer les livres' moules
&
envelop–
pes de cartes, timbres a papier,
&c.
Sur quoi il y a
qnelques obfervations a faire fur l'exécution de ceue
forte de gravure
&
de cifelure , entre cel1es faites
pour imprimer la pate, la cire,
&c.
&
celles faites
par les fers
a
dorer' moules
&
timbres.
Voye{
GRA–
VlJRE
~N
BOIS,
Diél. rai:f. des
ciences,
&c. (
+)
DERCIS, (
Af!ron.)
nom d'une déeífe que l'on
a
quelquefois confondue avec
V
énus ,
&
dont qtlel–
(]Ues auteurs ont donné le nom
a
la conftellation
des poiífons.
(M.
DE
LA
LANDE.)
DERENBOURG , (
Géogr.)
ch~teau
, ville
&
feigneurie d'Allemagne , dans la naífe Saxe ,
&
dans
les éta
s
du roí de Pruífe
qui
en confie l'adminifrra–
rion
a
1~
régence d'Halberftadt : l'abbaye impériale
de Gandersheim en eft fuferaine.
(D.G.)
*
§
DEROTE , (
Géogr.
)
ville d'Egypte , fituée
dans une ile qui forme ••..
liJe{
que forme ,
&c.
Lettres fur L'Encyclopédie.
DESCENTE
DES PLANETES VER$ LE SOLEIL'
(
Lif!ron.
)
c'efr le tems qu'elles emploieroient
a
tomber par une ligne droite,
íi
la force de projeétion
<]Ui
anime les planetes
&
leur fait décrire des orbi–
tes , étoit détruite. Lorfqu'elles foat dans leurs
moyennes difrances au foleil , la force centrale les
précipiteroit vers le foleil; dans les tems fuivans,
mercure
y
arriveroit en
15
jours
&
13
heures;
·.vénus en 39 jours 17h; la terre en 64 jours Ioh;
mars en 121 jours ; jupiter en 290 jours; fatu'rne
en 767 jours ; la comete la plus éloignée que nous
connoiffions en 66 mille jours; la lune tomberoit
{ur
la terre en 4 jours 20 heures; les fatellites de
jupiter tomberoient fur leur planete en 7h,
1
)h,
3oh,
&
71h; ceux de faturne en 8
11
,
12h, 19
11 ,
68h,
336
h.,
refpeétivement ; une pierre tomberoit a
u
centre de la
terr~,
file paífage étoit libre en 21'9".
\Vhifron,
AjlronomicaL principies
fJj
religion, p.
66.
La
regle qui fert
a
faire ces calculs , coníifre
a
dire ,
2828 efr
a
1000' c'efr-a.dire' la racine carrée du
cube de 2 eft
a
I ,
COmme la demi-durée de la révo–
lution d'une planete eft an tems de fa chf1te jufgu'au
<:entre de l'attraétio,n ,
Friji de gravitate
,
p.
100.
L'opération feroit beaucoup plus fimple , fi l'on pou–
voit fuppofer 'gue les planetes defcendiífent par un
mou ement uniforme; mais il eft évident que cette
hihe doit etre extremement a'célérée. (
M.
DE
LA
LAN
DE.)
DESCRIPTION,
f.
f. (
Bellcs...Lettres.)
La
defcrip–
tiotz
ne fe borne pasa caraétériíer fon objet ; elle en
préfente fouvent le tablean dans fes détails les plus
intereífans
&
dans toute fon étendue.
leí
le gout
coníifte
a
bien choiíir'
1°.
l'objet que l'on veut pein–
<lre; 2
o.
le point de vue le plus favorable
a
l'effet
c¡u' n fe propofe; 3°. le momeot le plus avanta–
geux,
fi
.l'objet eft changeant ou mobile ;
4°.
les
trairs qui l'expriment le plus vivement tel qu'on a
deífein de le faire voir;
5o.
les
o~poíitions
qui peu-
1_
t1t
le rendre plus faillant
&
plus fen{lble encore.
D E S
,oJ
~e
choix de 1
obje~ d?i~
fe r
1
gler ft r l'intentioi1 ·'u
poet~
.. Le
rabie~
u dou-Il
tre gracieux o u fombre
p~th
n9ue o
u
nant
?
Cela
d
' pénd de
la
place
qu''
lu1 defrme,
&
de l'e.ffet qu'il en attend.
Omnia
ot7jili.isprteyij'a animoque Yol mi.
Le
point de vue
e.firelatif de l'objer au fpe a–
teur : l'afpeét de l'un, la fituation de l'autre
con–
courent
a
r~ndre
la
deflripúon
plus ou
moin~
inré–
reífante;
ma~s
(ce qu'il efr important
de
remarquer)
toutes les f01s qu'elle a des auditeurs en fcene, l<e
leéteur fe meta leur place,
&
c'eft
de-l~
qu'il
voit
le
tablea u..
L~rfque
Cinna
~ ' pete
a
Emilie ce qu'il a dit
aux con¡ures pour les
amm~r
a
la perre d'Auguíl:e;
n~~s
nous
~ettons,
pour
1'
co uter,
a
la place d'E–
mibe ; a
u
heu que s'il vient
a
d
1
crire les hQrreurs
des profcriprions:
Je Les
pei.nsdarls le me.Urtre
J
l'envi triomphan$
-
Rome entiere noyée au fang de f es enfans ;
,
Les uns
a.f!~(jinés·
tl..
ms Les pl..zces pu
bliques,
Les
a~ttres
dans Le fein de leurs dieux dortzejliqu.es,
Le
mec~ant
par le
p rix
a
u
crime elzcouragé
~·Le marz parfa fi mme en fon Lit égorgé
·
Le fi.'Ls tottt dégouttant dtt meurtre de jon p e
ti
Et fa téte
a
la main dematzdant fon falaire.
_,
-
Ce n'eíl: plus
a
la place d'Emilie que nous fommes;
c'efr
a
la place des conjurés.
Tous les grands poetes ont fenri 1'a antage de
donner
a
leurs
defcriptions
des témoins gu'elles int–
téreífent, bien fl'Lrs que l'émotion qui r egne fur
la
fcene fe répand dans
l'amphithé~hre,
&
que mille
ames ?'en font qu'une quand l'intéret les réunit.
Ma1s ab.firaétion faite de cette émotion réfléchie ·
le
~oint
de vue direét de l'objet a nous' eft plus
o~
moms f.a
v~rable
a
la poe!ie
~omme
a
la peinture, fe–
Ion
q~
Il
repond plus ou moms a l'effet qu'elle veut
prodmre. Un poete fait-ill'éloge d'un guerrier ille
voit comme Hermione voit Pyrrhus:
'
lntrépide,
&
par-toTlt {uivi de la Yiéloire.
11
oublie que fon héros efr un homme,
&
que ce
fom. des hommes qu'il fait égorger. Sa valeur, fon
aéti viré, fon audace, le don de prévoir, de difpo–
fer, de ma!trifer les événemens, l'influence d'une
grande ame fur des milliers d'ames vulgaires qu'elle
remplit de fon ardeur: voila ce qui le frapp(t. Mais
veut illui reprocher fes triomphes; tout change de
face,
&
l'on voit,
Des murs que ta flamme taYage;
Des vainqueurs fumant de carnage.
¡
Un peuple au {er abandonné;
Des mP.-res páles
&
fanglantes,
A
rrachant lettrs fiLies
tr~mbLanteS
Des bras d'un foldat
effrerzé.
(
Rouífeau.)
Ainíi, cette Hermione qui dans Pyrrhus admiroit
un héros intrépide , un vainqueur plein de gloire
&
de charmes,
n'y
voit bientot plus qu'un meurtrier
impitoyable'
&
meme lache dans fa fureur.
Du Yieux pere d'Heélor la valeur abattue
Aux pieds de fa famille expirante
a
fa yue,
T andis que dans fon fein votre bras enfoncé ,
Cherche u.n
rejl~:
de fang que
l'
dg~
avoit glacé;
Dans des ntiJ!eaux de fang Troie ardenteplongée,
D e votre propre main Polixene égo1gée ,
Aux yeu.x de tous les Grecs indignés contre yous:
Quepeut-on refufer
J
ces généreux coups?
Ce
changement de fa ce dans l'objet que l'on pein t,
dépend fur-tout du moment que l'on c.hoi!it,
&
des
détails que l'on ernploie. Comme prefque toute la
nature efr mobile,
&
que tout
y
eft compofé ,
l'imi–
tation peut
varier
a
l'infini dans
les
dérails;
&
c'eft
)
















