
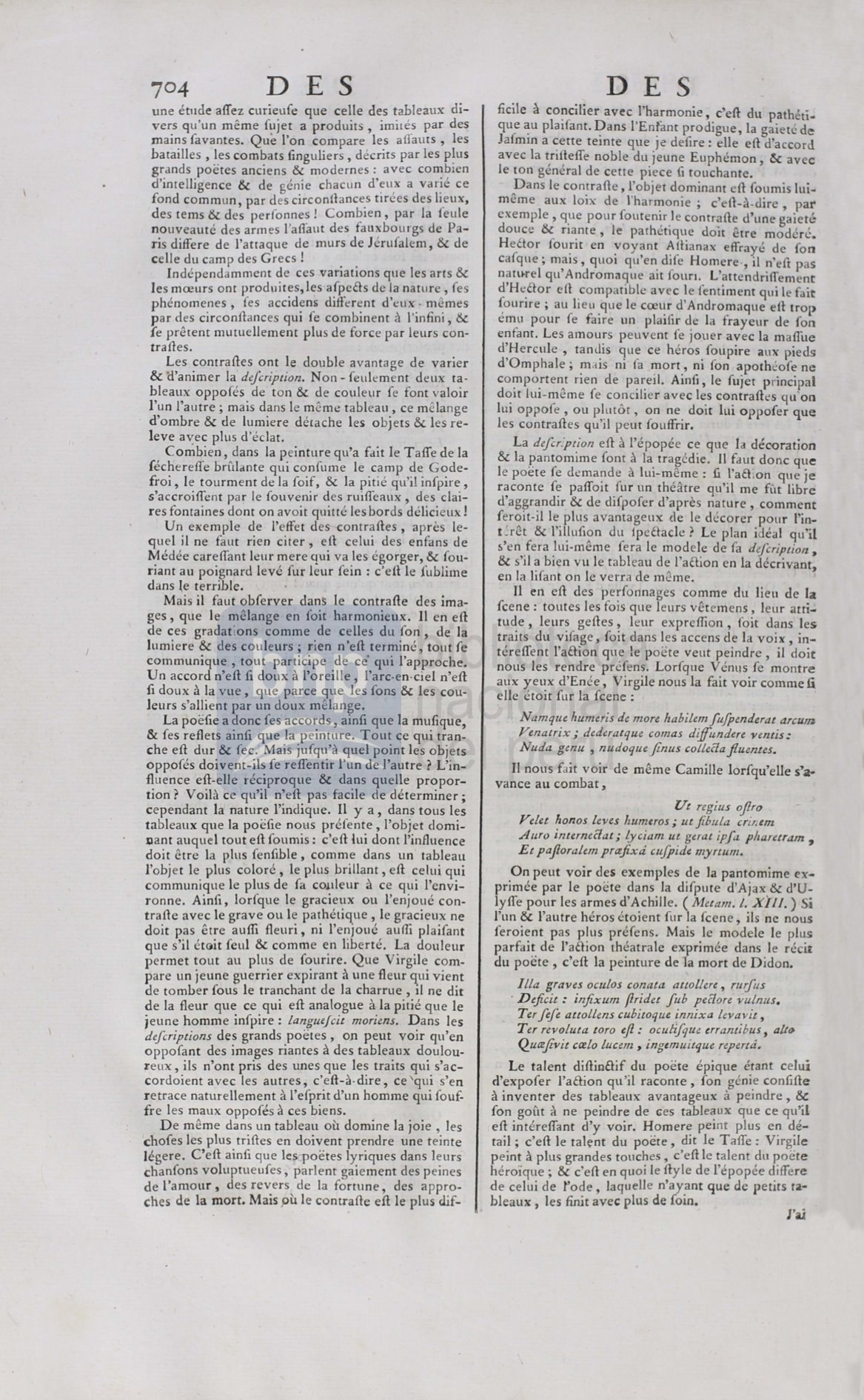
704
D E S
une étude aífez curieufe que celle des tableaux di–
vers qu'un meme fujet a produits ' imit és par des
mains favantes. Que l'on compare les aífaurs , les
batailles , les combats finguliers, décrits par les
p~us
grands poetes anciens
&
modernes: avec
co~~1en
d'inrelligence
&
de géníe chacun
d'~u;
a
var~e
ce
fond commun par des circonfrances t1r es des heux,
des tems
&
de~
perfonnes
!
Combien, par la feule
nouveauté des armes l)aífaut des fauxbourgs de Pa–
ris differe de l'attaque de murs de Jérufalem,
&
de
celle du camp des Grecs
!
Indépendamment de ces variations que les arts
&
les mreurs onc produites,les·afpeé:ts de la nature , fes
phénomenes' fes accidens dllferent d'eux. memes
par des circon:fiances qui fe combinent
a
l'infin i'
&
fe pretent mutuellement plus de force par leurs con–
traites.
Les comraíles ont le double avantage de varier
&
O.'animer la
dej'cription.
Non- feul ement deux ta–
bleaux oppofés de ton
&
de couleur fe font aloir
l'un l'autre; mais dans le meme tableau' ce melange
d'ombre
&
de lumiere détache les objets
&
les re–
leve
a~ec
plus d'éclat.
Combien, dans la peinture qu'a fait le T aífe de la
féchereífe brulante qui con fume le camp de Gode–
froi, le tourment de la foif,
&
la pitié qu'il infpire ,
s'accroiífent par le fouverur des ruiffeanx, des clai–
res fontaines dont on avoit quitté les bords délicieux !
Un eKemple de l'effet des-eontra:fies, apres le–
quel il ne faut ríen citer, efi celui des enfans de
Médée careífant leur mere qui va les égorger,
&
fou–
riant au poignard levé fur leur fein : c'efi le fublime
dans
~e
terrible.
Mais il faut obferver dans le contraíl:e des ima–
ges' que le melange en foit harmonieux. Il en eft
de ces gradations comme de celles du fon, de la
lurniere
&
des couleurs; rien n'efi terminé, tout fe
communique , tout participe de ce' qui l'approche.
Un accord n'efi fi doux
a
l'oreille, l'arc-en-ciel n'eft
fi
doux a la vue' que paree que les fons
&
les cou–
leurs s'allient par un doux melange.
La poefie a done fes accords, ainfi que la mufique,
& fes reflets ainfi que la peinture. Tout ce qui tran–
che e:fi dur
&
fec. Mais jufqn'a que} point les objets
oppofés doivent-ils fe reífentir !'un de l'autre
?
L'in–
fluence dt-elle réciproque
&
dans quelle propor–
tion? Voila ce qu'il n'e:fi pas facile de déterminer;
cependant la nature l'indique. Il
y
a, dans tous les
tableaux que la poefie not-ts préfente, l'objet domi–
Jilant auquel tout efi foumis: c'e:fi lui dont l'in.fluence
doit etre la plus fenfible' comme dans un tableau
l'objet le plus coloré, le plus brillant, efr celui qui
communique le plus de fa
co~leur
a
e~ q~li
l',envi–
ronne. Ainfi, lorfque le grac1eux ou 1enJoue con–
traite avec le grave ou le pathétique, le gracieux ne
doit pas etre auffi fleuri' ni l'enjoué auffi plaifant
que s'il était feul
&
comme en liberté. La douleur
permet tout au plus de fourire. Que Virgile com–
pare un jeune guerrier expirant a une fleur qui vient
de tornber fous le tranchant de la charrue , il ne dit
de la fleur que ce qui e:fi analogue
a
la pitié que le
jeune homme infpire:
La'l;~uejcit
moriens.
J?ans
}es
defcriptions
des grands poetes , on peut vo1r qu en
oppofant des ima_ges riantes
a
des
table~ux d?u~ou~eux,
ils n'ont pns des unes que les tra1ts qtu s ac–
cordoient avec les autres, c'efi-a-dire, ce '-qui s'en
re trace naturellement a l'efprit d'un homme qui fouf–
fre les maux oppofés
a
ces biens.
De meme dans un tableau ou domine la joie , les
chofes les plus trifies en doivent prendre une teinte
Iégere. C'e:fi ainfi que les poetes lyriques dans leurs
chanfons voluptueufes, parlent gaiement des peines
de l'amour, des revers de la fortune, des appro–
ches de la mort. Mais pille cont.rafte e:fi le plus
dif-
DES
ficil e
a
concilier avee
1
harmonie' c'eft du path,
ti–
que au plaifant.Dans l'Enfant prodigue, la uaiet de
Jafmin a cette teinte que je deíire; elle eft
0
d accord
avec la trifieífe noble du jeune Euphémon,
&
av e
le ton général de cette piece
ú
toucbante.
Dans le conrrafte, l'objet dominant e:fi foumis lui–
meme aux loix de l'harmonie
;
e' fr-a-dire
par
exemple, que pour foutenir le contra:fie d'une gaieté
douce
&
riante ' le path
1
tique doit etre mod
1
r ,.
Heétor fourit en voyant AHianax effrayé de fon
cafque ; mais, quoi qu'en dife Homere., il n eft
pas
natu·rel qu'Andromaque ait foun . Vattendriífement
d'H é:tor eíl compatible avec le fent iment qui le fait
fourire; au lieu que le creur d'Andromaque efi trop
ému pour fe faire un plaifir de la frayeur de fon
enfant. Les amours peuvent fe jouer avec la maífue
d'Hercule , tandis que ce héros foupire aux pieds
d'Omphale; mais ni fa mort, ni fon apoth ·ofe ne
comportent rien de pareil. Ainfi, le fujet principal
doit lui-meme fe concilier avec les contra:fi
s
qu'on
lui oppo[e , ou plutót, on ne doit lui oppofer que
les contra:fies qu'.il peu r fouffrir.
La
defcr:ption
efi a l'épopée ce que la décoration
&
la pantomime font
a
la tragédie. ll fclUt do ne que
le poete
[e
demande
a
lui-meme ;
íi
l'aa:on que je
raconte fe paífoit fur un tbéatre qu'il me fCtt libre
d'aggrandir
&
de difpofer d'apres nature, comment
feroit-ille plus avantageux de le d ' corer pour 1in–
t ~ret
&
l'illuíion du ipeé:tacle? Le plan idéal qu'il
s'en fera lui-meme fera le mod ele de fa
difcription.,
&
s'il a bien vu le tableau de l'ailion en la décrivant,
en la lifant on le verra de meme.
Il en e:fi des perfonnages comme du lieu de
la:
fcene: toutes les fois que leurs vetemens' leur atri–
tude, leurs gefies, leur expreilion , foit dans les
traits du vifage, foit dans les accens de la voix, in–
téreífent l'aé:tion qne le poete veut peindre , il doit
nous les rendre préfens. Lorfque VéntJS fe montre
aux yeux d'Enée, Virgile nous la fait voir comme
ti
elle étoit fur la fcene :
.
Namqtte humeris de more hahilem fufpenderat arcum
Yenatrix; dederatque comas dijfundere ventis:
Nuda genJ!-, nudoque jinus coLLeRafluentes.
Il nous fait voir de meme Camille lorfqu'elle s'a.
vanee au c-ombat,
Ut regius ojlro
Yelet nonos leves humeros; ut fibula crintm
A uro interneflat; Lyciam ut gerat ipfa pharetram,
Et pajloralem prafixá cujjúde myrtum.
On peut voir des exernples de la pantomime ex–
primée par le poete dans la difpute d'Ajax
&
d'U–
lyífe pour les armes d'Achille. (
Metam.l.
XiiJ.)
Si
l'un
&
l'autre héros étoient fur la fcene, ils ne nou.s
feroient pas plus préfens. Mais le modele le plus
parfait de l'aé:tion théatrale exprimée dans le récit
du poete, c'eft la peinture de la mort de Didon.
llla graves oculos conata attollere, ruifus
Deficit : infixum firidet Jub peRore vulnus.
Ter
Jefe
attollens cubitoque innixa Levavit ,
Ter revoluta toro
efl:
ocufifque errantibus , altt>
Qucejivit
u~Lo
lucem, ingemuitque repertá,
Le talent difiicélif du poete épique étant celui
d'expofer l'aé:tion qu'il raconte, fon _géni.e confiíl:e
a
inventer des tableaux avantageux a pemdre'
&
fon goflt
a
ne peindre de GeS
table~UX
que
Ce
qu"d
efi intéreífant d'y voir.
~?mer~
pemt plus
e~ ~é
tail; c'eft le talent du poere,
~1t
le Taffe:
Vtr&~le
peint a plus grandes tonches' e eíl: le talent du poete
héro1que;
&
c'eft en quoi le
~y
le de l'épopée
~iffere
de celui de .t'ode, laquelle n ay.ant que de pet.Its
ta·
bleaux , les finit avee plus de fom.
J'aj
















