
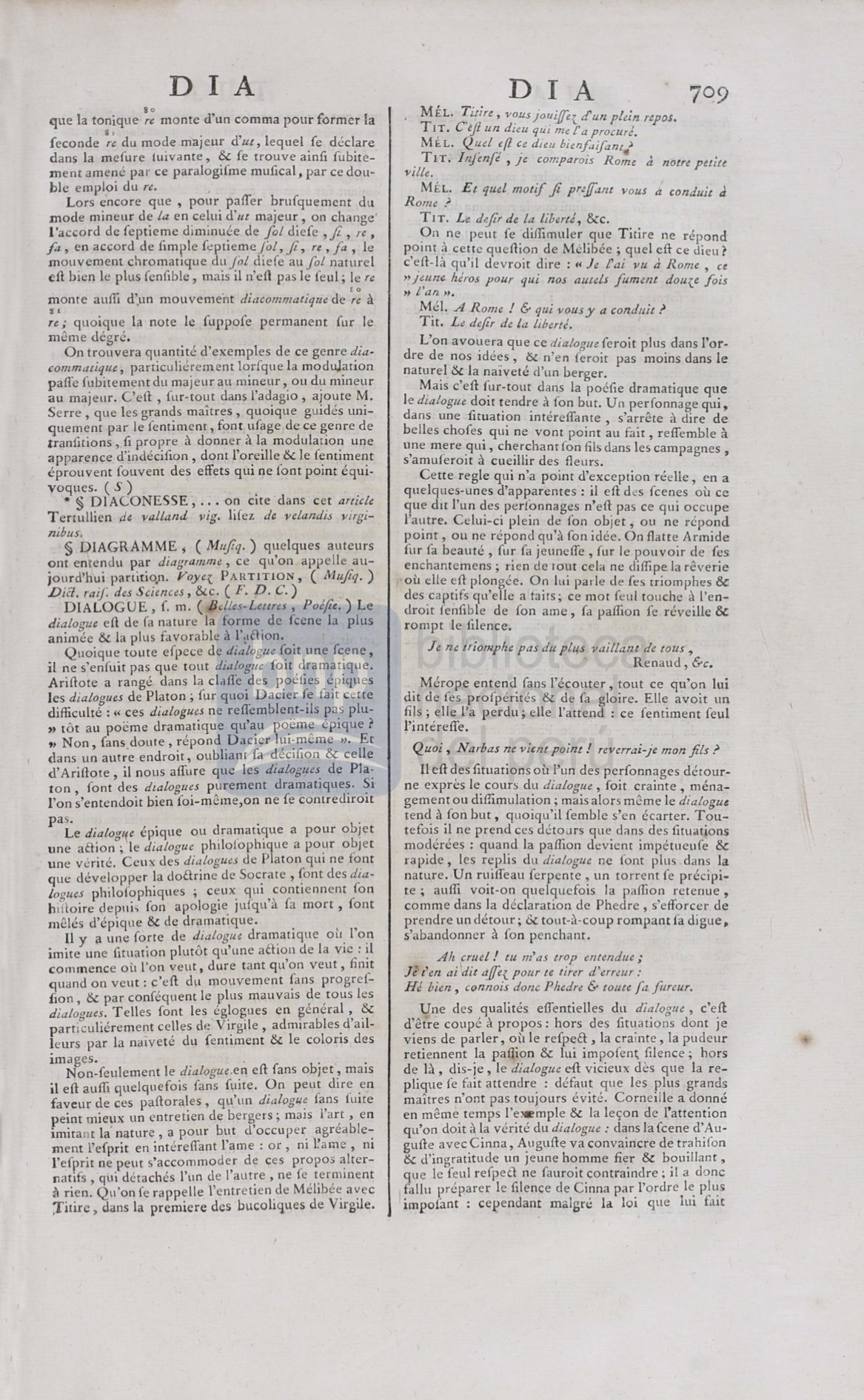
DIA
So
que la tonique
re
monte d'un comma pour former
la
8
1
feconde
re
du mode majeur
d'ut,
lequel fe déclare
daos la mefure iuivante,
&
fe trouve ainfi fubite–
ment amené par ce paralogifme mufical, par ce dou-
ble emploi du
re.
.
Lors encore que , pour paifer brufquernent du
mode mineur de
La
en celui
d'ut
majeur, on change'
l'a ccord de feptieme diminuée de
fol
diefe
,ji,
re,
fa,
en accord de fimple feptiemej'ol,fi,
re,
fa,
le
mouvement chromatique du
fol
diefe au
fol
naturel
efi bien le plus fenfible, mais il n'efi pas le feul; le
re
fo
monte auffi d'un mouvement
diacommatique
de
re
a
S
1
re;
quoique
la
note le fuppofe permanent fur le
meme dégré.
On trouvera quantité d'exemples de ce genre
dia–
commatique,
particuliérement lorfque la moduJarion
paife fubitement du majeur au
mi~eur
'· ou
d~
mineur
au majeur. C'eíl: , fur-tout daos l adag1o, aJOute M.
Serre, que les grands maitres, quoique guidés uni–
quement par le fenrimenr, font ufage de ce genre de
tranfi.tions' fi propre a dooner
a
la modula rion une
apparence d'indécifion, dont l'oreille
&
le fentjment
éprouvent fouvent des effets qui ne font point équi–
voques.
(S)
*
§
DIACONESSE, ..• on cite daos cet
article
Terrullien
¡le valland vig.
lifez
de velandi.s virgi–
nibus.
§
DIAGRAMME ; (
Mujiq.)
quelques auteurs
ont en endu par
diagramme,
ce qu'on appelle au–
jourd'h'ui partitiqn.
Yoye{
PARTITION, (
Mrifiq.
)
Dia.
raij: des Sciences,
&c.
(F.
D. C.)
DIALOGUE,
f.
m. (
Belles-Leures, Poéjie.)
Le
dialogue
eft de fa nature la forme de fcene la plus
animée
&
la plus favorable a
l'~B:ion
•.
Qnoique toute efpece de
.dialogue
~ott
une fc:ene,
il ne s'enfuit pas que tout
d¡,alogue
foH dramauque.
Ari!lote a rangé dans la claife _des P.oéfies
~piques
les
diaLogues
de Platon ; fur qu01 Dacter
~e
fa1t cette
difficulté :
<<
ces
dialogues
ne reífemblent-zls pas plu–
»
tot au poeme dramatique qu'au poeme épique
?
, Non, fans .doute, répond _Dacier
l~i:meme
''·
Et
dans un autre endroit, oubhant fa dec1fion
&
celle
d'
Ariílote , il nous aifure que les
dialogues.
de P1a:
ton, font des
dialogu~s
P;trement
dramattque~. ~1
l'on s'entendoit bien f01-meme,on ne fe comred1ro1t
pas.
.
.
Le
dialog¡(e
épique ou
~rat?augue
a pour obJet
une aél:ion ; le
dialogue
ph1loioph1que a
po~tr
obJet
une vériré. Ceux des
dialogues
de Platon qm ne font
que développer la doél:rine de Soc.rate,
~ont
des
dia–
logues
philofophiques ;
c~ux_
q.m
.~ont1eonent
fon
bd oire
depni~
fon
apolog~e.
JUíqu a fa mort, font
melés d'épique
&
de dramatlque.
.
I1
y
a
une forte de
dialogue
dra~attque
ou. l'o.n
imite une fituation plutot qu'une aél:wn de la v1e ;
~l
commence oill'on veut, dure tant qu'on veut, fimt
quand on veut: c'eft du mouvement
~ans
progref–
fion
~
&
par conféquent le plus rrtauva1s
~e
,tous les
dialogues.
Telles font les
eg~o~ues
en
~eneral ~ ~
particuliérement celles de
V
trglie , admirables.d ail–
l eurs par la naiveté du fentiment
&
le colons des
images.
.
.
.
Non-feulement le
dialogue-en
eft fans obJet, ma1s
il efi auffi quelquefois fans
f~ite
. .
~n
peut dire _en
faveur de ces
pafiora~es,
qu un
d1-alogu~
fa,ns flllte
peint mieux un entrehen de bergers; mats l art , en
imitant la nature, a pour but d'occuper agréable–
ment t'efprit en intéreífant l'ame : or, ni
l~ame
, ni
l'efprit ne peut s'accommoder de ces propos
~lter
natifs , ·qui détachés l'un d,e
l'aut~e,
ne fe,
t_er~ment
a
rieo. Qu'on fe rappelle 1entretten .de
Mehbe~ a~ec
Titire, dans la
~remiere
des bucohques de Vugile.
DIA
MÉL.
Ti..tire,
v~us
jouiffet d'un plein repos.
T
1;.
C'ejl
un duu
qui
meta procuré.
MEL.
Q~el ~(l ~e
dieu bienfaifant)
TIT.
lnjenfe '¡e comparois Rome
a
notre petite
ville.
MÉL.
Et
quel
moti/
ji
pre.f{ant vous
á
conduit
J
Rome
?
TIT.
Le dejir de la liberté,
&c.
~n
,ne peut fe
~diffimule: .q~e
Titire oe répond
potnt
~
cette quefi10n de Mehbee; quel eft ce dieu?
c'efi-la qu'il devroit dire :
((le l'ai
'JIU
aRome
ce
»
jume héros pour qui nos auteLs fument doute fois
}'
l'an
H.
M_él.
A Rome
!
&
qui vous
y
a
conduit
J
Tlt.
Le dejir de la Liberté.
L'on a
vo~1era
que ce
dialogue
feroit plus dans
l'or–
dre de nos 1dées,
&
n'en feroit pas moins daos
le
naturel
&
la naiveté d'un berger.
~ais
c'efi
~ur-tout d~ns
la poéfie dramatique que
le
d¡,alogue
dolt
~end~e
aJon but.
Un
perfonnage qui,
dans une :íituatJOn mtereífante
s'arrete
a
dire de
belles chofes. qui ne VOnt point
~U
fait, reifemble
a
une mere qm, cherchant fon
fils
daos les campagnes
s'amuferoit a cueillir des fleurs.
'
Cette regle qui n'a point d'exception réelle, en a
quelques-unes d'apparentes: il eíl: des {cenes ou ce
que dit l'un des perlonnages n'efr pas ce qui occupe
l'a~tre.
Celui-ci plein de fon objet, ou ne répond
pomt, ou ne répond qu'a fon idée. On flatte Armide
fur fa bea·uté, fur fa jeuneífe, fur le pouvoir de fes
enchantemens; ríen de rout cela ne
diffipe.lareverie
ou elle efi plongée. On lui parle de
fes rriomphes
&
des captifs qu'elle a fairs; ce mor feul touche
a
l'en–
droit feníible de fon ame, fa paffion fe réveille
&
rompt le filence.
Je ne triomphe pas du plU:s vaillant de tous.,
Renaud,
&c.
Mérope entend fans l'écoater, tout ce qu'on
luí
dit de fes profpérités
&
de fa gloire.
Elle
avoit un
fils ; elle Pa perdu; elle l'attend : ce fentiment feul
l'intéreife.
Quoi, Narbas ne vient point! reverrai-je mon fils
J
11
efi des fituations ou l'un des perfonnages dérour–
ne expres le cours du
dialogue,
foit crainte, ména–
gement ou diilimulation; mais alors meme le
dialogue
tend
a
fon but, quoiqu'il femble s'en écarter. Tou–
tefois
il
ne prend ces détoars que daos des fituations
modérées : quand la paffion devient impétueufe
&
rapide, les replis dn
diaLogue
ne font plus dans la
narure. Un ruiífeau ferpente, un torrent fe précipi–
te ; auffi voit-on quelquefois la patlion retenue ,
comme daos la déclaration de Phedre , s'efforcer de
prendre un détour;
&
tout-a-coup rompant fa digue •
s'abandonner
a
fon penchant.
Ah cruel! tu m'as trop entendue;
1
e
t'
en ai dit
ajfe{
pour te tirer d'erreur :
Hé bien
,
connois done Phedre
&
toute fa fureur.
Une des quaütés eífentielles du
dialogue,
c'eft
d'etre coupé
a
propos: hors des fituations dont je
viens de parler, oitle refpeét, la crainte, la pudeur
retiennent la paffion
&
lui impofent fi.lence; hors
de la , dis-je, le
dialogue
eíl: vicieux des que la re–
plique fe fait attendre : défaut que les plus grands
maitres n ont pas toujours évité. Corneille a donné
en
m~me
temps l'e:cmple
&
la lec;on de l'attention
qu'on doit
a
la vérité du
dialogue:
dans la fcene d'Au–
gufie avec.Cinna, A_ugufte va convaincre de tr.ahifon
&
d'ingratttude un Jeune homme fier
&
bomllant,
que le feul refpeél: ne fauroit contraindre; il a done
fallu préparer le filence de Cinna par l'ordre le plus
impofant : cependant mQlgré la loi que lui fait
















