
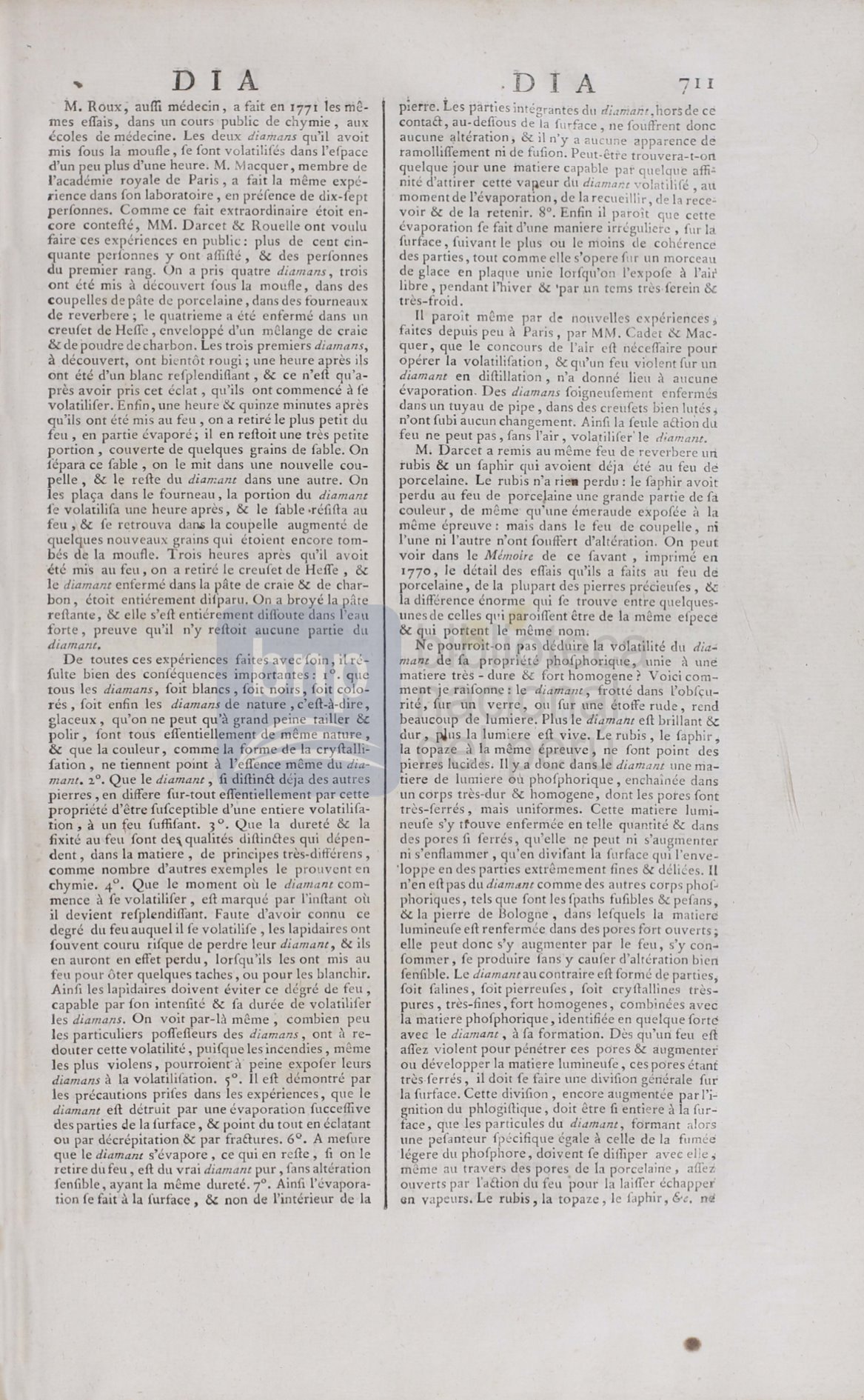
DIA
M.
Roux;
auffi rnédecin, a fait en
1771
les rn&–
rnes effais, dans un cours public de chymie , aux
écoles de médecine. Les deux
diamans
qu'il avoit
mis fous la rnoufle, fe font volatilifés dans l'efpace
d'un peu plus d'une heure. M. Macquer, membre de
l'académie royale de Paris, a fait la meme expé–
rience daos fon laboratoire, en préfence de dix-fept
perfonnes. Comme ce fair extraordinaire étoit en–
core contefté, MM. Darcet
&
Rouelle ont voulu
faire ces expériences en public: plus de ceot cin–
quante perfonnes
y
ont affifré ,
&
des perfonnes
du premier rang. ün a pris quatre
diamans,
trois
ont été mis a découvert fous
la
moufle' dans des
coupelles de pft te de porcelaine, dans des fourneaux
de reverbere ; le quatrieme a été enfermé dans un
creufet de Heífe, enveloppé d'un melange de craie
&
de poudre de charbon. Les trois premiers
diamans,
a
découvert, Ont bi ntot rougi; une heure apres ils
ont été d'un blanc refplendiílant,
&
ce n'eft qu'a–
pres avoir pris cet
1
clat , qu'ils ont commencé a
fe
volatilifer. Enfin, une heure
c.:::
quioze minutes apres
qu'ils ont été mis au feu, on a retiré le plus petit du
feu, en partie évaporé; il en reftoit une tres petire
portion, couverte de quelques graios de Cable. On
iepara ce fable , on le mit dans une nouvelle con–
pelle,
&
le refte du
diamant
dans une autre. On
les plac;a dans le fourneau, la porrion du
diamant
fe volarilifa une heure apres,
&
le fable ·réfiíla au
feu,
&
fe re.trouva
da~
la coupelle augmenté de
quelques nouveaux grains qui étoient encore tom–
bés d la moufle. Trois heures apres qu'il avoit
été
mis
au feu, on a retiré le creufet de Heífe ,
&
le
diamant
enfermé dans la pate de craie
&
de char–
bon, étoit entiérement difparu. On a broyé la pare
reftante,
&
elle s'eft entiéremeot difioute dans Pea n
forte , preuve qu'jl n'y reftoit aucune partie dn
diamant.
De toutes ces expériences faites avec foin, il r
1
-
fulte bien des conféquences importantes:
1°.
que
tous les
diamans,
foit blancs , foit noirs, foit colo–
rés, foit enfin les
diamans
de nature, c'eft-a-dire,
glaceux, qu'on ne peut qu'a grand peine tailter
&
polir' font rous eífentiellement de meme nature'
&
que la couleur, comrne la forme de la cryftalli–
fation' ne tiennent
poi.nta
l'effence rneme du
dia–
mant.
2°.
Que le
diamant,
fi diftinél: déja des
autr.espierres , en differe Útr-tout eífentiellement par cette
propri 'té d'etre fufceptible d'une entiere volatilifa–
tion '
a
un feu fuffifant. 3
o.
Que la dure té
&
la
fixité au feu font de!\ qualirés difiinétes qui dépen–
dent, daos la matiere , de príncipes tres-différens,
comme nombre d'autres exemples le prouvent en
chymie.
4°.
Que le moment ou le
diamant
com–
mence
a
fe volatilifer, eft marqué par l'infiant
Otl
il devient refplendiífant. Faute d'a oir connu ce
degré du fe u
auq~tel
il fe volatilife , les
~apidaires
o.ntfou'vent couru nfque de perdre leur
dtaman~,
&
1ls
en auront en effet perdu, lorfqu 'ils les ont mis au
feu pour oter quelqu('S taches, OU pour les blanchir.
Ainfi les lapidaires doivent éviter ce dégré de feu ,
capable par {on intenfité
&
fa durée de volatilifer
les
diamans.
On voit par-la meme, combien peu
les particuliers poffeífeurs des
diamans'
ont
a
re–
douter cette volatilité' puifque les incendies' meme
les plus violens'
p<;mr~oienr
a."
peine
e~pofer
}eurs
diamans
~
la volat1hfat10n. 5°. ll efl: demontre par
les précautions prifes dans les expériences, que le
diamant
éft
détruit par une évaporation fucceffive
des parties Qe la íurface,
&
point du tout en éclatant
ou par décrépitatÍ0n
&
par fraél:ures.
6Q.
A mefure
que le
diamant
s.,évapore, ce quien r efie, fi on le
retire dú feu, efl: du vrai
diamant
pur, fans altération
fenfible, ayant la meme dureté.
7°.
Ainfi l'évapora–
tion fe fait
a
la furfa,e ,
&
non de Fintérieur de la
.DI A
7 I I
1
pi
erre. Les parties in égrantes du
diamar.
hors de ce
contaét, au-deífous de
la
furface ne foutfreot done
aucun~ altératio~,
&
il n'y a
au~une
ppar nce de
ramolliffement m de fufioo . Peut-etre trouvera-t-on
q~~lq~e
jour une inatiere capa?le par quelque affi.:
ntte d artuer cette vafleur du
dlamnr.t
volatiliCé , au
moment de l'évaporation, de la recueillir, de la rece–
voir
&
de la retenir. 8°. Enfin il paro 't que cette
évaporation fe fait d'une maniere irrégulíetc , fur la
furfaee, fuivanr le plus ou le moins de cohérence
des parties, tout comme elle s'opere fur un morceau
~e
glace en plaque unie lorfqu on l'expofe
a
l'air
hbre, pendant l'biver
&
'par un tcms tr s
f¡
rein
&
tres-froid.
Il paroit rn&me par de nonvelles expériences,
faites depuis peu
a
Paris , par MM. adet
&
Mac–
quer, que le concours de l'air efi. néceífaire pour
opérer la volatilifation,
&
qu'un feu violent fur un
diamant
en diílillation' n'a doooé líen
a
aucune
évaporation. Des
diamans
foign eufemeot enferm
1
s
daos un tuyau de pipe, dans des creufets bien lutés;
n'ont fubi aucun changement. Ainfi la feule aétioi1 du
feu ne peut pas, fans l'air, volatilife r'le
diamam.
M. Darcet a remis au meme feu de reverbere
mi
rubis
&
un faphir qui a oient déja été au feu de
porcelaine. Le rubis n'a rie perdu: le faphir avoit
petdu au feu de porcelaine une grande patrie de fa
couleur' de meme qu'une émeraude expofée a la
meme épreuve: rnais dans le feu de coupe1le' ni
l'une ni l'autre n'ont fouffert d'altération. On peut
voir dans le
Mémoire
de ce favant
,
imprimé en
1770 ,
le détail des effais qu'ils a fai
ts
au fe u de
porcelaine, de la plupart des pierres précieufes,
&
la différence énorme qui fe trouve entre quelques·
unes de celles ql!i paroiífent etre de la meme efpece
&
qui portent le meme nom.
Ne pourroit-on pas déduire
la
volatilité du
día–
man-e
de fa propriét , phofphorique, unie
a
une
matíere tres- dure .
&
fort homogene? Voici com–
ment je raifonne: le
diamant,
frotté dans
l'obf~u
rité, fur un verre, ou fur une étotfe rude, r nd
beauconp de lumiere. Plus le
diamant
efl: brillant
&
dur,
~ns
la lumiere eft vive. Le rubis, le faphir ,
la topaze
a
la meme épreuve' ne font po1nt des
pierres lucides; Il
y
a done dans le
diartzant
une nia–
tiere de lumiere ou phofphorique, enchainée dans
un corps tres-dur
&
homogene, dont les pores font
tres-ferrés, mai uniformes. Cette matiere 1umi–
neufe s'y tfouve enfermée en telle quantité
&
dans
des pores fi ferrés, qu'elle ne peut ni s'augmente.r
ni s'enflammer, qu'en divifant la furface qui l'enve–
·Ioppe en des parties extr"mement fines
&
déli ' es.
n
n'en eílpas du
diamant
comme des autres corps phof ...
phoriques, tels que font
les
fpaths fuíibles
&
pefans,
&
la pierre de Bologne , dans lefquels la matiere
lumineufe eft renferm
1
e dans des pores fort ouverts;
elle peut done s'y augmenter par le feu, s'y con–
fommer, fe produire fans
y
caufer d'alrération bien
feníible. Le
diamantau
cootraire efr formé de parties,
foit falines, foit pierreufes, foit cryílallines tr s–
pures, tres-fines, fort homogenes, combin 'es avec
la matiere phofphorique, identifiée en qttelque forré
ave e le
diamant,
a
fa formation. Des qu'un feu eft
aífez ioleot pour pénétrer ces pores
&
augrnenrer
ou développer la matiere lnmineufe, ces pores ét nf
tres-ferrés, il doit fe faire utJe divifion générale fur
la furface. Cette d1vifion, encore augment
1
e par l'i–
gnition du phlogifiique' doit etre fi entiere
a
la fur–
face, que les panicules du
diamant,
formant alors
une pefanteur fp
1
cifique égale
a
celle de la fumée
légere du phofphore, doivent fe diffiper a ee elie ,
rneme au traver · des potes de 1a porcelaine' aífez
ouvert par l'aétion du feu pour la laiífer échapper
en vapeu rs. Le rubis, la topaze, le faphir
&·c.
ne
















