
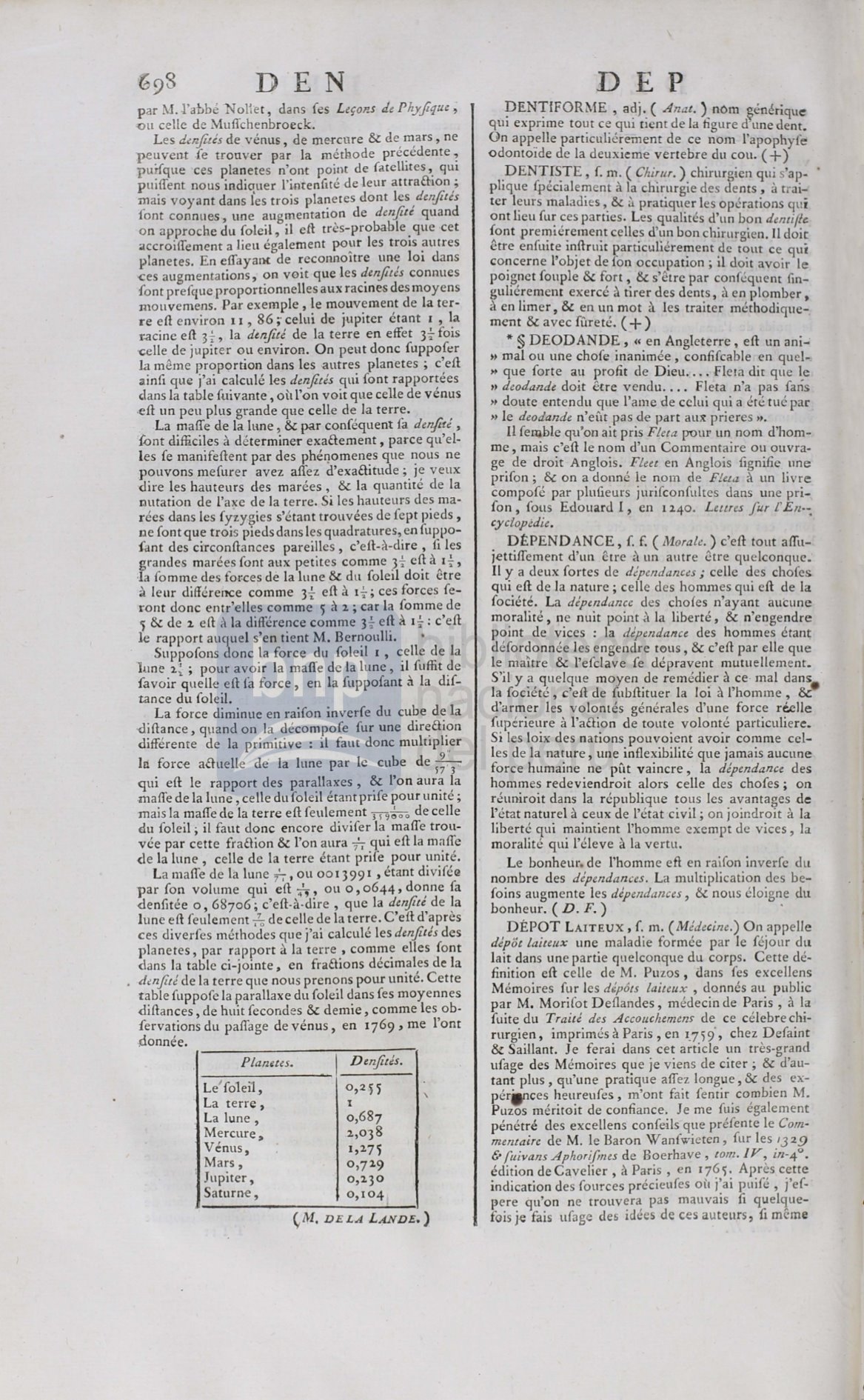
DEN
par M. l'aubé ol'et, dans fes
Le9o~s
de Phy.fique ;
'OU
celle de Muffcheobroeck.
Les
d.mji. tés
de vénus, cle merenre
&
de
mars, ne
pe~vent
.fe
tronver par
la
mérhode
pré~édente ~
pu~que
ces planetes n'ont point
de
fatellites, qu1
pmffent nous iadiouer l'intenfité de leur attratrion;
:mais voyant dans ies trois planetes dont les
denjités
font connues, une augmentation de
denjité
quand
o n apptoche du foleil,
il
efi tres-probable que cet
accroiífement a lieu également pour les trois autres
plaoetes. En eífayant de reconno'itre une loi dans
<:es augmentations, on v0it que les
denfltés
commes
font prefque proportionnelles aux racines des moyens
monveme-ns. Par exemple, le mouvement de la ter–
re eíl: environ
1 1
,
86 ;· celui
d-e
jupiter étant
1 ,
la
r.acine ell:
3-i- ,
la
denjité
de la ter-re en effet
J-i-
fois
-celle de jupiter ou environ. On peut done fuppofer
la meme proportion dans les autres planetes ; c'eíl:
ainíi
qt.t€
j'ai cakulé les
denjités
qui font rapportées
daos la table fuivante, ottl'on voit que celle de vénus
.eft un peu plus grande que celle de
la
te.rre.
. .La maífe de la lune,
&
par cQnféquent fa
denji-té
,
{.ont difliciles a déterminer exaél:emen.t' paree qu'el–
les fe manife:íl:ent par des phéqomenes que nous ne
p~)UVOns
mefurer avez aífez d'exaél:itude; je veux
d1re les hauteurs des marées,
&
la quantité de la
nutation de l'axe de la terre.
Si
les hauteurs des ma–
rées dans les fyzy-gies s'étant trouvées de fept pieds,
ne fontque tr-ois pieds dans les quadratures, en fuppo–
íant des circon:íl:ances pareilles , c'eíl:-a-dire ,
íi
les
grandes marées font
aHX
petites COmme
J-i-
efi
a
l ;-,
·la fomme des for.ces de la lune
&
du foleil doit erre
a
leur différeoce comme
Jf
eft a
1-i-;
ces forces fe–
·J:Ont done entr'elles comme
5
a
2; <:ar la fomme de
') &
de 2 efi
a
la différence comme
3f
eft
a
I±:
c'efi
le
rapport auquel s'en tient
M.
Berñoulli.
. Suppofons done la force du foleil
I ,
celle de
la.
lune
2~
; pour avoir la maífe de la lune, il fuffit de
favoir quelle eíl:'fa force' en la fuppofant
a
la dif–
Ulnee du foleil.
La force diminue en raifon inverfe
du
eube de la
-diíl:ance, q\.tand on la décompofe fur une direél:ion
différente de la primitive :
il
faut done multiplier
lu forc-e atlueUe de la lune par le cube de
~
•
57 3 "
qm
eíl: le rapport des parallaxes,
&
l'on aura la
maffe de la lune, eelle du foleil étant prife pour
u
nité;
mais la maífe de la t-erre efi feulement
m~o
o
de celle
au foleil;
il
faut done encore divifer la maífe trou–
vée par eette fraétion
&
l'on aura
-f¡
qui efi la maife
<le la lune , celle de la terre étant prife pour uniré.
La maífe de la lune
.,¡...;,
o u o o
1
3991 , étant diviféf!
-par fon volume qui eíl:
4 ', ,
o u
o,
0644, donne fa
<lenfitée o, 68706; c'eíl:-a-dire , que la
denjité
de la
lune efr feulement ,
7
0
de celle de la terre. C'e:íl: d'apres
ces diverfes méthodes que j'ai calculé les
denjités
des
planetes' par rapport
a
la terre , comme elles font
dans la table ci-jointe, en fraél:íons décimales de la
denjité
de la terre que nous prenons
pour
unité. Cette
table fuppofe la parallaxe du foleil dans fes moyennes
.Cifrances, de huit fe condes
&
demie, comme les ob–
{ervations du paífage de vénus, en 1769
~me
l'ont
donnée.
PLaaetes.
Denjités.
L/fo1ei1.,
o,255
'\
La terre,
I
La lune,
o,687
Mercure:t
2,0J8
Vénus,
1,27)
, Mars,
0,729
l
J
upiter,
o,230
Sa
turne,
o,104
~M.
DEL-.Á.
L4JVDE.)
DE P
-
PEN~IFORME
' adj.
e
A nat.
)
m~m
én rique
qm
expnme tour ce qui
ri
nt de
la
figure d une dent
On
app_~lle
particuli ' rement de ce nom
1
apophyi~
odontoide de la deuxieme vertebre du cou.
e+)
_DENT.I~TE'
f.
m.
e
Chirur.)
chirnrgien qui
S
ap..
phque fpecialei?ent a
~a
chir.nrgie des dents ,
a
t rai–
ter
l~urs
malad1es '·
&
a
prat1quer les opérations qui
ont lieu
fu~
;es part1es.
Les
qualités d'un bon
dentifh
~ont .pre~le!emer:t
celles
d'~n
bon chirurgien.
II
doit
ette enfuit;
1~ílnut
I?articuhéreJ?1ent
~e
tout ce qui
co-r:cerne
l
ob¡et de fon occupatwn ;
1l
doit avoir
le
po1~.net
fouple
&
fort,
&
s'etre par conféquent fin–
guhe~ernent
exercé a tirer des dents'
a
en plomber,
a
en hmer'
&
en un rnot
a
les
traiter méthodique–
ment
&
avec
fllreté~
(
+)
*
§
DEODANDE,
<<
en Angleterre, e:íl: un
ani–
~>
mal on une chofe inanimée, confifcable en quel..
»
que forte
a~
profit de Dieu..... Fiera dit que le
"
deodande
d01t etre vendu. . . . Fleta n'a pas faós
>-~
doate entendu que l'ame de cclui qui a été rué par
>-->le
deodande
n'eih pas de part aux prieres
>>•.
U
fe~ble
qu'on ait pris
Fleta
pt>ur
un no
m
d'hom–
me, rna1s c'eille no
m
d'un Comrnentaire ou ouvra–
ge_ de droit Anglois.
,Fleet
en Anglois fignifie une
pnfon;
&
on a donne le nom de
F leta
a
un livre
compofé par plnfieurs jurifconfultes dans une pri–
fon, fo9s Edouard
I,
en 1240.
Lettres fur L'En-–
cycto.pedie.
..
. J?ÉPENDANCE,
f.
f. (
Morale.)
c'ell: tout
aífu–
¡etnífement d'un etre
a
un autre etre quelconque.
Il
r
a deux fortes de
dépendances;
celle des chofes
qm_
eíl: de la nature ; celle des hommes qui eíl: de la
focrété.
La
dépendance
des choíes n'ayant autune
m~ralité'
n_e nuit point
a
la
liberté,
&
n'engendre
p0mt de VIces :
la
dépendance
des hommes étant
défordonnée les engendre t0us,
&
c'efi par elle que
le_ ma1tre
&
l'efclave fe dépravent mutuellement.
S'Il y a quelque moyen de remédier a ce· mal dans
la fociété ' c'eíl de fnbfiituer la loi
a
l'homme
&
d'armer les volontés générales d'une force rklle
f~périet~re
a
l'aél:ion de toute volonté particuliere.
St les lo1x des nations pouvoient avoir cornme cel–
les de la na:ure, une...
infle~bilité
que jamais aucune
force humame ne put vamcre; la
dépendance
des
hommes redeviendroit alors celle des chofes · on
r~tmiroit
dans la république tous les avantage's de
l~etat ~atu:el
a
7e?x de ,l'état civil; on joindroit
a
la
l1berte
qlll
mamtient 1homme exempt de vices la
rnoralité qui l'éleve a la vertu.
'
Le bonheur de l'homme efl en raifon inverfe dtt
n~mbre
des
dépendances.
La multiplication des be–
foms augmente les
dépendances,
&
nous éloigne
du
bonheur.
(D. F.)
DÉPOT LAITEUX' f. m.
e
Médecine.)
On
appelle
dépot laiteux
une maladie formée par le féjour du
lai~
?ans une partie quelconque du corps. Cette dé–
fimtiOn eft celle de
M.
Puzos, aans fes excellens
Mémoires f?r les
dipóts Laiteux
, dQnnés au pnblic
par
M.
Monfot Deilandes, médecin de Paris
a
la
fuite du
Traite des Accouchemens
de ce céleb;e chi–
rurgi~n,
imprimés
a
Paris, en 1_759. , chez Defaint
&
Salllant.
J
e ferai daos cet article un tres-urand
ufage des Mémoires que je viens de cirer ;
&
0
d'au–
tant plu-s, qu'une pratique aífez longue,
&
des ex–
pér· ces !1eureufes, m'ont fait fenrir combien
M.
Puzos mériroit de confiance. Jeme fuis également
pénétré des excellens confeils que préfente
le
Com·
mentai.rede
M.
le Baron \Vanfwieten, fur les
'3
29
&
(uivans Aphorifmes
de Eoerhave,
tom.JV, in-4°.
édition deCavelier,
a
Pa.ris, en 176 5. Apres cette
indication des fources précieufes Ott j'ai puifé , j'ef- –
pere qu'on ne trouvera pas mauvais
fi
quelque–
fois
j.e
fais
ufage
des idées de ces a uteurs,
fi
m
eme
















