
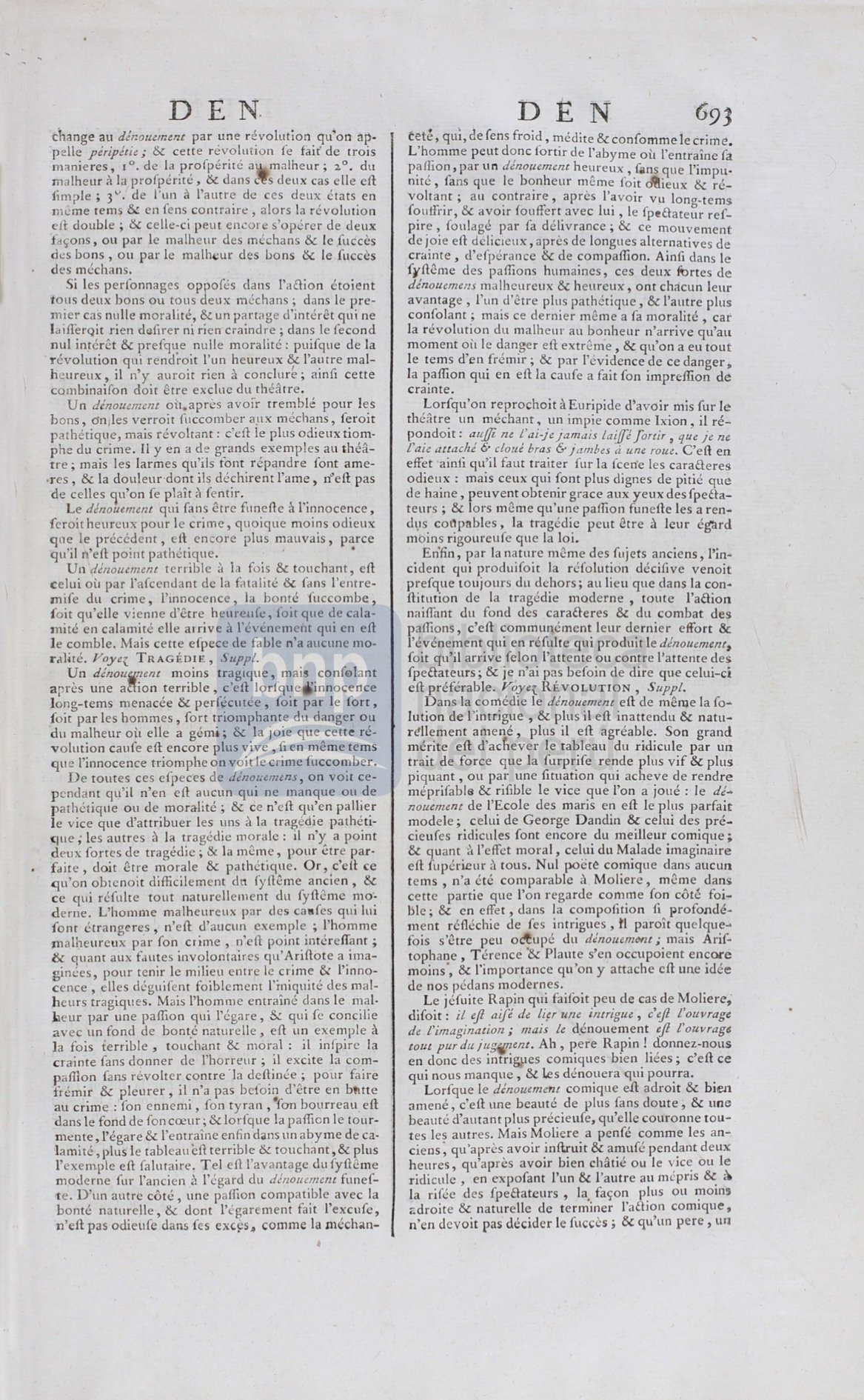
DE N.
change au
dir.ouement
par une révolution qu'on ap·
pelle
péripüie;
& cette révolutíon fe fait' de trois
manieres,
1°.
de la profpérit é
au
malheur;
2°.
du
malheur
a
la profpérité,
&
dans
C S
deux cas elle eft
fimple ;
3 •
de l'un
a
l'autre de ces deux états en
meme rems
&
en fens contraire, alors la révolurion
efi double ;
&
celle-ci peur en or s'op ' rer de deux
fac,;:ons, ou par le malheur des m' chans
&
le fucd:s
des bons, ou par le malheur des bons
&
le fucces
des méchans.
Si les perfonnages oppofés dans l'aél:ion étoient
tous deux bons ou tous deux méchans; dans le pre–
mier cas nuUe moralicé,
&
un panage d'intéret qni ne
laiífer<út rien defirer ni rierr c;aindre; dans le fecond
nul
in~éd~t
&
prefque nulle moralité: puifque de
la
révolution qui rendroit l'un heureux
&
l'aurre mal–
h e.ureux, il n'y auroit rien
a
conclur~;
ainú cette
combinaifon doit etre exclue du théarre.
Un
dénouement
oü apr s avo
i·r tremblé pour les
bons, dn
1
les verroit füccomber a.ux méchans, feroit
pathétique, mais révoltant:
e'
fr le plus odieux tiom–
phe du crime.
Il
y
en a de grands exemp!es au théa–
tre; mais les larmes qu'ils font répandre font ame–
res,
&
la douleur ·dont ils déchirent l'ame, n eft pas
de celles qu?on fe plait
a
fentir.
Le
dJnouement
qui fans erre fune.íle
á
l'innocence,
fcroit heureux pour le crime, quoique moins odieux
qne e précédent , eft encere plus mauvais, paree
qu'il
'eft po!nt pathétique.
·
•
Un
(Ünouement
terrible
a
la
fois
&
teuchant, efi
celui ou par
1
afcendant de la fatalité
&
fans l'entre–
rnife du crime, l'innocence, la bonté fuccombe,
{oit
qu'elle vienne d'etre heureufe, foit que de cala–
Jnité en cala
mi
té elle arri ve
a
l'événement quien efi
le comble. Mais cette efpece de fable n'a aucune mo–
r
d.
lité.
Voyez
TRAGÉDIE,
Suppl.
Un
dénouwzent
moins tragique, mais conf0lant
apres une ael:ion terrible, c'efi lorfque 'innecence
long-tems menacée
&
perfécutée, foit par le forr,
foit par les hommes, fort triomphante du danger ou
du malheur
oi1
elle a gémi; & la joie que cette ré–
volutien caufe efi: encere plus vive, fi en
me
me tems
que l'innocence triomphe on voit le crime fuccomber.
De toutes
ces
efpeces de
dénouemens,
on voit ce–
p cndant qu'il n'en efi: aucun qui ne manque ou de
pathétique ou de moralité;
&
ce n'efi qu'en pallier
le vice que d'attribuer les uns
a
la tragédie pathéti–
-c¡ue; les autres
a
la tragédie morale : il n'y a point
d eux fortes de tragédie; & la meme' pour etre par–
faite, doit etre morale
&
path 'tique. Or, c'eH ce
qu'on obtenoit difficilement dtt fyfieme ancien,
&
ce qui réfulre tout naturellement du fyfieme mo–
derne. L'hemme malheureux par des caafes qui lui
fonr étrangeres, n'efr d'attcun exemple ; l'homme
m alheureux par fon crime , n'efr point intéreffant;
&
quant aux fautes involontaires qu'Arifiote a ima–
oinées, peur tenir le milieu entre le crime
&
l'inno–
~ence ,
elles d 'guife nt foiblement l'i:niqnité des mal–
he urs tragiques. Mais l'hemme entrainé dans le mal·
Jaeur par une paffion qui l'égare ,
&
qui fe concilie
avec un fond de bont.é naturelle, efi un exemple
a
la
fois
terrible, touchant
&
moral : il infpire la
crainte fans donner de l'berreur; il excite la com–
p aillon fans révolter centre
'lá
defiioée; pour faire
frémir
&
pleurer, il n'a pas befoin d'etre en b tte
au crime : foo ennemi ' fon tyran'
ron
bourreau efi
dans le fond de fon creur; &lorfgue la paffien le tour–
m~nte,
l'égare
&
l'entraine enfin dans un abyme de ca–
lamité, plus le tableau (dlterrible
&
touchant,
&
plus
l'exemple efi falutaire. Tel efi l'avantage du fyfieme
moderne fur
l'ancier~
a
1'
J
gard dn
d 'nouement
fnnef–
t e. D'un autre coté, une paffion compatible avec la
bonté naturelle,
&
dent
1'
' garement fait l'excufe,
n'efipas odieufe dan$ fes
exc~s.-9
comme la méchan-
D
E
N
693
éeté,
qu~,
de fens freid, rnédite
&
cenfomme le
crimé
L'hornme peut
d~nc
fortir de l'abyme oú l'entraine
f~
P~f!ion,
par
un
denouement
he~reux,
fans que l'impu·
mte , fans que le bonheur meme feit o ieux
&
ré–
voltant ; au centraire, apres l'avoir vu lonv-tems
f<?uffrir,
&
a;oir fouffe:r. avec lui, le
fpeélate~r
ref–
plre , foulage par fa dehvrance ; & ce mouvement
de joie efr délicieux, apres de longues alternatives de
crainte., d'efpérance
&
de compaffion. Ainú dans le
fyfteme des paffions humaines,
ces
deux f'Ortes de
dénouemens
malheureux
&
heureux, ont chacun leur
avantage , l'un d'etre plus pathétique,
&
l'autre plus
confolant ; mais ce dernier meme a fa moralité
cat
la révolution du malheur au benheur n'arrive qu'an
moment eit le danger efi extreme,
&
qu'on a eu tout
le tems d'en .frémir;
&
par l'évidence de ce danger,.
la
~affion
qu1 en efi la caufe a fait fon impreffion de
cramte.
Lorfqu'on reprochoit
a
Euripide
d~avóir
mis fur le
théatre un méchant
~
un impie comme Ixion • il ré–
pondoit:
aufli ne L'ai-je jamais laijfé fortir q;e je ne
l'aie attaché
&
c!oué hras
&
j ambes
a
une
rou~.
C'ell en
effet ainfi qu'il faut traiter fur la fcene les caraél:eres
odieux : mais ceux qui font plus dignes de pitié que
de haine, peuvent obtenir grace aux yeux desfpeél:a–
teurs;
&
lers meme qu'une paffion funefte les a ren•
dus.
COL~pables,
la tragédi.e peut etre
a
leur ég"ard
moms rtgoureufe que la
lo1~
En"fin, par la nature meme des fujets anciens, l'in·
cident
qui
produifoit la réfolution déciúve veneit
prefque teujeurs du dehors; au líeu que dans la con..
fritution de la tragédie moderne , toute
l'aél:ion
naiífant du fond des caraéleres
&
du combat des
paffions, c'efi commttnément leur dernier effort
&
l'événement quien réfulte qui produit le
dénouement,
foit qu'íl arrive felon l'attente ou centre Pattenre des
fpeél:ateurs; & je n'ai pas befein de dire que celui-ci
efr préférable.
Voyez
RÉVOLUTION,
Suppl.
Dans la comédie le
dénouement
eft de memela fo ...
lution de !'intrigue ,
&
plus il efi inattendu
&
natu–
r(!llement amené, plus il eft agréable. Son grand
mérite efi d'achever le rableau du ridicule par un
trait de force que la furprife rende plus vif
&
plus
piquant , ou par une fituation qui acheve de rendre
méprifabla
&
rifible le vice que l'on a joué: le
dé–
nouement
de l'Ecole des maris en eft le plus parfait
modele; celui de George Dandin
&
celui des pré–
cieufes ridicules font encere du meiUeur comique;
&
quant
a
l'effet moral, celui du Malade imaginaire
efi fupéri.eur
a
tous. Nul poete comique dans aucun
tems , n'a été comparable
a
Moliere, meme dans
cette partie que l'on regarde comme fon coté
foi–
ble;
&
en effet, dans la compofition
fi
profondé·
ment réfléchie de fes intrigues, tl paroit
quelque-~
fois s'etre peu o
upé du
dénouemevzt;
mais Arif–
tophane, Térence
&
Plaute s'en occupoient encare
moins ·,
&
l'importance qu 'on y attache eft une idée
de nos pédans modernes.
Le jéfuite Rapin qui faifoit peu de cas de Moliere;
difoit:
il ejl aifé de li;r une intrigue, c'ejl l'ouvragé
de L'imagina.tion; mais le
d.énouement
ejl l'ouvragd
tout purdujug
ent.
Ah, pere Rapin! donnez-nous
en done des intrigues comiques bien liées; c'eft ce
qui nous manque,
&
les dénouera qui pourra.
Lorfque le
dénou.ement
comique
e.f1
adroit
&
bien
amené, c'eft une beauté de plus fans doute, & une
beauté d'autant plus précieufe, qu'elle couronne teu–
tes les atitres. Mais Moliere a penfé comme les an–
ciens: qu'apr s avoir iníl.ruit
&
amufé pendant deux
heures, qu'apres avoir bien chatié ou le
vic~
ou le
ridicule ' en expofant l'un
&
l'autre au tn épns
&:
a
la rifée des fpeétateurs , la. fac,;:on p!us ou
J?OI05
é:droite
&
naturelle de terminer l'aélwn com1que
9
n'en devoit pas décider le fucces;
&
qu'un pere, un
















