
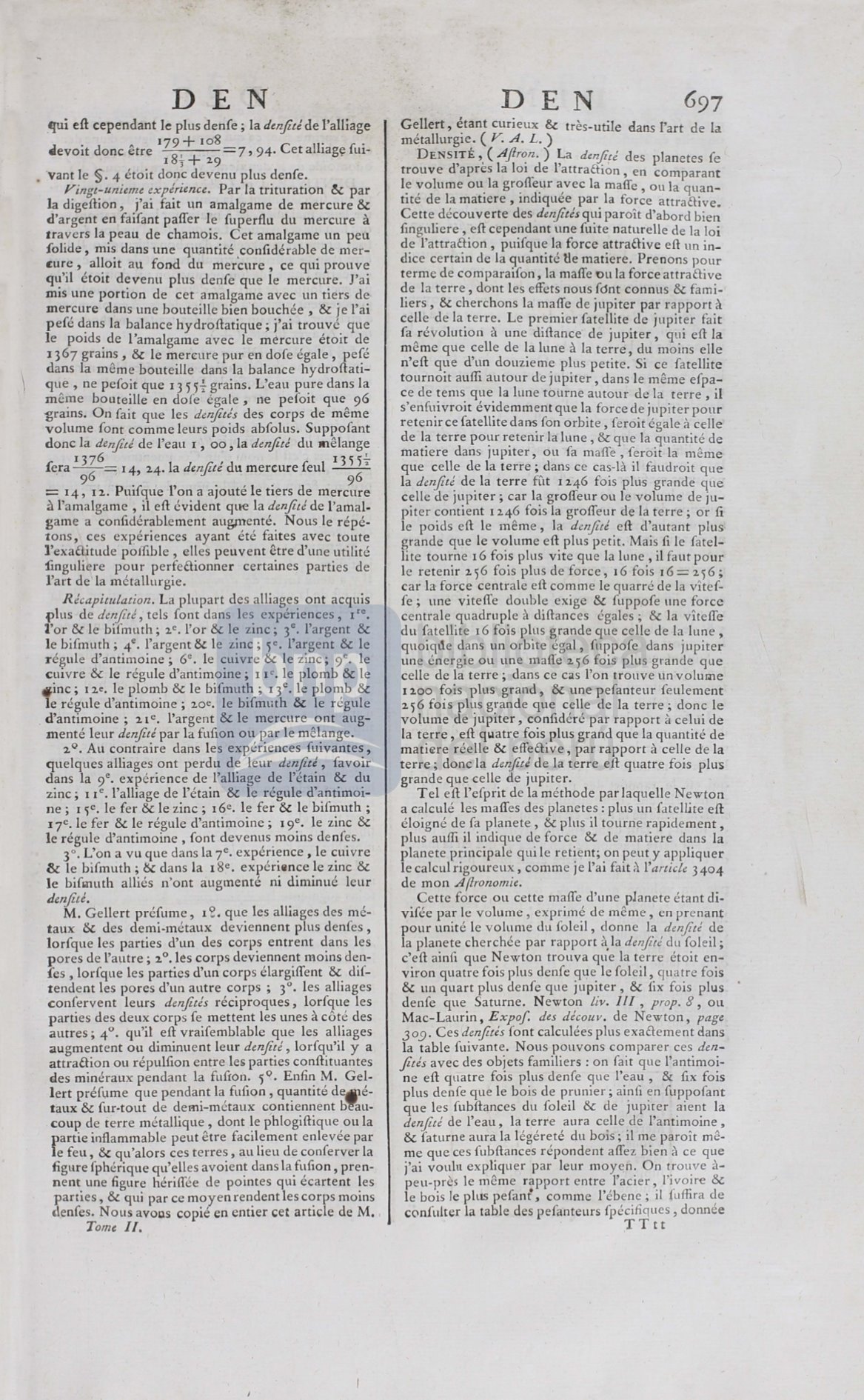
DEN
fiUi
efl: cependant le plus denfe ; la
denfité
de l'alliage
.
,..
179
+
ro8
tlevott done etre
8
,
+
7, 94· Cet
alliag~
fui-
I
T
29
·vant le
§.
4
étoit
done devenu plus denfe.
Yinge-unieme expérience.
Par la trituration
&
par
la digeftion, j'ai fait un amalgame de mercure
&
d'argent en faifant paífer le fuperflu du mercure
a
travers la peau de chamois. Cet amalgame un peú
folide, mis dans une quantité confidérable de mer–
cure' alloit au fond du mercure, ce qui prouve
qu'il étoit devenu plus denfe que le mercure. J'ai
mis une portion de cet amalgame avec un tiers de
mercure dans une bouteille bien bouchée
~
&
je l'ai
pefé daos la balance hydroftatique; j'ai trouvé que
le poids de !'amalgame avec le mercure étoir de
1
367 grains,
&
le mereure pur en dofe égale , pefé
dans la meme bouteille dans la balance hydrofrati–
qué, ne pefoit que
13
55f
grains. L'eau pure dans la
meme bouteille en dofe égale ,
rte
pefoit que 96
-grains. On fait que les
denfités
des corps de meme
volume font comme leurs poids abfolus. Suppofant
done la
denjité
de l'eau
I, 00,
la
denjité
du melange
íera
1
3
~
6
=
14, 24.
la
denfité
du mercure feul
1
35 5
-i-
9
p
·r
1'
.
' 1 .
d
5)6
=
14, 12.
u11qne on a aJOUte e uers e mercure
a
!'amalgame ' il eft évident que la
denfid
de l'amal–
game a confidérabLement aug¡nenté. Nous le répé–
tons, ces expériences ayant été faites avec toute
l'exaétitude poffible' elles peuvent etre d'une utilité
ftngulíere pour perfeél:ionner certaines parties de
l'art de 'la métallurgie.
Récapitulation.
La: plupart des alliages ont acquis
plus de
denjité;
tels font dans les expériences '
1
re.
l'or
&
le bifmuth;
2e.
l'or
&
le zinc;
3e.
l'argent
&
le bifmuth; 4e. l'argent
&
le zinc; ;e. l'argent
&
le
régnle d'antimoine ;
6e.
le cuívre
&
le zinc;
9e.
le
cuivre
&
le régule d'antimoine;
1
¡e.Ieplomb
&
le
inc;
1 2e.
le plomb
&
le bifmuth;
1
3e.
le plomb
&
le régule d'antimoine ;
2oe.
le bifmuth
&
le régule
d'antimoine ;
21
e.
l'argent
&
le mercure ont aug–
menté leur
denfité
par la fufion ou par le melange.
2
°.
Au contraire daos les expériences fuivantes,
quelques alliages ont perdu de leur
dmfité,
favoir
dans la
9e.
expérience de l'alliage de l'étain
&
du
zinc;
1
1e.l'alliage de l'étain
&
le régule d'antimoi–
ne;
1
;e. le fer
&
le zinc; 16e. le fer
&
le bifmuth;
1
7e.
le fer
&
le régule d'antimoine; 1
9e.
le zinc
&
le régule d'antimoine, font devenus moins denfes.
3
o.
L'on a vu que dans la
7e.
expérience , le cuivre
&
le bifmuth ;
&
daos la
I
Se.
expériince le zinc
&
le bifmuth alliés n'ont augmenté
ni
diminué leur
denjité.
M. Gellert préfume,
12
~
que les alliages des mé–
taux
&
des demi-métaux deviennent plus denfes ,
lorfque les parties d'un des corp.s entrent
~ans
les
poies de l'autre;
2
°.les corps dev1ennent moms den–
fes , lorfque les parties d'un corps élargiífent
'&
dif–
tend_ent les pores d'un autre corps ; 3°. les alliages
confervent leurs
denjités
réciproques, lorfque les
parties des deux corps fe mettent les unes
a
coté des
autres; 4°. qu'il eft vraifemblable que les alliages
aue1mentent ou diminuent leur
denfité,
lorfqu'il
y
a
att~aél:ion
ou répulfion
ent~e
les parties conftituantes
des minéraux pendant la fufron.
;~.
Enfin M. Gel–
lert préfume que pendant la fufion, quantité de.&lé–
taux
&
fur-tout de demi-métaux contiennent b'!"au–
coup de terre métalliqtte , dont le phlogiftique ou la
partie inflammable peut etre facilement enlevée par
le feu,
&
qu'alors ces terres, au lieu de conferver la
figlire fphérique qu'elles avoient daos la fufion, pren–
nent une figure hériífée de pointes qui écartent les
parties,
&
qui par ce moyen rendent les corps moins
denfes. Nous avoc.s copié en entier cet article de M.
Tome 11.
DEN
Gellert, étant curieux
&
tres-utile dans l'art de la
métallurgie.
(V.
A. L.)
DENS~TÉ
'· (
Aflr~n.) ~a
denjité
des planetes fe
trouve d apres la lo1 de 1attraél:ion, en comparant
1~
-yolume
ou.lagr<
?ífe.ur~vec
la maffe , ou la quan–
nte de la mat1ere, mdtquee par la force attraél:ive.
Cette découverte des
denfitésqui
paroit d'abord bien
:íinguliere , efi cependant une fuite naturelle de la loi
de l'attraél:ion, puifque la force attraél:ive efi un in–
dice certain de la quantité tle matiere. Prenons pour
terme de comparaifon, la maífe o u la force attraél:ive
de la terre, dont les effets nous fónt connus
&
fami–
liers'
&
cherchons la maífe de jupiter par rapport
a
celle de la terre. Le premier fatellite de jupiter fait
fa révolution
a
une difiance de jupiter' qui eft la
meme que celle de la lune
a
la terre' du moins elle
n'efr que d'un douzieme plus petite. Si ce fatellite
tonrnoit auffi autour de jupiter' dans le meme efpa–
ce de tems que la lune tourne autour de la terre, il
s'enfuivroit évidemment que la force de jupiter pour
reten ir ce fatellite
da~
fon orbite' feroit égale
a
celle
de
1~
terre
po~r r~temr
la !une ,
&
que la quantité de
rnatlere dans JUplter,
Oll
fa maífe, feroit la meme
que celle de la terre ; dans ce cas-la il faudroit que
la
denjité
de la terre füt
1
246
fois plus grande que
celle de jupiter; carla groífeur ou le volume de ju–
piter contient
1
246
fois la groífeur de la terre ; or fi
le poids eft le meme ' la
denfité
eft d'autant plus
grande que le volume eft plus petit. Mais file fatel–
lite tourne
16
fois plus vite que la lune, il faut pour
le retenir
2
56 fois plus de force ,
1
6 fois r6
==
2)
6 ;
car
la
force centrale eft comme le quarré de la vitef–
fe; une viteífe double exige
&
fuppofe une force
centrale quadruple
a
difrances égales ;
&
la viteífe
du fatellite r6 fois plus grande que celle de la lune,
qnoiqt\e dans un orbite égal, fuppofe daos jupiteJ;
une énergie ou une maífe
256
fois plus grande que
celle de la terre; dans ce cas l'on tronve un volume
I 200
fois plus grand,
&
une pefanteur feulement
256 fois plus grande que celle de la terre; done le
volume de jupiter' confidéré par rapport
a
celui de
la terre, eft quatre fois plus grand que la quantité de
mati€re réelle
&
effeél:ive' par rapport
a
celle de la
terre; done la
denfité
de la terre efr quatre fois plus
grande que celle de jupiter.
Tel eft l'efprit de laméthode parlaquelle Newton
a calculé les maífes des planetes: plus un fatellite efr
éloigné de fa planete ,
&
plns il tourne rapidement,
plus auffi il indique de force
&
de matiere daos la
planete principale qui le retient; on peut y appliquer
le calcul rigoureux , comme
j
e l'ai fait
a
l'
article
3404
de mon
Aflronomie.
Cette force ou cette maífe d'une planete étant di–
vifée par le volume' exprimé de meme' en prenant
pour unité le volume du foleil, donne la
denjité
de
la planete cherchée par rapporr a. la
denjité
du foleil;
c'eft ainfi que Newton trouva que la terre étoit en–
viren quatre fois plus denfe que le foleil, quatre fois
&
un quart plus denfe que jupiter,
&
fix fois plus ·
denfe que Saturne. Newton
liv. JI!, prop. 8,
ou
Mac-Laurin,
Expof. des découv.
de Newton,
page
3
09.
Ces
denfités
font calculées plus exaél:ement dans
la table fuivante. Nous pouvons comparer ces
den–
Jités
avec des objets familiers : on fait que l'antimoi-
ne eft quatre fois plus denfe que l'eau,
&
íix fois
plus denfe que le bois de prunier; ainfi en fuppofant
que les fubftances du foleil
&
de jupirer aient la
denfité
de l'eau, la terre aura celle de l'antimoine,
&
faturne aura la légéreté du bois; il me paroir
me–
me que ces fubftances répondent atfez bien
a
ce que
j'ai voulu expliquer par leur rnoyen . On trouve
a–
peu-pres le meme
r~pport
entre yacier '· l'ivoire
&
le bois le plus pefant, comme l'ebene;
1l
fuffira de
c0nfulter la table des pefantenrs fpécifi ques, donnée
,TTtt
















