
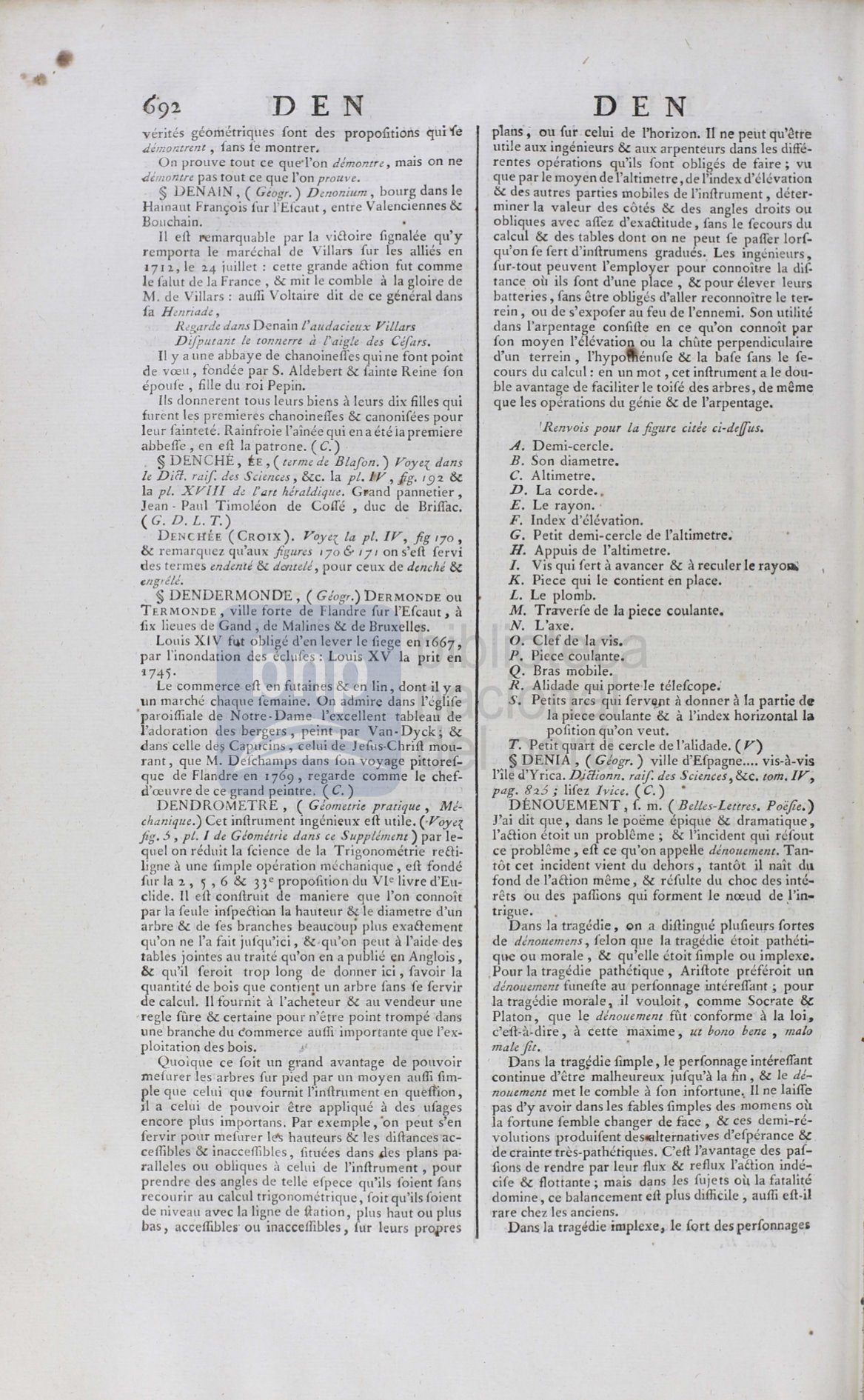
DEN
v érités géómétriques font des propofrtions qui íe
démontrent,
fans fe montrer.
On prouve tour ce que·l'on
démontre,
mais on ne
-démontre
pas rout ce que l'on
prouve.
§
DENAlN,
e
Giogr.) D enonium,
bour_g dans le
Hainaut Frant¡ois fur l'Efcaur, entre Valenciennes
&
Bouchain.
Il
efi 1-emarquable par la viéloire fignalée qu'y
r emporta le maréchal de Villars fur les alliés en
I
71
2,
le
24
juillet : cette grande aétíon fut comme
le falut de la France,
&
mit
le
comble
a
la gloire de
M.
de Villars : auffi Voltaire dit de ce général dans
fa
H .mriade
~
R cgarde dans
D~nain
l'audacieux Pillars
D ifputant le tonnerre
a
l'aigle des Céfars.
Il
y
a
une abbaye de chanoineffes quine font point
de vreu , fondée par S. Aldebert
&
fainte Reine fon
époufe , filie du roi Pepin.
lis donnerent tous leurs biens
a
leurs dix filies qui
fur ent le;5 premieres chanoineffes
&
canonifées pour
le
m
fainteté. Rainfroie 1ainée quien a été
ía
premiere
abbeífe ' en
e~
la patrone.
e
c.)
. §DENCHE,
ÉE,
e
tume de B
lafon.)Voyet_ dans
le Diél. raif. des Scienc¿s,
&c. la
pl.lP,fig.
192
&
la
pl. XVIII
d~
l'art héraldique.
Grand pannetier,
Je an- Paul Timoléon de Coffé , duc de Briífac.
(G. D. L. T.)
DENCHÉE
e
CRorx).
Voyet_ la pl. IV, fig
IJO'
&
remarquez qu'aux
figures
170
&
'7'
on s'eft fervi
des termes
endeníé
&
dr:ntelé,
pour ceux de
denché
&
engreLJ.
§
DENDERMONDE, (
Géogr.)
DERMONDE
ou
TERMONDE'
ville forte de Flandre fur l'Efcaut'
a
:fix lieu es de Gand, de Malines & de Bruxelles.
. Louis XIV
f~t
obligé d'en lever le fiege en
1667,
par
1
inondation des éclufes : Louis
XV
la prit en
i745·
Le commerce efi en futaines
&
en lin, dont
il
y
a
tm
marché chaque femaine. On admire dans l'églife
'paroiffiale de Notre -Dame l'excellent tablean de
l'ado ration des hergers, peint par Van-Dyck;
&
dans celle de$ Capucins, celui de
J
efus-Chrifi mou–
rant, que
M.
Defchamps dans fon voyage pittoref–
que
de Flandre en 1769, regarde comme le chef–
d'reuv re de ce grand peiotre.
(C.)
DENDROMETRE,
e
Géometrie pratique,
Mé–
~hanique.)
Cet inílrument ingénieux eíf utile.
(·Voyez
fig• .5, pt. 1 de Géométrie dans ce Supplément)
par le–
qu.elon réduit la fcience de la Trigonométríe reéli–
}jgne
a
une :limpie opération m
1
chanique' efi fondé
fur la
2,
5 ,
6
&
33
e
propofition du VI
e
livre d'Eu–
clide. Il efr confiruit de maniere que l'on connoit
par la feule infpeaioo la hauteur
~le
diametre d'un
arbre
&
de fes branches beaucoup plus exatl-ement
qu'on ne l'<¡t fait jufqu'ici' & .qu'on peut a l'aide des
tables jointes au traité qu'on en a publié en Anglois,
&
qu'11 feroit trop long de donner ici, favoir la
quantité de bois que conüent un arbre fans fe fervir
tle calcul. ll fournit a l'acheteur
&
au vendeur une
·regle fUre
&
certaine pour n'etre point trompé dans
une branche du c·ommerce auffi importante que l'ex-
ploitation des bois.
1
Quoique ce foit un grand avantage de ponvoir
rnefure r
les
arbres fur pied par un moyen anffi fim–
ple que celui
qu~
fournit l'infrrument en queítion,
.Ji
a celui de pouvoir etre appliqué a des ufages
encore plus importans. Par exemple, ·on peut s'en
fervir ponr mefurer lets hauteurs
&
les difiances ac–
ceffibles
&
inacceffibles , fituées dans des plans pa·
ralleles ou obligues a celui de l'infrrument ' pour
prendre des angles de telle efpece qu'ils foient fans
recourir au calcul trigonométrique, foit qu'ils foient
de niveau avec la ligne de ítation, plus haut ou plus
has,
acceffible~r
ou inacceilibles, fur leurs pro¡>res
/
DEN
pl~ns
;
o~
fu;
~elui
de l'horizon. I1 ne peut
qu'~tre
uule aux mgemeurs
&
aux arpenteurs dans les diffé–
rentes opérations qu'ils font obligés de faire ;
vu
que par le moyen de l'altimetre, de l'index d'élévation
&.
des autres parties mobiles de l'iníl:rument, déter–
mu~er
la valeur des cotés
&
des angles droits ou
obligues avec affez d'exaélitude, fans le fecours du
calcul
&
des tables dont on ne peut fe paífer lorf–
qu'on fe fert d'infirumens .gradnés. Les ing ' nieurs,
fur-tout peuvent l'employer pour connoitre la dif.
tance oi1 ils font d'une place ,
&
pour élever leurs
batteries' fans etre obligés d'aller reconnoitre le ter–
rein, ou de s'expofer au feu de l'ennemi. Son utilité
dans l'arpentage confifie en ce qu'on connoit par
fon moyen l'élévation ou la chute perpendiculaire
d'un terrein, l'hypo énufe
&
la bafe fans le fe–
cours du calcul: en un mot, cet infrrument a le dou–
ble avantage de faciliter le toifé des arbres' de meme
que les opérations du géhie
&
de l'arpentage.
1Renvois pour la figure citée ci-dejfus.
A.
Demi-cercle.
B.
Son diametre.
C.
Altimetre.
D.
La corde.
E~
Le rayon.
F.
Index d'élévation.
G.
Petit demi-cercle de l'altimetre;
H.
Appuis de l'altimetre.
l.
Vis qui fert a avancer
&
a
reculer le
rayo~
K.
Piece qui le contient en place.
L.
Le plomb.
M.
Traverfe de la piece coulante.
N.
L'axe.
O.
Clef de la
vis•
P.
Piece coulante.
Q.
Eras mobile.
R.
Alidade qui porte le télefcope;
·
S.
Petits ares qui ferVfYlt
a
donner
a
la partie
de
la piece coulante
&
a l'index horizontal
la
·pofition qu'on veut.
T.
Perit quart de cercle de l'aüdade.
(V)
§
DENIA, (
Géogr.)
viJle d'Efpagne.... vis-a-vis
l'ile
d'Y
rica.
DJélionn. raif. des S ciences,
&c.
tom. IV,
pag.
?25;
lifez
1-více.
e
c.)
.
DENOUEMENT
~f.
m.
e
Belles-Lettres. Poiifie.)
J'ai dit que, dans le poeme épiqne
&
dramatique,
l'aaion étoit un probleme;
&
l'incident qui réfout
ce probleme, efi ce qu'on appelle
dénouement.
Tan–
tot cet incident vient du dehors, tantot il nait dll
fond de l'atl-ion m
eme~
&
réfulte du choc des inté–
.rets ou des paffions qui forment le nreud de .!'in-
trigue.
.
Dans la tragédie, on a difiingné pluíieurs fortes
de
dénouemens,
felon que la tragédie étoit pathéti–
qLte ou morale,
&
qu'elle étoit :firpple ou implexe.
.Pour la tragédie pathétique , Arifrote préféroit un
dénouement
funefie au perfonnage intéreífant ; pour
la tragédie morale, il vouloit , comme Socrate
&
Platon, que le
dénouement
fla
·conforme
a
la loi,
c'efr-a-dire, a cette maxime,
Ut bono bene
,
malo
male jit.
·
Dans la
trag~die
funple, le perfonnage intéreífant
continue d'etre rnalheureux jufqu'a la :fin,
&
le
dé–
nouement
met le cornble a fon infortune. Il ne laiífe
pas d'y avoir dans les fables fimples des
momens
ou
la fortune femble changer de tace ,
&
ces demi-ré–
volutions produifent des.alternatives d'efpérance
&
de
craintetn~s-pathétiques.
C'eil: l'avantage des paf–
flons de rendre par leur flux
&
re~ux
l'aaion ind.é:
cife
&
flottante; mais dans
les
fuJets ou la fatahte
domine, ce balancement efi plus difficile, auffi efi·il
rare chez les anciens.
Dans la tragédie implexe, le
fort
des perfonnage¡
















