
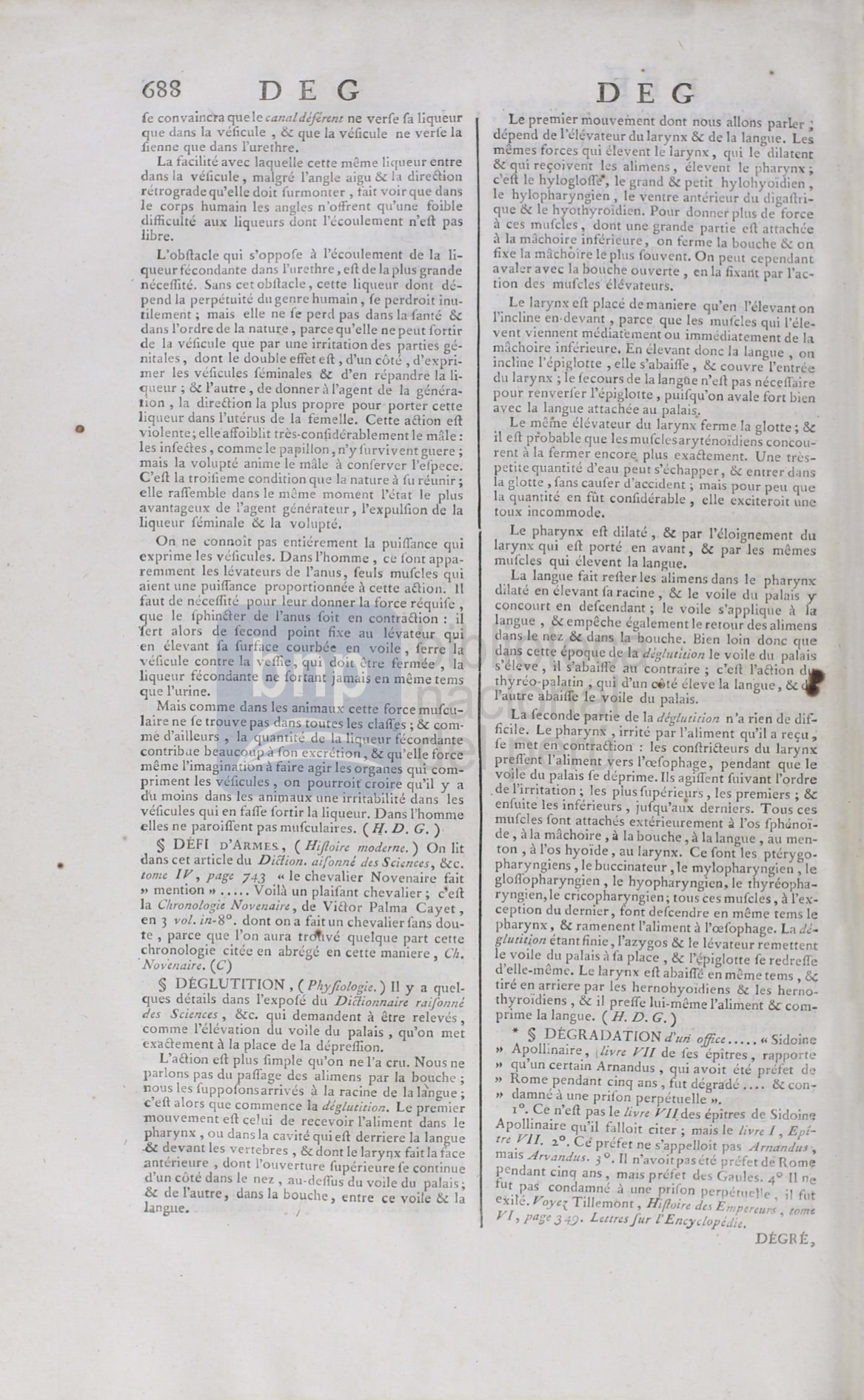
688
DEG
fe convaincra que le
canal défilrent
ne verfe fa liqueur
que dan la véficule ,
&
que la
v
1
ficule ne verfe la
:fienne que dans rurethre.
La facilit' avec laquelle cette meme
Iique~tr
en.tre
daos la véficule, malgr
1
l'angle
ai!t~
&
l~
d1reébon
r
1
rrograde qu'elL doir furmonter ,
tatr
vou que
~ans
le corps humain les angles n'offrenr qu'une, f01ble
diffi
ulr
1
aux liqueurs donr
1'
' coulement n ft pas
libre.
L'obftacle qui s'oppofe
a
l'écoulement de la li–
queur fécondante daos l'urethre, eft de la plus grande
· n 'ceffité. Sans cet obfiacle, cette liqneur donr d
1
-
pend la
perpé~uit '
du genre humain,
{e
perdroit }nu–
tilement ·
ma~s
elle ne fe percl pas daos
la
fante
&
dans l'ordre de la narure, paree qu'elle ne peut fortir
de la véficule que par une irritation des parties gé–
nitales' dont le double effet efi, d'un coté' d'expri–
mer les v
l fi
ules íi' minales
&
d'en répandre la li–
queur;
&
l'autre' ele donner
a
l'agent de la généra–
tion , la direétion la plus propre pour porter cette
liqueur dans l'utérus de la femelle. Cette aaion eft
violente; elle affoiblit tres-confidérablement le male:
les infefres, commc le papillon, n'y furvivent guere;
mais la volupté anime le male
a
conferver l'efpece.
C'eíl: la troiiieme condirion que la nature
a
fu réunir;
elle raífemb-le daos le
m~me
moment l'état le plLts
avantageux de l'agent générateur, l'expulfion de la
liqueur féminale
&
la volupté.
On ne
~onno1t
pas entiérement la puiífance qui
exprime les véficules. Dans l'homme , ce font appa–
remment les lévateurs de l'anus, feuls mufcles qui
aient une puiífance proportionnée
a
cette aél-ion.
ll
faut de néceffité pour leur donner la force réquife ,
que le fphinfrer de l'anus foit en contraél-ion : il
·fert alors de fecond point fixe au lévateur qui
·en
,levant fa furface conrbée en voile, ferre la
véficule contre la veffie' qui doit etre fermée ' la
liqueur fécondante ne fortant jamais en meme tems
que 1\trine.
Mais comme dans les animaux cette force mufcu–
laire ne fe trouve pas dans toutes les claífes;
&
coro–
me d'aill.eurs , la quantité de la liqueur fécondante
contriblle beaucoup
a
fon excrétion'
&
qu'elle force
meme l'imagination
a
faire agir les organes qui com–
priment les v lficules, on pourroif croire qu'il y a
d'u moins daos les anhnaux une irritabilité dans les
véficules quien faífe fortir la liqueur. Daos l'homme
elles ne paroiífent pas mllfculaires.
e
lf..
D. G.
)
§
DÉFI
n'ARMEs.,
(Hifloire moderne.)
On lit
rlans cet article du
Diélion. aifonné des Scimces,
&c.
tome
117,
page
743
«le chevalier Novenaire fait
, mention ,, ..... Voila un plaifant chevalier ; e eft
la
Clzronologie Noveuaire,
de Viél-or Palma Cayet,
en
3
vol. in-8°.
dont on a fait un chevalier fans do
u–
te , paree que l'on aura tro lVé quelque part cette
chronologie citée en abr
1
gé en cette maniere ,
Cll..
.
Novúzaire .
e
C)
§
DÉGLUTITION,
e
Phyjiologie.)
Il
y a quel–
ques dérails daos l'expofé du
Diélionnaire raifonné
des Sciences
,
&c. qui demandent
a
etre relevés ,
comme l'élévation du voile du palais , qu'on met
exaaeme_nt
a
la place de la dépreffion.
L'aél-ion efi plus fimple qu'on ne l'a cru. Nous ne
parlons pas du paífage des alimens par la bouche;
nous les fuppofons arriv
1
S
a
la racine de la langue;
e'
fi alors que cornmence la
déglutition.
Le premier
mouvement efi ce1ui de recevoir l'aliment daos le
pharynx , o u daos la cavité qui eíl: derriere la langue
.&
devant les vertebres ,
&
dont le larynx fait
la
face
ant ' rieure , dont l'ouverture fupérieure fe conrinue
d
un coté daos le nez' ..au-deífus du vo"le du palais;
&
de 1autre, dans la bouche, entre ce voile
&
la
langue.
1
DEG
Le premier mou ·ement don nous allons parkr
dépend de 1'
'1
va eur du larynx
~
d
la langue. Les
memes forces qui
e\ ent
le
laryn.' qui le
ilat
nc
&
qui
re~oi
ent
1
s alimens,
le ·enr
l
phar}
n. ;
c'eft le hylogloífe", le grand
'petit hylohyoidien
le hylopharyngien
,
le ventre ant
1
rieur dn digai
ri–
que
&
le hyorh ·roidien. Ponr onncr plus e for e
a ces mufcles, dont une grande partie
íl:
artach
~e
a
la machoire inf;' rieure' on ferrne la bonche
• on
fixe la machoire le plus fouvent. On pem
e
p nclant
avaLr avec la bouche ouverte, en
1
fi.·artt par
1
a
~
tion des mufcl s 'lévateurs.
Le larynx eft placé de maniere qu en
1
llevant on
!'incline en-devant, paree que les mufc esqui
1'
lle–
vent viennent m
1
diatement ou immediatement de
la
machoire inf;'rieure. En ' levant done la langne ,
on
incline l'épiglotte , elle s'abaiífe,
&
couvre
1
entr '
du laryn. ; le
{eco
1rs de la langoe n'
!l:
pas n
1
ceílaire
pour renverfer l'épiglotte, puifqu on avale fort
bi
n
avec la langue atta hée au palais.
Le merne él' vat ur du larynx ferme la glotte;
&
il
efi probable qu
les mufclesaryténoidiens concou–
rent
a
la
fermer encore plus exaélement. Une tres–
perite quantité d'eau peut s' ·chapper,
&
entrer dans
la glotte , fans caufer d'accident; mais pour peu que
la quantité en
fltt
confid 'rabie , elle exciteroir un
toux incommode.
Le pharynx efi dilaté,
&
par l'éloignement du
larynx qui efi porté en avant' & par les memes
mufcles qui élevent la langue.
La langue fait refl:er les alirnens daos le pharynx
dilaté en élevant fa racine , & le voile du palais
y
concourt en
def~endant
; le
oile s'applique
a
la
langue ,
&
empeche 'galement le re tour des alimens
daos le nez
&
daos la bouche. Bien loin done que
dans cette époque de la
drJgLruÍ.tion le
voile du palais
s'éleve , il s'abaiífe au contraire ; c'eíl: l'aél-ion d
thyr
1
o-palatin , qui d'un "té éleve la langue,
&
l'autre abaiífe
le
voile du palais.
La fe conde partíe de la
dffgltuition
n
'a
ríen de dif–
ficile. Le pharynx , irrité par l'aliment qu'il a rec;u.,
fe met en contraél-ion : les conftriél-eurs du larynx
preífent l'aliment vers l'cefophage, pendant que le
voile du palais fe déprime. Ils agiífent fuivant l'ordre
. de l'irritation ; les plus fupérieurs, les premiers ;
&
enfuite les inférieurs, jufqu'aux derniers. Tous ces
mufdes font attachés extérieurement
a
l'os fph, no!–
de'
a
la machoire
'a
la bouche
'a
la langue' au meo–
ton ,
a
l'os hyo1de, au larynx. Ce font les ptérygo–
pharyngiens , le buccinateur, le mylopharyngicn , le
gloífopharyngien , le hyopharyngien, le thyréopha–
ryngien, le cricopharyngien; tous ces mufcles'
a
l'ex–
ception du dernier' font defcendre en meme tems le
pbarynx,
&
ramenent l'aliment
a
l'refophage.
La
dJ–
glutition
étantfinie, l'azygos & le lévateur rernettent
le voile du palais
afa
place ' &
l
piglotte fe redreífe
d'elle-meme. Le larynx eft abaiífé en meme tems,
&
tiré en arriere par les hernohyo.idiens
&
les herno–
thyro!diens , & il preífe lui-meme l'aliment & com–
prime la langue.
(H. D.G.)
*
§
J?É~RADATION
d'mi o.ffice .....
<<
Sjdoine
H
Apoll naife,
divre
VII
de fes
'pirres, rapporre
H
qu'un certain Arnandus , qui avoit été préfet d
»
Rome pendant cinq ans , fut dégrad
1
••••
&
con
t>
damné
a
Une prifon perpétuelle
H .
I
0
•
Ce n' ft pas le
livre
VII_
des épitres de
Sidoin~
Apollinaire qu'il
[;
lloit citer; rnais le
livre
1, Epí–
tre _Vil.
2°.
Ce pr
1
fet ne s appelloit pas
Arnandtt3,
ma1s
Arvandus.
3
°.
Il
n avoitpasété préfet de Rome
pendant cinq ans, mats pr
'fer des
Gaules. 4°
11
ne
fut pas condamn
1
a
une prifon perpér
1e 'e
j
fut
exilé.
Voye{
Tillernont,
Hifloire des
EP
pereurs
tome
P1,
page
3
4.9 .
L
ttr,
sfur
l'
Ency lop die.
DÉGPÉ,
















