
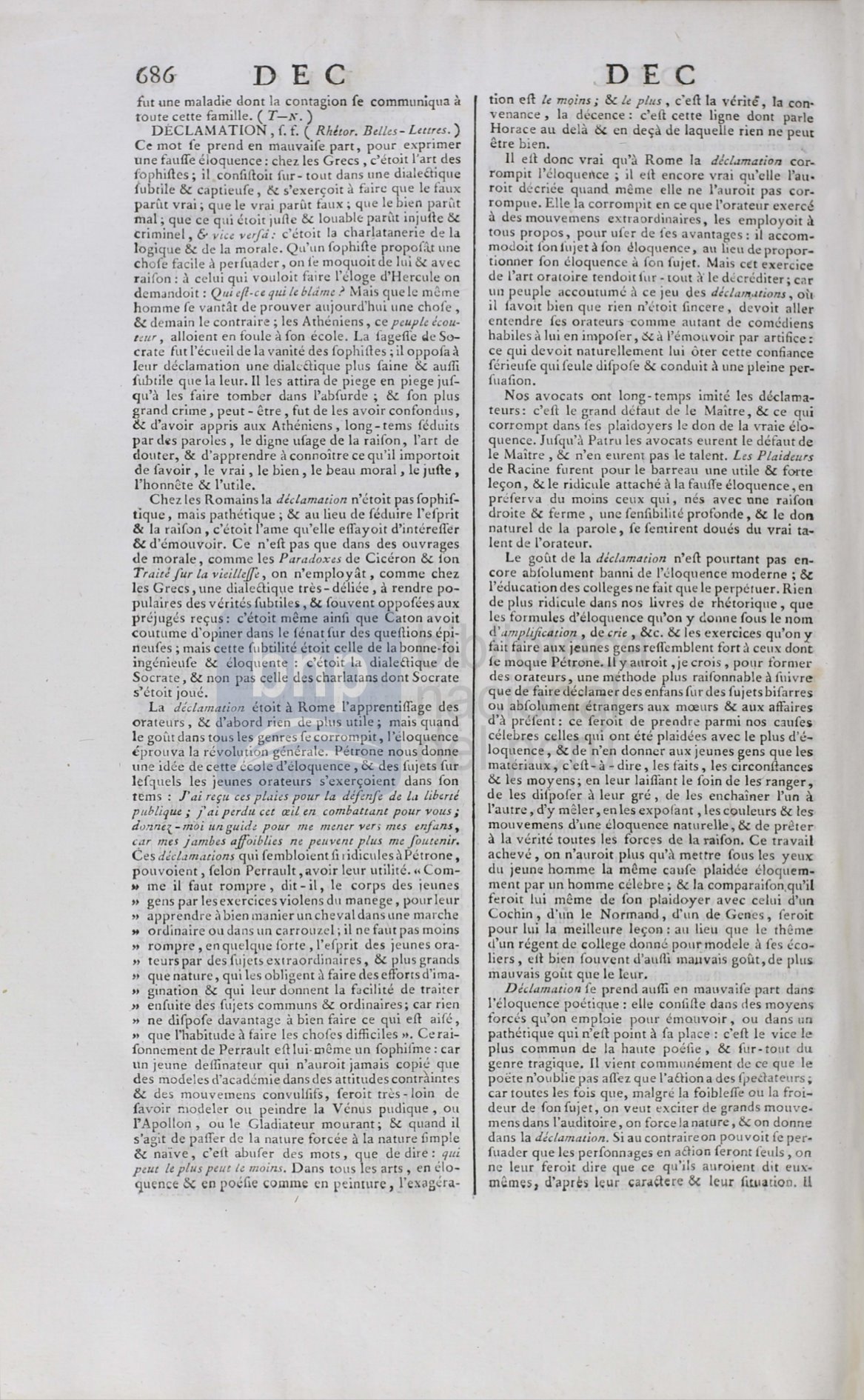
686
DEC
f ut une mala die dont la contagien fe communiqua
a
to ure cette famille.
e
T
-K.)
DÉCLAMATION,
f.
f. (
Rhitor. B!!lles - Leures.)
Ce
mot fe prend en mauvaife parr, pour exprimer
nne fauífe é oquence: chez.les Crees,
c~étoit
l'art des
fophiftes;
il
confifioü fur- tout daos une dialeaiqne
fubrile & captieufe,
&
s'exer~oir
a
fairc
q~e
le faux
partu
vrai; que le
vrai parur fa ux; que le
b~~~
parut
mal; que ce quí '
lO.Ítjuile
&
louable pana InJufie
&
criminel,
&
vice v erfá :
c'étoit la
char~atanerie
de la
logique
&
de la morale.
Qu
~tn fophi~e
progontt une
chofe facile
a
perfuader'
011
{e
moquolt de
hu
&
a vec
rai fon:
a
celui qui ouloit fa ire
l
éloge d'Hercule on
dem ndoit:
Qui efl- ce qui Le bláme?
Mais que le me me
homme fe vantat de prouver anjourd hui une chofe,
&
demain le contraire; les Athéniens, ce
p euple
é
ou–
t
ur,
alloient en foule
a
fon école. La fageífe de So–
era te fut l'écueil de la vanité des foph ifies; il oppofa
a
leur déclamation une dial -él:ique plus faine
&
auffi
{u.btile que la leur.
11
les attira de piege en piege juf–
qu'a
les faire tomber dans l'abfurde ;
&
fon plus
grand crime' peut- etre' fut de les avoir confondus,
&
d'avoir appris aux Athéniens, long-
tems
féduits
par
d~s
paro les , le digne ufage de la raifon, l'art de
douter,
&
d'a-pprendre
a
connoitre ce qu'il importoit
de favoir, le vrai, le bien, le beau moral, le jufie,
l'honnete
&
l'utile.
Chez.les Romains la
déclamation
n' ' toit pas fophif–
t'ique, mais patbérique; & au lieu de féduire l'efprit
&
la raifon, c'étoir l'ame qu'elle e!fayoit d'intéreífer
&
d'émouvoir. Ce n'eft pas que daos des ouvrages
de morale , comme les
P
aradoxes
de Cicéron
&
fon
Traité fur la
vieill~,
on n'employat, comme chez.
les Grecs' une dialeéliqt,Ie tres- déliée'
a
rendre po–
pulaires des vérités fubtiles,
&
fouvent oppofées aux
préjugés rec;:us: eétoit meme ainíi que Caron avoit
<:outume d'opiner dans le fénat.fur des quefiions épi–
neufes; mais cette fubtilité étoit celle de la bonne-foi
ingénieufe
&
éloquente : c'étoit la dialeétique de
So erare,
&
non pas celle des charlatans dont Socrate
s'étoit joué.
La
déclamation
étoit aRome l'apprentiífage des
orateurs,
&
d'abord ríen de
p~us
utile; mais quand
le gol'tt daos tous les genres fe corrompit,
1
'éloquence
éprouva la révolution générale. Pérrone nous donne
une idée de cette école d'éloquence,
&
des fujets fur
lefquels les jeunes orateurs s'exerc;:oient dans fon
tems :
J'
aire fu ces
pl,zi~s
pour la définfe de L' Liberté
publique;
j'
ai perdu cet aúl en combattant pour vous;
dvnnet.-moi
unguid~
pour me menu ver; mes enfans,
Cflr
mes
j
ambes affoiblies ne peuvem plus me fouunir.
Ces
déclamations
qui fembloient fi tidicules
a
Pétrone,
pouvoient, felon Perrault, avoir leur milité.'< Com–
~
me il faut rompre, dit- il, le corps des 1eunes
" gens par les exercices violens du manege, pour leur
" apprendre
a
bien manier uncheval dans une marche
»
ordinaire ou daos un carrouzel; il ne
faur
pas moins
,. rompre, en quelque forre, l'efprit des jeunes ora–
" teurs par des fujers extraordinaires,
&
plus grands
" que nature' qui les obligent
a
faire des efforrs d'ima–
,.) gination
&
qui leur donnent la facilité de traiter
.>'
enfuite des fujers communs & ordinaires
; car ríen
" ne difpofe davantage
a
bien faire ce qui
e.fiaifé '
,) que l'habitude
a
faire les chofes difficiles
H.
Ce rai–
fonnement de Perrault eft lui-meme un fophifme: car
un jeune deffinateur qui n'auroit jamais copié que
des modeles d'acad
1
mie daos des attitttdes contrAintes
&
des mo1.1vemens convul:fifs, feroit tr ' s -loin de
favoir modeler ou peindre
la V
énus pudique , o
u
l'Apollon, ou le Gladiateur moL ral)t;
&
quand
il
s'agit de paífe r de la nature forcée
a
la nature fimp le
&
naive, c'eíl: abufe r des mots, que de dire:
qui
peut lep lus peut
ü.
moins.
Dans tous les arts, en 'lo–
quence
&
en po ' fie comme
en
peinrure,
l'exog ' ra-
/
DEC
tion efi:
le moins;
&
L~
p lus,
c'eft la
vérité, Ja
con·
venance
~
la d cence: e efi: cette }jgne dont parle
~orac.e
au d la
&
n
dec; de laquelle rien n peut
etre b1en.
Il
eft done vrai qu'a Rome
la
d 'c!umation
co.r~
ro~pir l'~! oquence
; il el encore vrai qu elle
1
au.
roH d cnee quand m"me elle ne l'auroü pas cor–
rompue. Elle la corrompit en ce que l'orateur exercé
a
des mouvemens ex traordinaires' le
employoir
a
tous
~ro.pos_,
.pour ufer de fes a antages:
il
accom–
~o
Olt ÍOn
J~ljet
a
fon
é!oquen~e,
au
l~eu
de propor–
tlOnner fon eloquence
a
fon UJet. Mat cet exercice
de l'art oratoire tendoic fur- tout
a
le d .cr ,di ter. car
llll
peuple accoutumé a ce jeu des
dé
lamutiorzs'
on
il
fa voit bien que ríen n'
1
toit fiocere, d voit ;ller
encendre fes orateur --comme autant de comédiens
habiles
a
lui en impofer'
&a
1'
1
mouvoir par artifice:
ce qui devoit naturellement lui óter cette confiance
{¡ '
rieufe qui fe ule difpofe
&
concluir
a
une pleine per–
fuafion.
Nos avocats ont long- temps imité les déclarna–
teurs: e'
fr
le granel déhwt de le Maitre,
&
ce
qui
corrompt dans
f es
plaidoyers le don de la vraie élo–
quence.
J
ufqu'a Patrules avocats eurent le défaut de
le Maitre,
&
n'en eurent pas le talent.
Les Plaideurs
de Racine furent pour le barreau une utile
&
forre
lec;on,
&
le ridicule actaché
a
la fauíf-e éloquence en
pr ' ferva du moins cenx qui, nés avec nne raifon
droite
&
ferme, une fenfibilité profonde,
&
le doB
naturel de la parole, fe femirent doués du vrai ta·
lent de l'oratenr.
Le gofn de la
déclamation
n'efi pourtant pas en–
core abfolument banni de
1'
lloquence moderne;
&
l'éducation des colleges ne fait que le perpéruer. Rien
de plus rid. cule dans nos livres de rhétorique, que
les formules d'éloquence qu'on
y
donne fous le nom
d'amplification,
de
crie,
&c.
&
les exercices qu'on
y
fait faire aux jeunes gens reífemblent forra ceux dont
íe
moque Pétrone.
lL
y auroit , je crois , pour formeL·
des orareurs, une méthode plus raifonnable
a
fui vre
que de faire déclame r des enfans
fúr
des fu jets bifarres
ou abfolument étrangers aux mreurs
&
aux affaires
d'a
préfent: ce feroit de prendre parmi nos canfes
célebres celles
qni
ont éré plaid ' es avee le plus d'é–
loquence,
&
de n'en donner aux jeunes
~ens
que les
matériaux, c'efi-
a-
dire, les faits, les ClrConfranceS
&
les moyens; en leur laiífant le foin de leS' ranger,
de les difpofer
a
leur gré' de les enchainer l'un
a
l'autre, d'y meler' en les expofant 'les couleurs
&
les
mouvemens d'une éloquenee naturelle,
&
de prther
a
la vérité toutes les forces de la raifon. Ce travail
achevé, on n'auroit plus qu'a mettre fous
les
yeux
du jeune homme la meme canfe
plaid1
e éloquem–
ment par un homme célebre;
&
la
comparaifon.qu'il
feroit lui meme de fon ptaidoyer avec celui
d'un
Cochin, d'un le Normaod, d'un de Genes, feroit
ponr
lui
la meitleure
le~on:
au lieu que le theme
tl'un régent de college donn é pour modele
a
fes éco–
liers, eil bien fouvent d'auffi maÚvais gout,de plus
mauvais goftt que le leur.
Déclamation
fe prend auffi en mauvaife part
dans
l'éloquence poérique
~
elle confifie dans des moyens
forc
1
s qu'on empbie pour émauvoir, o
u
daos un
pathérique qui n'efi point
a
{a
place : c'efi:
le
vice le
plus commun de la haute poéíie,
&
fur- to ur du
genre tragique.
n
vient communémenr de
ce
que le
poete
n'o u blí~
pas aífez que l'aétion a des fpedateurs ;
car toutes les fois que, malgré la
foible!Te
ou
la
froi–
deur de fon fujet, on veur
e
cirer de grands
monv e~
mens dans 1'auditoire, on force la narure,
&
on donne
dans la
d.fclamation.
i
au contraireon pouvoit fe per–
fuad er que
les
perfonnages en aétion feronr feu ls , o n
ne leur feroit dire que ce qu'ils auroien t d it eu x–
me.mes, d'apd:s 1 ur (;ara
a
ere
&
leur íituarion. U
















