
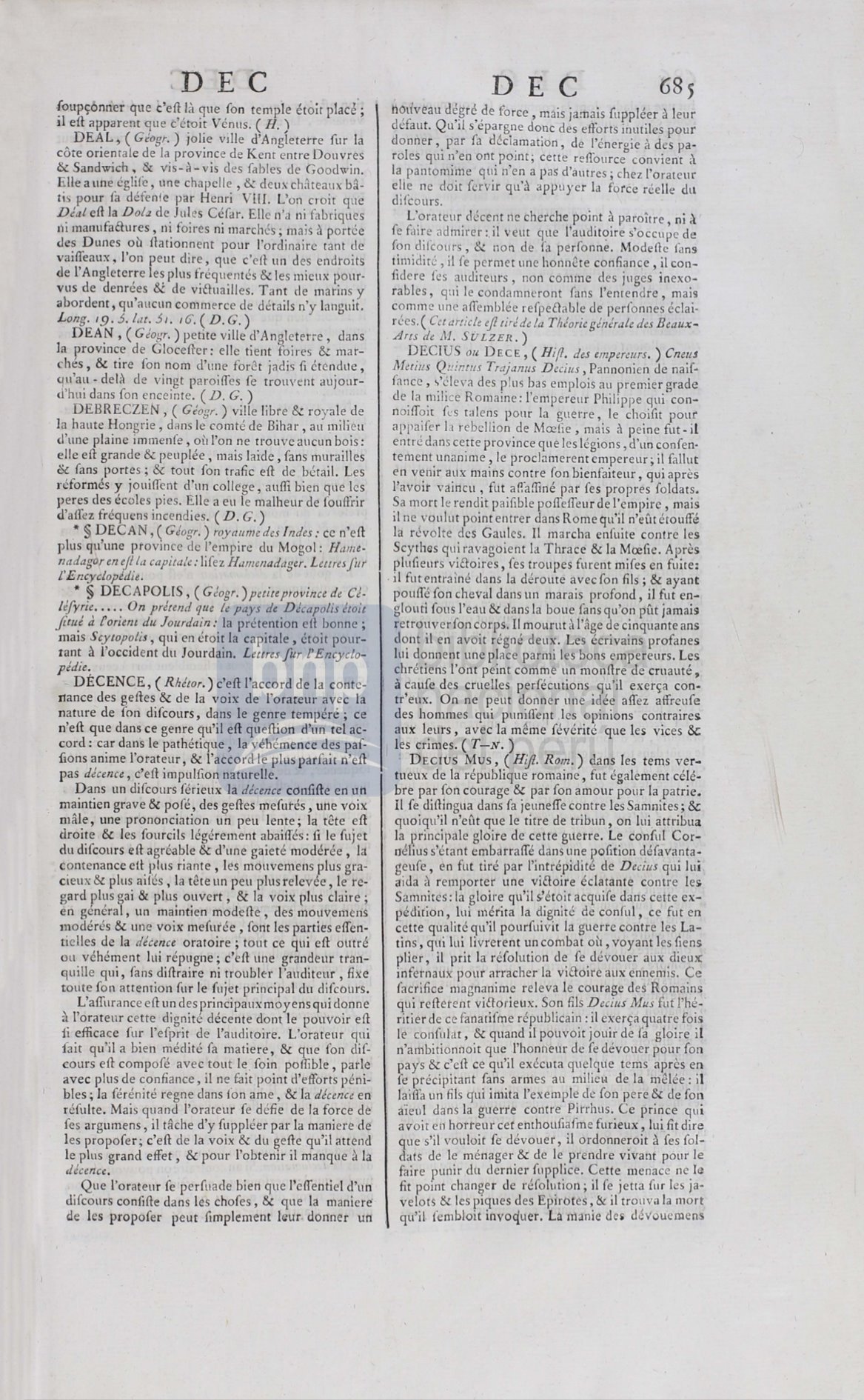
DEC
foup~onner
qne t'eft
la
que fon temple étoit place;
il eíl: apparent que c'étoit
V'
nus.
(H.
)
DEAL, (
Gr.ogt.)
jolie v11le d'AngÍetetre fur la
cote orien rale de
la
province de Kenr entre Douvres
&
andw1ch
&
vis -
a-
is des fables de Gooclwin.
He a une
églife,
tlne chapelle ,
&
denx chateau ba–
r;
pour fa défenle par
Henri
HI.
L'on croit que
D
'al
efr
la
Dola.
de
J
ules Céfar. Elle n'a ni fabriques
ni
manufaB:ures,
n~
foires ni marchés; mais
a
porté
e
des Dunes o
a
ílat1onnent pour
1
ordinair
tant de
vaiífeaux, l'on peut dire
~
que c'eH un des endtoits
de l'Angleterre les plus fr
1
guentés
&
les mieux pour–
vus de denrées
&l.
de vitl:uailles. Tant de marins y
abordent, qu'aucun commerce de d ' tails n'y languit.
Long. '9· 3.lzt.
j,,
16.
(D.G.)
DEA~,
(
Géogr.)
perite ville d'Angleterre, daos
la provmce de Glocefier: elle tient foires
&
mat–
hés,
&
tire fon nom d'une forct jadi
fi
étcndlte,
u'au-
dela de vingt
1
aroiífes fe trouvent aujour–
d'hui daos fon enceinte.
(D.G.)
EBRECZEN, (
Géogr.)
ille libre
&
royale de
la
han te Hongrie, dan le comt' de Bihar, a
u
milieu
d'une plaine imm nfe, ottl'on ne trouve ancun bois:
elle efr grande
&
peuplée, mais laide, fans murailles
&
fans portes ;
&
tout fon trafic efr de b 'taiL Les
réformés
y
jouiffi nt d\m college, auffi bien que les
peres des écoles pies. Elle a eu le malheur de foufliir
d'aífez fréquen incendies.
(D.G.)
*
DE
CAN, (
Géogr.) royawne des
1
ndes:
ce n'efr
plús qu'une pto ince de l'empire du Mogol:
Hame–
nadagor en ejlla capita/e:
lifez
Hamenadager. L eures
ji1r
t'Encyclopédie.
*
§
DECAPOLfS, (
GJogr. )petiteptovince de
Ci -
lifyrie..•.. On prétend que le pays de D écapolis étoit
jitué
a
foriem du lourdain:
la prétention eH bonne;
mais
Scytopolis,
quien éroit la capitale, étoit pour–
tant
a
l'occident dn Jourdain.
Lettres
fur
l'Encyclo–
pédie.
DÉCENCE, (
Rhltor.)
c'efi l'accord de la contc·
J1ance eles geftes
&
de la voix de l'orat.eur
avec
la
nature de fon difcours, dans le genre temp
1
ré ; ce
n'ell que dans
ce
genre qu'il efi queilion d'un
tel
ac·
cord: car dans le pathétique , la véhémence des paf–
fions anime l'orat
eur, & l'accord le plus párfait n'efi
pas
décmce,
c'efi
impulíi.onnaturelle.
Dans un difco
urs férieuxla
décence
con!ifre en
Ufl
maintien grave
&
pofé, des gefres mefu tés, une voix
male' une prononciation un peu lente; la tete eíl:
tlroite
&
les fourcils légérement abailfés:
fi
le fujet
du difcours ell agréable
&
d'une gaieté rnodérée , la
contenance eit plus ríante , les monvemens plus gra–
cieux
&
plus
ai(J
s , la tete un pe u plus relevée, le re–
gard plus gai
&
plus ouvert,
&
la voix plus claire;
en général, un maintien modefre, eles mouvernens
modérés
&
une voix mefurée , fonr les parties eífen–
tielles de la
décence
oratoire ; tout ce qui efi olttré
ou véhément lui répugne;
c'efi:
une grandeur trán–
quiUe qui, fans diíl:raire ni troubler l'auditeur , fixe
toute fon attention fur le fujet principal
ch1
difcours.
L'aífurance e
O:
un des principauxmoyensqui donne
a
l'oratenr cette dignité décente dont le ponvoir efr
ii
efficace fllr l'efprit de l'auditoire. L'orateur qui
fait qu'il a bien médité fa matiere,
&
que fon dif–
cours eft compofé ave e tout le, foin poffible, parle
avec plus de confiance, il ne fait point d'efforts péni–
bles; Ia férénité regne dans fon ame,
&
la
décence
en
r ' fulte. Mais quand l'orateur fe d 'fie de la force de
fes argumens, il tache d'y fuppl 'er par la maniere de
les propofer; c'efi de la voix
&
du geíl:e q1.1'il attend
le plus grand effet'
&
pour l'obtenir il manque
a
la
décence.
Que l'orateur fe perfuade bien que l'eífentiel d'un
difconrs conftíl:e dans les chofes,
&
que la maniere –
de les p-ropofer peut !implement leur donner un
DEC
h~tiveau
d
J
~r~
?e force' mais jamais fuppléer
a
leur
d faut.
Qu1l
parg.nedone des eftorts inutiles pour
donner '·
p~r
fa
d Cl~matÍon,
de !'énergie
a
d
pa–
roles gm
n
en ont pomt; cette reífource convient
¡\
la
antomime quin en a pas d'amres; chez l'orateur
elle ne doit
íi
rvir qu'a appu yer la force r 'elle dtl
difcours.
L'orateur
e
1
cent ne eherehe point
a
paroitre, ni
a
fe faire adrnirer: il
eur que l auditc:>ire s'occupe de
fon diícours,
&
non de fa perfonne. Mod fie fans
timidir
~ ,
il fe permet une honn "re confiance, il con–
lidere fes auditeurs, non comme des juges inexo-–
rables, qui le condamneront fans l'enrendre , maig
comme
un
aífemblée refpeBable de perfonnes éclai·
r
' es.
(
C
t
article
:fl
tiré
de La Théorie glnéral des
B
eaux–
.Arts
de
i\1,
VLZER .)
DE IU
ou
DECE, (
Hifl.
des empereurs.)
Cneus
A1etius Quintus
Trajanus Decius,
Pannonien de naif..
fancc, .,,
~ le"~:a
des p
U<J
bas emplois au premier grade
de_la
~1ili ce
Romaine: l'empereur Philippe qui con–
nor!fort
f~:s
talens ponr la guen·e , le choiút pom•
appaifer la rebcllion de Mrefie, mais
a
peine fut- il
entré dans cette province que les
l
'gions, d'un confen•
tement unanime, le proclamerent empereur; il fallut
en venir aux mains contre fon bienfaiteur, qui apr ' s
l'avoit vaincu, fut afraffiné par fes propres foldats.
S
a mort le rendit pai.Gble poíreífeur de
1'
m
pite,
mais
il ne oulut point entrer daos Rome qn'il n'eftt étouffé
la révolte des Gaules.
H
marcha enCuite contre les
Scythes quiravagbient
la
Thrace
&
la Mrefie. Apres
plufteurs viB:oires, fes troupes furent mi fes en fuire:
il futentra iné dans la d 'route avecfon fils;
&
ayant
pültífé fon cheval dans un marais profond,
il
fut en–
glouti fous l'eau
&
dans la boue fans qu on put jamais
retrouverfon corps.
Il
mOt:lrnt
a
l'age de cinquante ans
dont
il
en avoit régné deux. Les écrivains profanes
lui donnent une place parmi les bons ernpereurs. Les
chrétiens l'ont peint comme un monílre de cruauté,
a
caufe des cruelles perfécutions qu'il exerc;a con·
tr'eux. On ne peut donner une idée affez atfreufe
des hommes
qui
puniífent les opinions contraires.
aux leurs' a
ve
e
la meme févériré que les vices
&
les crimes. (
T
-N.
)
DEctús Mus, (
Hijl.
Rom.)
d.ans les tems ver·
tueux de la république romaine, fut également célé–
bre par fon courage
&
par fon amour pour la patrie.
11 fe difiingua dans fa jeuneífe centre les Samnites;
&
quoiqn'il n'eut que le titre de tribun, on luí attribua
la principale gloire ele cette gtterre. Le conful Cor–
oélius s'étant embarraífé dans une pofttion défavanta·
geufe, en fnt tiré par l'intrépidité de
Decius
qui lui
aida
a
remporter une viB:oire éclatante contre le>
Samnites: la gloire qu'íl s!étoit acquife dans certe ex–
p€dition, lui mérita la dignité de conful, ce fut en
éette qua lité qu'il pourfuivit la guerre contre les La–
tins, qui lui livrerent un combar o\1, voyant les fiens
plier, il prit la réfolution
d~
fe _dévouer aux _dieux
infernatl pour arracher la v18:orre aux ennemrs. Ce
facrifice magnanime televa le courage des Romains
qui refie1·ent
vi~orieu,
'. So_n
~ls
J?ecius Mus
fut!
h:·
ritiér de ce fanaufme r pubhcam:
JI
xer~a
quatre
f01s
le confulat,
&
quand il pouvoit jouir de
(a
gloire il
n'ambitionnoit que l'honneur de fe dévouer pour fon
pays
&
c'ell ce qu'il exécuta
qu~~que
tems
a~r~s
e?–
fe précipitant fans armes au mrhet-r de la mel e :
1l
laiífa un fils qui imita l'exemple de fon pere
&
de fon
a!eul dans la guerre contre Pirrhus. Ce prince qui
avoit en hotteu r
cet
enthoufiafrne furieux, lui fit di re
que s'il ouloit fe dévouer' il ordonneroit
a
fes fol·
dats de le ménager
&
de le prenelre vivant pour le
faire punir du derniet}uppl}ce.
~ette_
menace ne_le
fit point changer de refolunon; tl fe Jetta fur 1 Ja·
velot
&
les piques des Epirores,
&
il rro uva la mort
qu'il fembloit invoquer. La manie dei dév uemen
















