
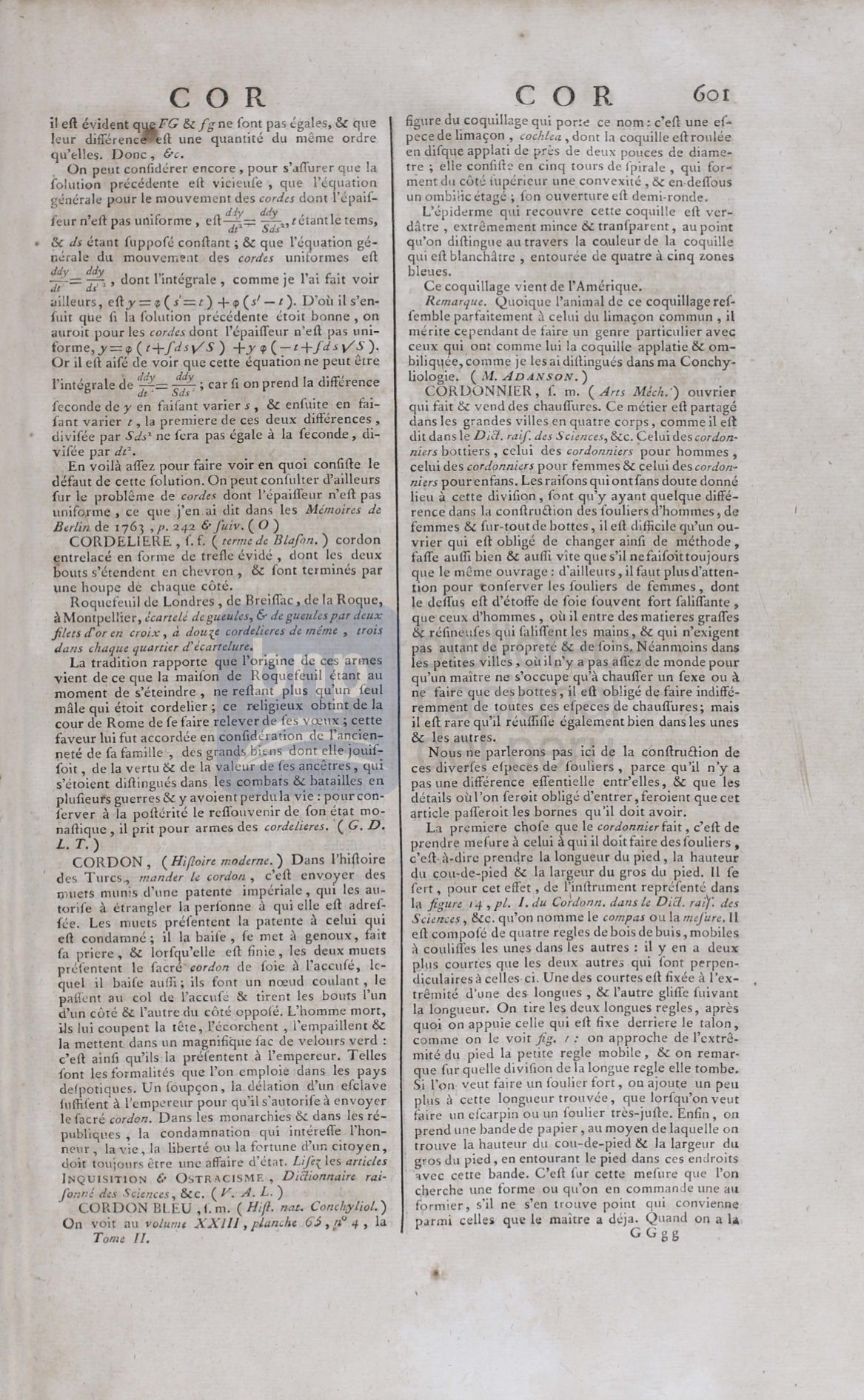
COR
il eíl évident
qu
FG
&
fg
ne font pas
1
gales,
&
que
leur différence efi une quantité du meme ordre
qu'elles. Done,
&c.
On peut coníidérer encore, pour s'aifurer que la
folution précédente eíl vici eufe , que
1'
1
quation
généra1e pour le mouvement des
cordes
dont l'épaif-
feur n'efi pas uniforme, efi
~~- ~r~,
tétantle tems,
&
ds
étant fuppofé confiant;
&
que l'équation gé–
n¿rale du mouvement des
cordes
unifo rmes efi
ddy
ddy
d
1,.
1
l
·
l' ·
r
·
·
;¡¡:-=
ds'
z,
ont mtegra e, cornme Je
at 1a1t vo1r
ailleurs,
efiy==¡p(s' ==t)
+~(s
1
-t).
D'oi1ils'en·
fuit que fi la folurion précédente étoit bonne , on
auroit pour les
cordes
dont l'épaiífeur IJ'efi pas tmi–
forme,y=~
(
t+fdsVS)
+Y~
(
-t+Jds VS
).
Or
il
efi aifé de voir que cette équation ne peut etre
l'intégrale de
ddy- ddy
:.
car
1i
on prend la différence
dt
"-
Sds '
'
feconde de
y
en faifant varier
s
,
&
enftüte en fai–
fant varier
t,
la premiere de ces deux différences,
divifée par
Sds3.
ne fera pas égale
a
la fecoode, di–
vifée par
dtz.
En voila aífez pour faire voir en quoi confiíle le
défaut de cette folution. On peut confulter d'ailleurs
fur le probleme de
cordes
qont l'épaiffeur n'efi pas
uniforme , ce q\le j'en ai dit dans les
Mémoires de
BerLín
de 1763
,p.
.2.42
&
fuív.
(O)
CORDELlERE, f. f. (
terme de Blafon.)
cordon
entrelacé eri forme de trefle évidé, dont les deux
botas s'étendent en chevron,
&
font terminés par
une houpe de chaque c<?té.
.
Roquefeuil de Londres , de BrelÍI'ac
~
de la Roque,
a
Montpellier,
écartelé de gueules,
&
de gueules par deux
filets
d'
or en croix'
a
douze cordelieres de méme
~ troi~
dans chaque quartier d'Üartelure.
La
tradition rapporte que !'origine de ces armes
vient de ce que la rnaifon de Roquefeuil étant au
rnoment de s'éteindre , ne refiant plus qu'un feul
rnale qui étoit cordelier ; ce religieux obtint de la
cour de Rome de fe faire relever de fes vreux; cette
faveur lui fut accordée en confidération de l'ancien–
neté de fa famille , des grands biens dont elle jouif–
foit
de la vertu & de la valeur de fes and!tres, qui
s'ét~ient
difiingués dans les
combais
&
h~uailles
en
plufieurs guerres
&
y avoient perdula vie: pour con–
ferver
a
la pofiérité le reffouvenir de. fon état mo–
nafiique, il prit pour armes des
cordelzeres.
(
G. D.
L. T.)
CORDON,
e
Hiftoire moderne.)
Dans
l'hi~oire
eles Turcs.,
mander
l~
cordon
,
c'efi envoyer des
mnets munis .d'une patente impériale, qui les au–
torife a étrangler la perfonne
a
qui elle efi adref–
fée. Les muets préfentent la patente
a
~elui qt~i
efi condamoé; il la baife' fe met
a
genoux' falt
fa
priere, & lorfqu'elle efi finie, les deux muets
l?réfentent le fa eré
cordon
ele foie
a
l'accufé'
lc–
quel il baife auffi; ils font un nreud coulant, le
pait nt
au
col de
1
accufé
&
tirent les bouts l'un
d'un coté & l'autre
du
coté oppofé. L'homme mort,
ils
lui
coupent la tete, l'écorchent ,
1
empaillent &
la mettent dans un magnifiqtie fac de velours verd :
c'eíl: ainfi qu'ils la préfentent
a
l'empereur. Telles
font les formalités que l'on emploie dans les pays
def¡ otiques. Un foups:on, la
~él~tion
.d'un efclave
fnffifent
a
l'emperenr pour
qu1l
S
autonfe
a
envoyer
le facré
cordon.
Dans les monarchies
&
dans les ré-
p ubliques
la condamnation qui intéreíTe l'hon-
'
.
1
1
r
l'
.
nenr, la
vi
e,
la
liberte ou
a
10rtune
e
ur. c1toyen,
doit toujour etre une affaire d'état.
Lifez
les
articles
I
QUISITION
(,.
Ü STRAClSM E ,
Diaionnaire rai-
fonné
des
Sciellces,
&c.
e
V. A. L.)
CORDON BLEU ,
f.
m. (
H ift.
lULt.
Conch1}'líol.)
On voit a·u
volum~
XXJIJ
,planche
6.5
,p
0
4,
la
Tome
JI.
COR
6ot
figure du. coquillage qui por:
e
ce nom: c'efi une ef–
pec~
de hma<;on .'
cochlt¡a,
dont la coquille eílroulée
en d1fqqe applan de pres de deux pouces de diame–
tre ; etle
con~fr~
en cinq rours de fpirale , qui for..
mentdu coté íupérieur une convexité,
&
en.deffous
un ombiEc étagé; fon ou verture efr demi-ronde.
L'épiderme qui recouvre cette coquille efr ver–
datre , extremement mince
&
tranfparent , au point
qu'on diílingue au travers la co.uleur de la coquille
qui efi blanchatre ' entourée de quatre
a
cinq zones
bleues.
Ce coquillage vient de
1'
Amérique.
.
Remarque.
Quoique l'animal de ce coquillage
ref–
femble parfaitement a celui dulimas:on commun '
il
mérite cependant de faire un genre particulier avec
ceux qui otlt comme lui la coquille applatie
&
om–
biliqqée, comme je les ai difiingués dans ma Conchy–
liologie.
(M.
ADANSON.)
CORDONNIER,
f.
m.
e
Arts Méch.
')
ouvrier
qui fait
&
veod des chauffures. Ce métier efi partagé
dans les grandes villes en quatre corps, comme
il
eft
dit dans le
D itl. raif. des S ciences,
&c. Celui des
cordon~
niers
bottiers , celui des
cordonniers
pour hommes ,
celui des
cordonníers
pour femmes
&
celui des
cordon–
niers
pour enfans. Les raifons qui ontfans doute donné
lieu
a
cette divifion' font qu'y ayant quelque diffé–
rence dans la confiruéhon des fouliers d'hommes, de
femmes
&
fur-tout de bottes, il efi difficile qu'un ou–
vrier qui efi obligé de changer ainfi de méthode,
faífe auffi bien
&
auffi v1te que s'il nefaifoittoujours
que le meme ouvrage: d'ailleurs' il faut plus d'atten–
tion pour conferver les fouliers de femmes, dont
le deífus efi d'étoffe de foie fouvem fort faliífante,
que ceux d'hommes,
Ott
il entre des matieres graffes
&
réíineufes qui faliífent les mains,
&
qui n'exigent
pas autant de propreré
&
ele foins. N éanmoins dans
les petites vil
les~
Otl
il n'y a pas aífez de monde pour
qu'un ma1tre ne s'occupe
qu'a
chauífer un fexe ou
a
ne faire que des bottes, il
efr
bbligé
d~
faire indiffé·
remment de toutes ces efpeces de chauifures; mais
il eíl: rare qu'il réuífiífe
ég~lement
bien dansles unes
&
les autres.
Nous ne parlerons pas ici de la cónfiruélion de
ces diverfes efpeces de fouliers, paree qu'il n'y a
pas une différence eífentielle entr'elles,
&
que les
détails oid'on ferGit obligé d'entrer ,feroienr que cet
article paíferoit les bornes qu'il doit avoir.
La premie re chofe que le
cordonnier
fait, c'efi de
prendre mefure
a
celui aqui il doitfaire desfouliers,
c'efi-a-dire prendre la longueur du pied' la hauteur
qu
cou-de-pied
&
la largeur du gros du pied.
11
fe
fert , ponr cet effet , de l'iníl:rument repr ' fenté dans
la
figure
14,
pl.
l.
du Cofdonn. dans le
Diél.
raí'{: des
Sciences,
&c. qu'on nomme le
compas
ou
lamefure.
Il
eíl: compofé de quatre regles de bois de buis, mobiles
a
coulííi'es les unes dans les autres : il y en a deux
plus coudes que les deux autres qui font perpen·
diculairesa celles·ci. Une des courtes efi fixée a l'ex–
tremité d'une des- longues ,
&
l'autre gliíi'e fuivant
la' longueur. On tire les deux longues regles, apres
quoi on appuie celle qui efi fixe derriere le talon,
comme on
le
voit
jig.
1:
on approche de l'extre–
mité du pied la petite regle mobile,
&
on remar–
que fur quelle ?iviíion de_la longue
reg~e
elle tombe.
Si
l'on veut fa1re un fouher fort, on
aJOU~e
un peu
plus
a
cette longueur trou vée' que lorfqu'on veut
faire un cfcarpin o u un foulier tres-jufie. Enfin, on
prend une bande de papier, au moyen de laquelle on
trouve la hautenr du cou-de-pied
&
Ja largeur du
gFos du pied, en entourant le pied dans ces endroits
::tvec cetre bande. C'eíl: fur cette mefu re que l'on
cherche une forme ou qu'on en commande une
au
formier, s'il ne s'en trouve point qui convienne
parmi celles
que le
maitre
a
déja. Quand on a
la
GG gg
















