
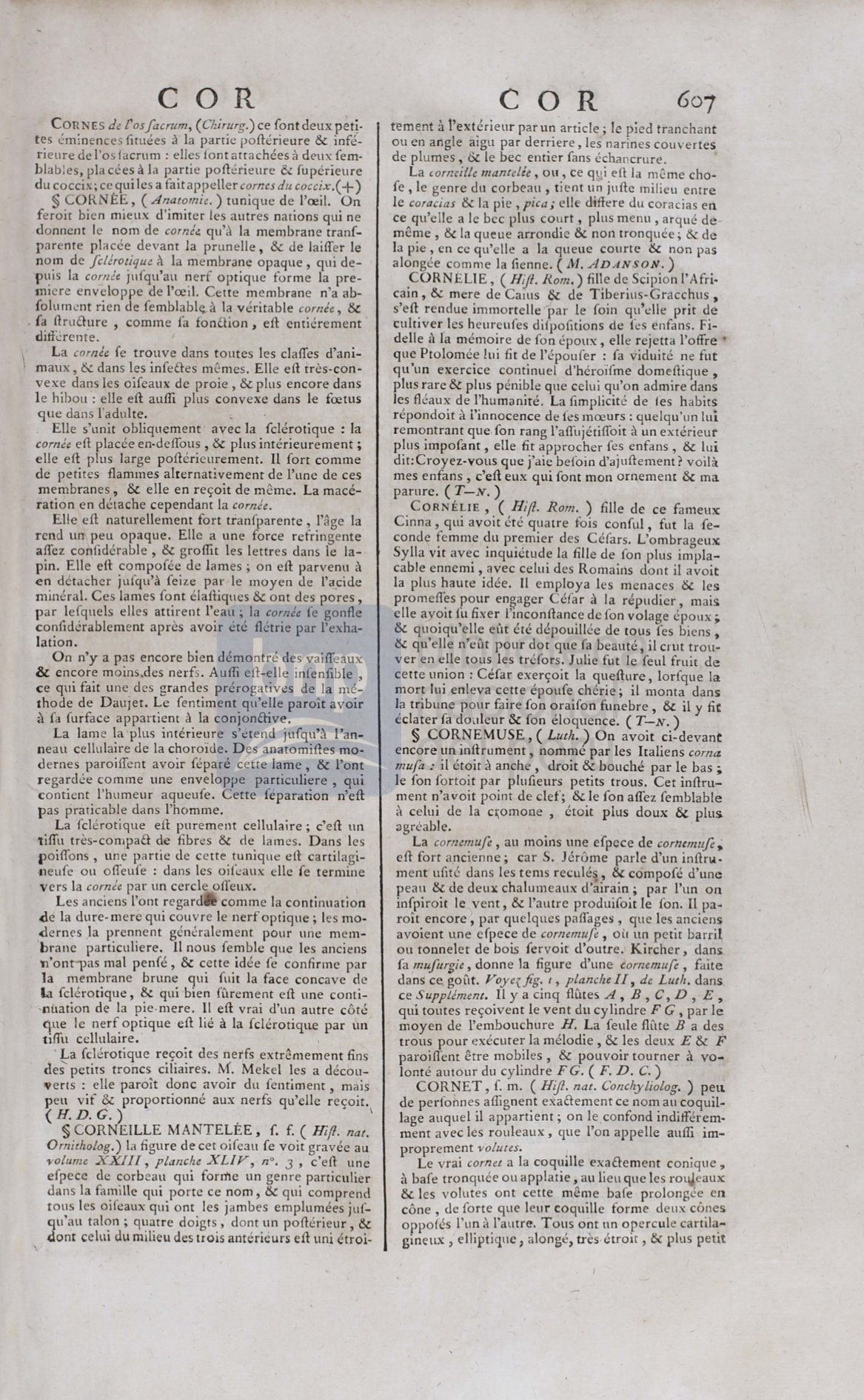
COR
CORNES
de
l'osfacntm, (Chirurg.)
ce fontdeux
pet!·
tes
éminences íiruées
a
la parrie poft ' rieure
&
infé–
rieure de l'os fa crum : elles íont arrachées a deux fem–
bla b:es, pla e '
es
a
la partie poftérieure
&
fupérieure
du coccix; ce qui les a faitappeller
comes du coccix.(
+)
§
CORNÉE, (
Anatomie.)
tunique de l'reil. On
feroit bien mieux d'imiter les autres narions qui ne
donnent le nom de
cornit.
qu'a la membrane tranf–
parente placée devant
la
prunelle,
&
de Iaiífer le
nom de
fclérotique
a
la membrane opaque' qui de–
puis la
cornée
jnfqu'au nerf oprique forme la pre–
miere enveloppe de l'reil. Cette membrane n'a ab–
folum nt ríen de
femblabl~
a
la vérirable
cornie'
&
fa
fir uél~ re
, comme fa fonélion
~
eft enriérement
ditfcrente.
La
comée
fe trouve dans toutes les claífes d'ani-
, maux,
&
dans les infeéles memes. Elle efi tres-con–
vexe daos les oifeaux de proie ,
&
plus encore daos
l e hibou : elle eíl: auffi plus convexe daos le fretus
que daos l'adulte.
.
Elle s'unit obliquement avec la fclérotique : la
cornée.
efi placée en-deífous,
&
plus inrérieurement;
elle efi plus large pofiérienrement. Il fort comme
de petires flammes alternativement de l'une de ces
membranes,
&
elle en rec;oit de meme. La macé–
ration en détache cependant la
cornée.
Elle efi naturellement fort tranfparente, l'age la
rend un peu opaque. Elle a une force refringente
aífez confidérable ,
&
groffit les lettres daos le la–
pin. Elle eft compofée de lames; on eft parvenu
a
en détacher jufqu'a feize par le moyen de l'acide
rninéral. CeS-lames font élaftiques
&
ont des pores,
par lefquels elles attirent l'eau; la
cornée
fe gonfle
coníidérablement apres avoir été fl ltrie par l'exha–
lation.
On n'y a pas encore bien démontré des vaiífeaux
&
encore moins.des nerfs. Auffi efi-elle infenfilile ,
ce qui fait une des grandes prérogarives de la mé–
thode de Daujet. Le fentiment qu elle paro'it avoir
a
fa furface appartient
a
la conjonilive.
La lame la plus intérieure s'etend jufqu'a l'an–
nean cellulaire de la choro!de. Des anatomifies mo–
dernes paroiífent avoir féparé cette lame,
&
l'ont
regardée comme une enveloppe paniculiere , qui
conrient l'humeur aqueufe. Cette féparation n'eft
pas praticable dan
l'homme.
La fcl ' rotique eft purement cellu1a1re; c'e!l: un
tiífu tres-compaél de fibres
&
de lames. Daos les
poiífons , une partie de cette tunique eft cartilagi–
tleufe ou oífeufe : daos les oifeaux elle fe termine
vers la
cornie
par un cercle ofl'eux.
Les anciens l'ont regard
comme la continuation
<le la dure-mere qui couvre le nerf optique; les mo–
<lernes la prennent gén
1
ralement pour une mem–
brane particuliere. 11 nous femble que les anciens
n'on pas mal penfé,
&
cette idée fe confirme par
la membrane brune qui fuit la face concave de
la
fclérotique,
&
qui bien fttrement efi une conti–
·
nuation de la pie.mere. 11 eft vrai d'un alttre coté
q.uele nerf optique efi lié
a
la fclérotiqu.e par un
tiífucellulaire.
,
La fcl érotique rec;oit des
ne~fs
extremement fins
de~
petits troncs ciliaires.
M.
Mekel les a décou–
vens : elle paro'it done avoir du fentiment, mais
peu
if
Qc.
proportionné aux nerfs qu'elle rec;oit.
(H.
D.G.)
,
§
CORNEILLE MANTELEE
~
f. f. (
Hifl.
nat.
Ornitholog.)
la figure de cet oifeau fe voit gravée au
;yolume XXIII , planche XLIV, no. 3 ,
c'efi une
efpece de corbeau qui fonne un genre panicu\ier
dans la famille qui porte ce nom,
&
qui comprend
tous les oifeaux qui ont les jambes emplumées juf–
qu'au talon; quatre doigts, dont un po!l:érieur,
&
.dont celui du.milieu des trois antérieurs eíl: uni étroi-
COR
tement a l'extérieur par un article; le pied tranchant
ou en angle aigu par derriere, les narines cou ertes
de plumes,
&
le bec enrier fans échancrure.
La
corn ille manteUe ,
ou, ce qui efi la m"me cho–
fe, le genre du corbeau, ti ent u.n jufie milieu entre
le
coracias
&
la pie,
pica;
elle difiere du coracias en
ce qu'elle a le bec plus court, plus menu , arqué de–
meme'
&
la queue arrondie
&
non tronqu ée;
&
de
la pie, en ce qu'elle a la queue courte
&
non pas
alongée cC?mme la fienne.
(M.
ADANSD_11:)
•
.CORNELIE, (
Hifl. Rom.)
fill.e
d~
Sc1ptoh 1'Afn·
ca1n,
&
mere de Caius
&
de T1benus-Gracchus,
s'efi rendue immortelle par le foin qu'elle prit de
culriver les heureufes diípofitions de fes enfans. Fi–
delle
a
fa mémoire de fon époux ' elle rejetta l'offre .
que Ptolomée lui fit de
l'
' poufer : fa viduité ne fut
qu'un exercice continuel d'héroi'fme domefiique,
plus rare
&
plus pénible que celui qu'on admire daos
les fl éaux de l'humanité. La fimplicité de fes habits
répondoit
a
l'innocence de fes mreurs: quelqu'un lui
remontrant que,fon rang l'aífujétiífoit
a
un extérieut
plus impofant, elle fit approcher fe.s enfans,
&
lui
dit: Croyez-vous que j'aie befoin d'aJufiement? voila
mes enfans, c'eft eux qui font mon ornement
&
ma
parure. (
T
-1of.)
CoRNÉLIE , (
Hlfl. Rom.
)
filie de ce fameux
Cinna, qui avoit 'té quatre fois conful, fut la fe–
conde femme du premier des Céfars. L'ombraPeux
Sylla vit avec inquiétude la filie de fon plus i;pla–
cable ennemi, avec celui des Romains dont il avoit
la plus haute idée. Il employa les menaces
&
les
promeífes pour
en~ager
Céfar
a
la répudier, mais
elle ayoit
Ú1
fixer l'mconfiance de fon volage époux;
&
quoiqu'elle ei'tt éré dépouillée de tous fes biens,
&
qu'elle n'eut pour dot que fa beauté, il crut trou–
ver en elle tous les tréfors. J uüe fut le feul fruit de
cette union
=
Céfar exerc;oit la quefture, lorfque la
mort lui enleva cette époufe chérie; il monta dans
Ja tribune pour faire fon oraifon funebre,
&
il
y
fit
1
el
ater fa do 1leur
&
fon éloquence. (
T
-N.)
§
CORNEMUSE, (
Luth.)
On avoit ci-devant
encore un infrrument, nomme par les ltaliens
coma
mufa :
il étoit
a
anche ' droit
&
bouché par le has ;
le fon fortoit par plufieurs petits trous. Cet infiru–
ment n'a voit point de clef;
&
le fon aífez femblable
a
celui de la
C
~OffiOI.Je, étoit plus doux
&
plus
agréable.
.
.
La
cornemufe,
au moms une efpece de
cornemufe
~
efr fort a.ncienne; car S. Jérome parle d'un inftrti–
ment ufit
1
dans les tems reculés,
&
compofé d'une
pea u
&
de deuJC chalumeaux d'airain; par l'un on
infpiroit le vent,
&
l'autre produifoit le fon. Il pa–
roit encore, par quelqnes paífages, que les anciens
avoient une efpece de
cornemufe,
Otl un petit barril
ou tonnelet de bois fervoit d'outre. Kircher
~
dans
fa
mufurgie
,
donne la figure d'une
comemufe
,
faite
dans ce goüt.
Voyezfig.
',
planche
JI,
de Lut!t.
dans.
ce
Supplément.
11
y
a cinq flCttes
A
,
B
,
C, D
,
E
,
qui toutes rec;oivent le vent du ey lindre
F
G,
par le
moyen de l'embouchure
H.
La feule flfHe
B
a des
trous pour exécuter la mélodie ,
&
les deux
E
&
F
paroiffent erre mobiles '
&
pouvoir tourner
a
vo–
lonté antour du cylindre
FG. (F. D.
C.)
CORNET, f. m. (
Hijl.
nat. Conchyliolog.
)
peu
de perfoñnes affignent exaélement ce nomau coquil–
lage auquel il appartient; on le confond inditférem·
ment avec les rouleaux, que l'on appelle auffi im–
proprement
volutes.
Le v rai
corneta
la coquille exaélement conique;,
a
bafe tronquée ou applatie' au lieu que les roul eaux
&
les v olutes ont cette meme bafe prolong
1
e en
cone de forte que leur coquille forme deux eones
oppo~
S
l'u? a_l'autre. Tot!S
O~t ~n
opercule
carri)~
...
ginetL~,
elhpoque, alonge, tres etro1t,
&
plus petlt
















