
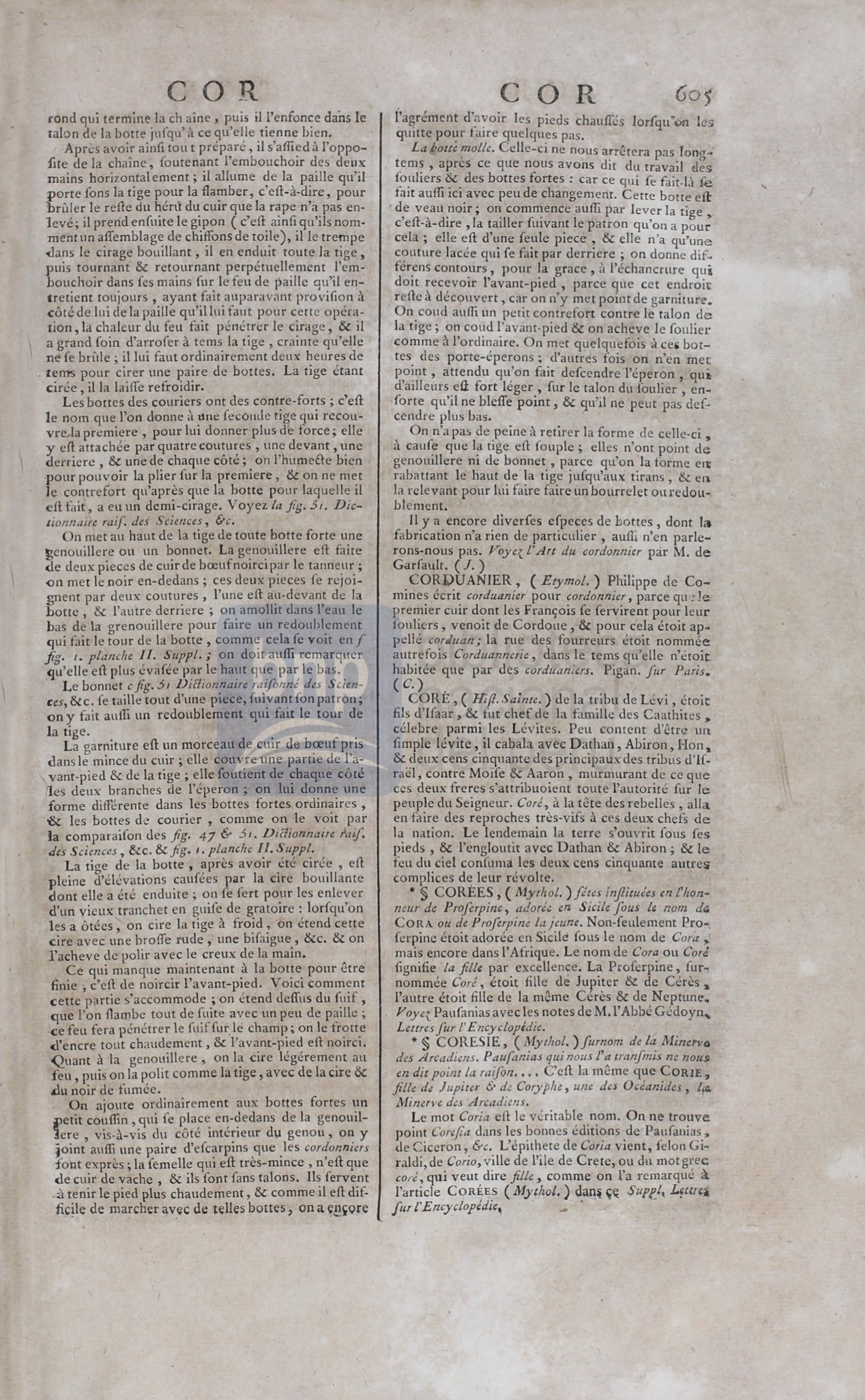
COR
rond qui termine la eh aine., puis ill'enfonce dans le
talon de la botte jufqu'
a
ce qu'elle tienne bien.
Apres avoir ainíi tou t préparé,
il
s'affieda l'oppo–
fite de la chaine, {outenant l'embouchoir des deux
mains horizontal ement; il allume de la paille qu'il
porte fons la tige pour la flamber, c'eíl:-a-dire, pour
bruler le refie du héru du cuir que la rape n'a pasen–
levé; il prend enCuite le gipon (e'efi ainfi qu'ils nom–
mehtun affemblage de chiffons de toile), ille trernpe
~ans
le cirage bouillant, il en enduit toute la tige,
puis tournant
&
retournant perpétuellement l'em–
bouchojr dans fes mains fur le feu de paille
qu'il
en–
tretient toujours ' ayant fait auparavant provifion a
cotéde.lui de la paille qu'illui faut pour cette opéra–
tion, la chaleur du feu fait pénétrer le cirage,
&
il
a grand foin d'arrofer
a
tems la tige, crainte qu'eUe
ne fe brflle ; illui faut ordinairement deux heures de
. tems pour cirer une paire de bottes. La tige étant
cirée, illa laiffe refroidir.
Les bortes des couriers ont des contre-forts ; c'eíl:
le nom que l'on d'onne
a
une feconde tige qui recou–
vre..la premiere , pour luí donner plus de force; elle
y
efi attachée par quatre eoutures , une devant, une
derriere ,
&
une de chaque cóté; on l'humeél:e bien
·pour pouvoir
la
plier fur la premíere,
&
on ne met
le contrefort qu'apres que la botte pour laquelle il
efi fait, a en
un
demi-cirage. Voyez
la fig.
.S
t.
Dic–
tionnai
re raif. des Sciences, &c.
On
m.eta
u
haut de la tige de toute botte forte une
genouillere ou un bonnet. La genouillere efi faite
de deux pieces de cuir de breufnoirci par le tanneur ;
<>n met le,noir en-dedans ; ces deux pieces fe rejoi–
,.gnent par deux
coutu~es
, l'une eíl:
a~-devan,t
de
la
hotte,
&
l'autre dernere ; on amolht dans
1
eau le
has de la grenouillere pour faire un redouhlement
<JUi
fait le tour de la botte , comme cela fe voit en
f
fir·
'·
planche
JI.
Suppl. ;
on doit auffi remarquer
q~'elle
eíl: plus évafée par le haut que par le bas.
· Le bonnet
efig. .)
1
Diélionnaire rai:fonni des S cien–
ces,
&c. fe taille tout d'une piece,
fui.va~t
fon patron;
on y fait anffi un redoublement qm fa1t
1~
tour de
la
tige.
La garniture eíl: un morceau de cuir de breuf pris
dans le mince du cuir; elle couvre une partie de l'a–
vant-pied &·de la tige; elle foutient de chaque coté
.'les deux brancbes de l'éperon ; on lui donne une
forme d1fferente dans les bottes fortes ordinaires ,
&
les bottes de courier , comme on le voit par
la
comparaifon des
fig.
4
7
& -'
1.
Diélionnaire
raif.
.Jes Sciences
&c.
&fig.
1,
planche
11.
Suppl.
La tige de la botte , apres avoir été cirée , efi
pleine d'élévations caufées par la cire bouillante
dont elle a été enduite ; on fe fert pour les enlever
d'un
vieux,tranchet en guife de gratoire : lorfqu'on
}es a otées, on cire la tige
a
froid, On étend C'ette
cire
avec
une broífe rude, une bifaigue, &c.
&
on
l'acheve de polir avec le creux de la main.
Ce qui manque maintenant a la botte pour etre
finie , c'efi de noircir l'avant-pied. Voici comment
cette p(lrtie s'accommode ; on éténd deffus du fuif ,
que l'on flaa}be tout de {uite avec un peu de paille;
·ce feu fera pénétrer le fuif
fur)~
champ; on le frotte
<l'encre tout chaudement,
&
l'avam-pied efi noirci.
Quant a ·la
geno~tiUere...,.
on
1~
cire légéreme?t a
u
fe
u
puis on la poht comme la t1ge, avee de la c1re
&
'
.
1
.tlu noir de fumee.
On ajoute or.dinairement
~ux
bottes fortes
~m
¡letit couffin, qm fe place en-aedans de la genoml–
lere ' vis-a-vis du coté intérieur du genou' on
y
joint auffi une paire
d'efc~rpins
,que _les
cor~onniers
follt expres ; la femelle qm efr tres-mmce , n efi que
de cuir de vache ,
&
ils font fans talons. Ils fervent
.a
tenit le pied plus chaudement,
&
comme il eíl: dif–
ticile de
mar,her
av~c
de telles
bottes, on
a
,_n~o~e
1/1'
#
•
~
-
COR
6o)
i'agrémeñt d'avoir les pieds chau.ffi'
s
Iorfqu".:>n les
quitte
po~r
faire
quelqu~s
pas.
La botte molle.
Celle-c1 ne nous arretera p.as fon.o-...–
tem~
, apres ce que nous avons dit du travail
cl~s
foulters
&
des bottes fortes : car ce
qui
{e
fait-la fe.
f.·lit auffi ici avec peu de changemenr. Cette botte eft
de vean noir; Ofl commence auffi par lever la
tige
c'eíl:-a-dire , la tailler fuivant le parron qu'on a pou;
cela; elle efi d'une feule piecé , & elle n'a qu'une
couture lacée qai fe fait par derriere ; on donne dif–
fér.ens conto.urs,, pour
~a
grace'
a
l'échancrnre qui
dott recevo1r
1
avant-pted , paree que cet endroit
refie a découvert' car on n'y met point de garniture.
On. coud aufl\ un pet(t contrefort conrre le talon
de
la
t:~ge;
on coud l'avant-pied
&
on acheve le foulier
comme a l'ordinaire. On met quelquefois
a
cea bot–
tes des porte-éperons; d'autres fois on n'en met
point, attendu qu'on fait defcendre'l'éperon qui
d'ailleurs eíl fort léger , fur le talon du ioulier' en–
forre qu'il ne bleffe point, & qu'il ne peut pas'def–
cendre plus has.
On n'a pas de
~eíne
a
retirer la forme de celle-ci
ª-
caufe que la tige efi fouple; elles n'ont point d;
genouillere ni de bonnet , paree qu'on la forme ert
rabattant le haut de la 'tige jufqu'aux tirans & erl
la relevant pour lui faire faire un bou.rrelet ou
~edou
blement.
.
Il
y
a
encore diverfes efpeces de bottes , dont
la
fabrication n'a rien de
parüculier , aufii n'en parle–
rQns-nous pas.
Voye{ l'.
A.rtdu cordonnier
par M. de
Garfault.
(J.)
,
CORDUANIER, (
.Etymol.
)
Philippe de Ca–
mines écrit
cordu.anier
pour
cordo!lnier,
paree
qu·; !e
premier cuir dont les Fran<;ois fe fervirent pour leur
fouliers, venoit de Cordoue,
&
pour cela étoit ap..
pelié
coráuan;
la rne des fourreurs étoit nommée
autrefois
Corduannerie,
dans le tems qu'elle n'étoit
habitée que par des
corduaniers.
Pigan.
Jur París.
(~)
1
CORÉ, (
Irifl.
Saime.)
de la tribu de Lévi, étoit
fils d'Ifaar
~
&
fut chef de la famille des Caathites
célebre
~rmi
les Lévites. Peu conrent d'etrct
u~
fimple lévite, il cabala avec Dathan, Abiron, .Hon
1
&
deux cens cinquante des principaux des tribus d'lf–
rael, contre Mo1fe
&
Aaron , murmurant de ce que
ces deux freres s'attribuoient toute l'autorité fur le
peuple clu Seigneur.
Coré,
a la tete des rebelles, al!
a
en faire des reproches tres-vifs
a
ces deux chefs
de
la nation. Le lendemain la terre s.'ouvrit fous fes
pieds ,
&
l'engloutit avec Dathan
&
Abiron;
&
le
feu du del confuma les deux cens cinquante autxei
complices de leur révolte.
·*
§
CORÉES, (
Mythol.) fétes ínjlituées
en
l'hon–
neur de Proferpine, adorü en Sicile fous le nom
df:.
CORA
ou de Proferpine lajeune.
Non-feulement Pro...
ferpine étoit adorée en Sicile fous le nom de
Cora
.,.'
mais encore dans
1'
Afrique. Le nom de
Cora
ou
Coré
fignifi.e
la fille
par excellence. La Proferpine, fur"'
nommée
Co
ré, étoit filie dé Jupiter
&
de
Cé.n~s
1
l'autre étoit
fi.Uede la meme Céres
&
de Neptune..
Voyez.
Panfanias avee les notes de M.l'Abbé
Gédoyn,~
Lettres Jur l'
E
ncyclopidie.
*
§
CORESIE, (
Mythol.
)
Jurnom de la Minery4
des .A.rcadiens.
P
au{anias qui nous l'
a
tranfmis ne noU$
en dit point la rai:fon.•.•
C'efi la meme que CORlE
l)
fille de lupiter
&
de Coryphe, une des Océanides,.
lf
Minerve des
A
rcadiens.
Le mot
Coria
efl: le véritable nom. On
ne
trouve
point
Corifia
daos les bonnes éditions de Paufanias,.
de Ciceron,
&c.
L'épithete de
Coria
vient, felon Gio
raldi,de
Cario,
ville de l'ile deCrete, ou du. motgrec
cod'
qui
veut dire
fille
~
comme on
l'a
remarqué
a
l'article CoRÉEs (
Myeho-1,
)
dan~'~
Supe_l,
Lfur~
fur l'Ency_clopédie,
-
· •
_
















