
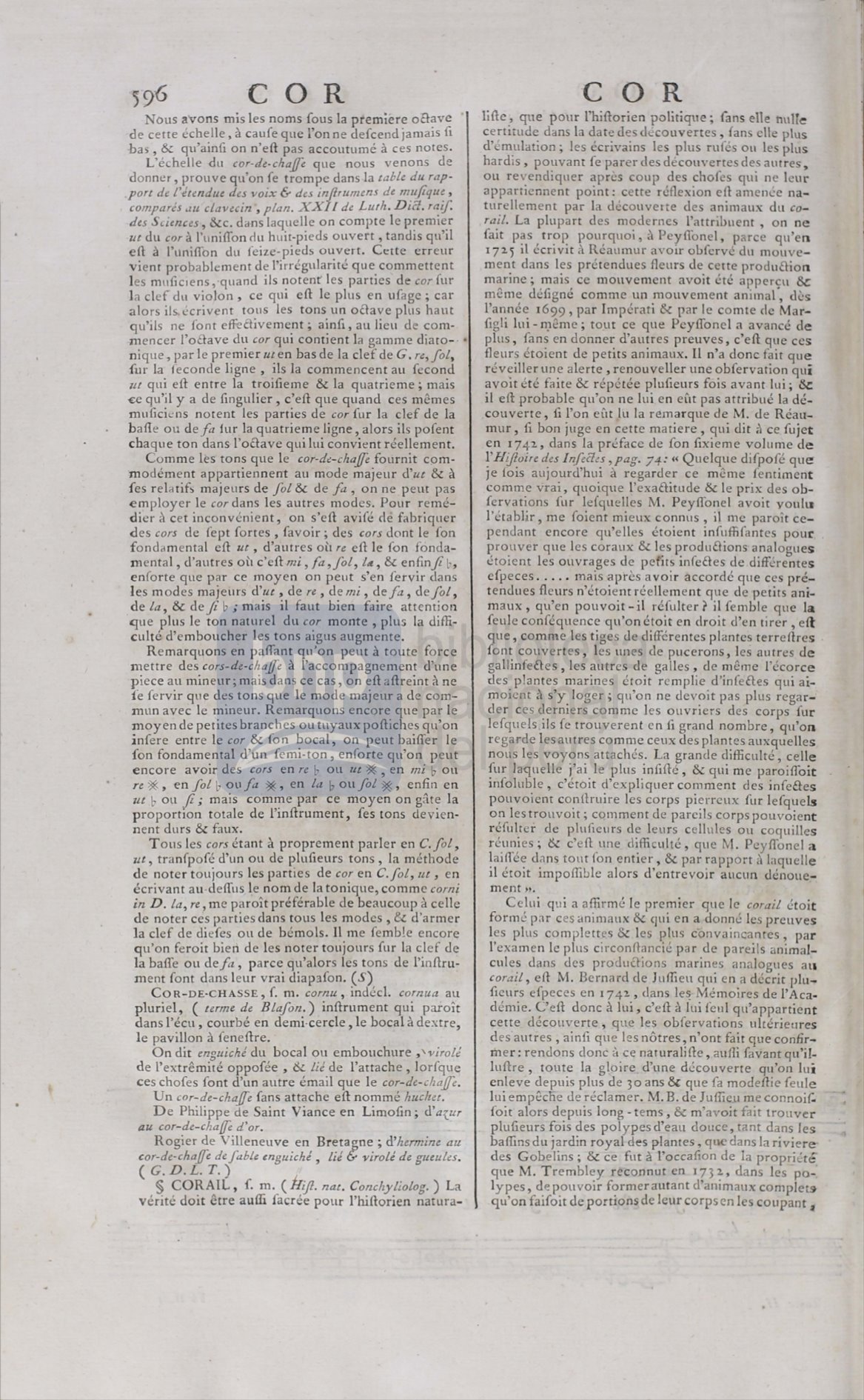
COR
ous avons mis les noms fous la ptemiere oétave
de cette cbelle,
a
caufe que l'on ne defcend jamais fi
has,
&
qu'ainú on n'efi: pas accoutumé
a
ces nores.
L'échelle -du
cor-de-chaffi
que nous venons de
donner, prouve qu'on fe trompe daos
la tahle du rap–
port de l'étendue des voix
&
de.s injlrumens de m_ujiqu:,
comparés
d.U
clavecin, plan.
XXI1
de Luth.
DLa.
raiJ.
des Súmces,
&c. da-ns laquelle on compte le premier
Ut
du
cor
a
1\miífon
el
u huit-pieds OUVert, tandis qu'il
efi
a
l'uniífon du feize-pieds ouvert. Cette erreur
vienr probablement de l'irr 'gularité que commettent
l es muíicJens, ·quand ils notent' les parties de
cor
fur
l a clef du violon , ce qui efi le plus en ufage ; car
alors ils
1
crivent tous les tons un oaave plus haut
qu'ils ne font effetlivement; ainfi, au lieu de com–
mencer l'otlave du
cor
qui conrjent la gamrne diaro- · ·
nique, par le premier
ul
en bas de la clef de
G.
re,fol,
fur la feconde ligne , ils la commencent au fecond
ut
qui efi entre la troifieme & la quatrieme; mais
-€e
qu'il
y
a de fingulier' c'efi que quand ces memes
mufici os norent les parties de
cor
fur la clef de la
baffe o u de
fa
fur la quatrieme ligne, alors ils pofent
cbague ton dans l'oétave qui lui convient réellement.
Comme les tons que le
cor-d.!-chaffi
fournit cpm–
modément appartiennent au mode majeur
d'ut
&
a
fes relatifl> majeurs de
fol
& de
fa,
on ne peut pas
employer le
cor
dans les autres modes. Pour remé–
diera cet inconvénient' on s'efi avifé de fabriquer
des
cors
de fept forres, favoir; des
cors
dont le fon
fond amental efi
ut,
d'autres ott
re
efr le fon fonda–
mental, d'autres oil c'efr
mi, fa,fol,
Ül,
&
enfmji
b,
en(orte que par ce moyen on peut s'en fervir dans
les modes majeurs
d'ut,
de
re,
de
mi,
de
fa,
de
fol,
.de
la,
&
de
ji
~
;
rnais il faut bien fa ire attenrion
4CJ:Ue plus le ton naturel du
cor
monte , plus la diffi–
culté d'emboucher les tons aigus augmente.
Remarquons en paffant qu'on pent
a
toute force
mettre des
cors-de-chaife
a l'accompagnement d'une
piece au mineur; mais dans ce cas, on efr afireinr a ne
fe fervir que des tons que le mode majeur a de coro–
muo avec le mineur. Remarquons encore que par le
m oyen de pe tites branches ou tuyaux pofiiches qu'on
infere entre le
cor
&
{on bocal, on peut baiffer le
fon fondamental d'un femi-ton, enforte qu'on peut
encore avoir des
cors
en
re
~
ou
ut
* ,
en
mi
1;,
on
re * , enfol oufa
*'en
la
!7
oufol
*, enfin en
1tt
~
ou
.fi;
mais comme par ce rnoyen on gate la
proportion totale de l'infirument, fes tons dev ien–
nent durs
&
faux.
Tons les
cors
étant
a
proprement parler en
C. fol,
ut,
tranfpofé d'un ou de plufieurs tons, la méthode
de noter toujours les parties
decoren C.fol, ut,
en
écrivant au-deífus le nom de la tonique, comme
corni
in D. la, re,me
paroitpréférable de beaucoup
a
celle
de noter ces partíes dans tous les modes ,
&
d'armer
la clef de diefes
0\.l
de bémols.
n
me femb!e encore
qu'on feroit bien de les noter toujonrs fur la clef de
la baífe ou de
fa,
paree gu'alors les tons de l'infiru–
ment font dans leur vrai diap::1fon.
(S)
CoR-DE·CHASSE,
f. m.
cornu,
indécl.
cornua
au
pluriel, (
terme de Blafon.)
infirument qui paroit
dans l'écu, courbé en demi-cercle) le bocal
a
dextre,
le pavillon
a
fenefire.
On dit
enguiché
du bocal ou embouchure ,
virolé
de l'extremité oppofée ,
&
lié
de l'artache, lorfque
ces chofes font d'un autre émail que le
cor-de-chaife.
Un
cor-de-chaJ!e
fans attache efi nommé
hucltet.
De Philippe de Saint Viance en Limofin; d'
azur
au cor-de-chaf{e d'or.
Rogier de illeneuve en Bretagne;
d'hermine au
cor-de-cha./Je de fahle enguichl
,
lié
&
virolé de gueules.
(
G.D.L. T.)
§
CORAIL, f. m. (
Hijl.
nat. Conchyliolog.)
La
vérité doit etre auffi fac:rée pour l'hifiorien natura-
e o
R
lifte, que pour l'hifiorien politiqt e; fans elle tml
certirud dan la date de d couvertes fan ll plus
d' mulation · les 'crivains les plus ruf. ou le plus
hardis, pouvant fe parer des decouvert
s
des atltre ,
ou re vendiquer apr
s
cou des chofes qui ne leur
appartiennent point: cette réflexion eíl: amence na–
turellement par la decouverte des animaux du
co–
rail.
La plupart des moderne 1attribuent on ne
fait pas trop pourquoi a Peyfionel, par e qu en
1725 il écrivit
a
R 'aumur avoir obferv. du mouve–
meot dans les prétendues fleurs de cette produaion
marine; mais ce monvement avoit 't
1
appercn
&
meme d 'figoé comme un monvement animal· d s
l'année
1699,
par Impérati
&
par le comte d Mar–
figli lni -n:teme; tour ce que P yífonel a avancé de
plus, fans en donner d'autres preuves, e efr que ces
fleurs ' toient de petirs animaux. Il n'a done fait que
réveiller une alerte, renouveller une obfervarion qui
avoit été faite
&
rép ' tée plufieurs fois avant lui;
&:.
il efi probable qu'on ne lui en eut pas attribué la dé–
couverte,
íi
l'on eut lu la remarque de M. de Réau–
mur,
fi
bon juge en cette mariere, qui dit
a
ce fu jet
en 1742., dans la pr 'face de fon fixieme volume de
~'Hijfoire
des
lnfeaes
,pag.
74:
H
Quelque difpofé que
Je
fois aujourd'hui
a
regarder ce meme femiment
comme vrai, quoiqne l'exaél:itude
&
le prix des ob–
fervations fur lefquelles M. Peyífonel avoit vouht
l'établir, me foient mieux connus, il me paroit ce–
pendant encore qu'elles étoient infuffifantes pour
pronver que les coraux
&
les
produétions analooues
étoient les ouvrages de petit infeétes de diffil
re~tes
efpeces ..... mais aptes avoir accordé que ces pré–
tendues fleurs n'étoiem réellement que de petits ani–
maux, qu.'en pouvoit -il réfulter? il femble que la
feule conféquence qu'on étoit en droit d'en t1rer, eft
que, comme les tiges tle différentes plantes terrelhes
font couvertes, les unes de pucerons, les autres de
gallinfeél:es, les autres de galles, de meme
l'
1
coree
des p antes marines étoit r emplie d'infeél:es qui ai–
moient
a
s'y
loger) qu'on ne devoit pas plus regar–
der ces derniers comme les ouvriers des corps fur
lefquels ils fe trouverent en fi grand nombre, qu'on
regarde les antres comme ceux des plantes auxquelles
nous les
voy~n~
attachés_. La prande
~ifficulté,
celle
fur Iaqnelle
J
a1 le plus 1nfifie,
&
qlll
me paroiífoit
infoluble, c'étoit d'expliquer comment des infeél:es
pouvoient co?H:ruire les corps pi:rreux fur lefguels
on les trouvmt; comment de pare1ls corps pouvoient
réfulter de plufieurs de leurs cellules ou coquilles
réunies;
&
c'efi une diffi ulté, que . Peyífonel a
laiífée dans tont fon entier'
&
par rapport
a
laquelle
il éroit impoilible alors d'entrevoír aucun dénoue–
ment "·
Celui qui a affirmé le premier que le
corail
étoit
formé par ces animanx
&
quien a donné les preuves
les plus complettes
&
les plus convaincanres, par
!'examen le plus circonfiancié par de pareils animal–
cules daos des producrions marines analogues an
corail,
efi M. Bernaid de Juffieu quien a décrit plu–
íieurs efpeces en 1742, dans
le~
Mémoires de 1'Aca–
d 'mje. C'efi done
a
lui, c'efi
a
lui !eul qu'appartient
cette découverte, q 1e les obfervations ultérieures
des autres 'ainfi que les notres, n'ont fait que
con5r–
mer: rendons done
a
ce naturalifie, aufli favant gu'ii–
luíl:re, toute la gloire d'nne d
1
couverte qu'on lui
enleve depuis plus de 30 ans
&
que fa modefiie feule
lui empec e de rédamer. M. B. de Juilieu me connoif..
foit alors depuis long- t ems ,
&
m'avoit faít trouver
plufieurs fois des polypes d'eau douce, tant daos les
baffins du jard]n royal des plantes, qt dans la ri viere
des Gobelins;
&
ce fut
a
l'occa.íion de a propriúé
que M. Trembley reconnut en 173 2., daos les po–
lypes, de pouvoir former autant d'animaux complet9
qu on faifoit de portionsde leurcorpsen les coupant
~
















