
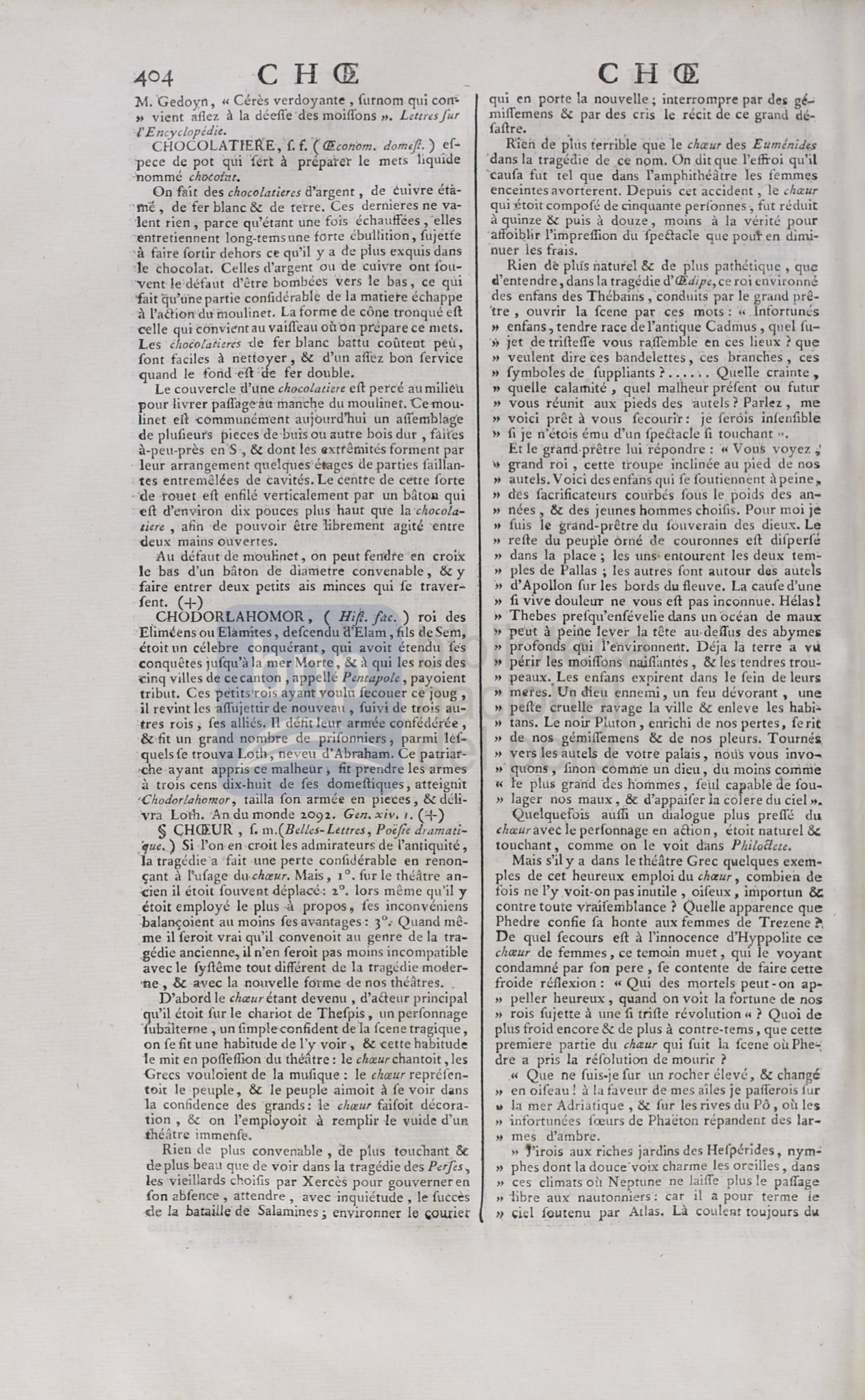
~eH
<E
M.
'Gedoy.n,
4<
Cére~ verdoyant~
,
fu
rnom qui con-.:
)) vient aflez
a
la déeífe ·des m01ífons "·
Lettnsfur
l'Encyclopédie.
. •
.
CHOCOLATIE«E,
(. (.
(
Gf.cotzom . domtjl.)
~f-pece de pot qui Íert
a
prépal-er le
met"s
líquide
~nommé
chr>coi:at.
On
faí t
des
chocolatieres
a'argent, de éuivre éta–
·rue,
de fer blanc
&
de tetre . Ces dernieres ne va–
~Jent
rien, paree qu'étatlt une foi"s
,éch~L~tfées,
··_elles
entretiennent long-tems une fdrte e·b'=rllltwn,
~UJetfe
'a
faire fonir dehors
ce
qu'il y a de
ph~s
exqms daos
·]·e
chocolat. Celles d'argent
ou
de cu1vre ont fou–
'Vent le·défaut d'etre bombées vers ie bas, ce qui
i"ait qu"'ti'ile partie confidérable de la matiere échappe
a
l'aél:iQn·dl.l'tnOuliner. La forme de cone tronqué efi
celle qui eó-nvient au vaiifean o
u
'on_prépare ce mets.
Les
i!zocolatiem
-de fer blanc battu couteot pt;ú ,
font faciles
a
n'edoyer'
&
d'un
afft!z
bm'l fervice
quand le forld -éll
:ae
fer
do~ble.
,
..
Le couvercle d'ttne
chocolauere
eíl: perce au miltélt
pour ·livrer paífage·áu manche du monliner. Ce mou·
linet efi -communém·ent aujourd'hui un aúen1blag'e
de plufieur's pieces de ·bui:s ou autre bois dur , fátt;es
a-peu-pres en 'S -,
&
dont les «xttemités forment par
leur arrangement que· ques··étagcs Cle.parties faillan–
·tes entremelées de cavités. Le centte de cetre forte
'de 'touet eíl: enfilé verticalement par un ba ton qui
efi d'environ dix pouces plus haut que
la ·ckocola–
tiere
'
afin
de
pouvoir etre librement agité entre
'Cleux rnains o livertes.
A
u défaut de moulinet, on peut ferrdre
' eh
croix
le has d'un b'aton
de
diametre convenable,
&
y
faire entrer deux petits ais minces qui fe traver–
fent. (
+)
.
~CHODORLAHOMOR,
(
Hi).
fac .
)
roi des
Elünéens on 'E1am11:es , defcendu R'Eiam,·fils de Se·rn,
étoit un céle-bre conquérant, qui avoit étenélu
Te·s
conquetes jufqu'a la mer Morte,
&
a
qui les rois des
~inq
villes
d~
ce canton, appéUé
Pentapole,
payoient
tribu t. Ces
pctits~tois
ayant voulu fecouer ce joug,
il revint les -aífujettir de nouvean , fui vi de trois
au-
~tres
rois, fes alliés.
n
defit leur armée confédérée '
& 'fit un grand nombre de prifonniers, parmi
léf–
quels fe trouva Loth, neveu d' Abraham. Ce patriat–
·che ayant appris ce malhellr, fit prendre les armes
a
trois ·Cens
dix~huit
de fes domeftiques, atteigni't
·Chodorla-ho!Ror,
tailla fon armée en pie-ces,
&
déii'–
vra
Loth. An du monde
2092.
-Gen. xiv.
t.
(4-)
§
CHCIEUR ,
f.
m.(Belles-Lettres, Poijie dramati-
_(¡ae.
)
Si ·l'on·en ·cr-oit les admirateurs de l'antiquité,
la tragédie ,a ·fait une perte conúdérable en renon–
~ant
a
Pufage·
du- ch~ur.
Mais,
1
o.
fur le théatre an–
;cien il étoit fouveat .déplacé-:
2°.
lors meme qu'il
y
étoit employé le plus
..a
pro
pos~
fes inconvéniens
~balarn;oient
au moins fes av.antages
~
)
0
•
Q uand me–
me il feroit vrai qu'il conven<>it au genre de la tra–
_gédie ancienne, il n'en feroit pas moins incompatible
avec le fyfl:eme tout différent de la tragédie moEler–
~e- ,
&
a·vec la nouvelle forme .de nos théatres.
D'abord le
c'!z~urétant
devenu, d'aél:eur principal
qu'il étoit fur le chariot de Thefpis, un perfonnage
fuba1te:rne, un úmple·-conlident de 1a fcene trqgique,
on fe fit une habitude <le l'y voir,
&
cette habitude
1e mit en poíleffion du théatte: le
ch~ur
chantoit, les
-Grecs vouloient de la mufique : le
ch~ur
repréfen–
toit le ·peuple'
&
le peuple aimoit
a
fe voir dans
la confidence des grands: le
Ghr:eur
faifoit décora–
tion '
&
on l'employoit
a
remplir ·le vuide
d~ua
ihéatre immenftJ...
Rien de plus conven-able , éle p1tts toucbant
&
de plus bea
1
que de voir dans la tragédie des
Perles')
les
·viejllards choifis par Xerces pour gouverner en
fon aofe nce ' a tendre ' avec inquiétude' le fucces
-c:!e
La
hata.i-lle· de
S
alamines ; environner le
~OlUie t
CH<E
qui en porte la nouvelle; interrompre par
de~ g~miífemens
&
par des cris le récit de ce grand
d ' ..
fafire.
R'"1en de plus terrible que
"le
chtEur
des
E uminide.s
'dans la tragédie de c€ nom. On
dir
que l'effroi qu'il
~caufa
fut re1 que dans
1
amphithéatre les fenun es
enceintes avorterent. D epuis e t accident , le
haur
q ui i roit compofé de cinquante perfonnes, fut réduit
a
quinze
&
puis
a
douze' moins
a
la vérité p.our
·affoiblir l'impreffion
&1
fpe8-ac1e que pou en dimi–
nuer les frais.
Ríen
de
p1Iis ñature1
&
de plns pathétique, que
cl'entendre, dans la tragédie
d'Oidip e,
ce roi nvironné
des enfans des Théba:in's, ·conéluits- par le grand pre–
'tre , ouvrir la {cene par ces rnors :. (( lnforrun
's
)-' enfans., tendre race de l'antique Cadmus, quel fu–
.»
jet
,de trifieife vous !'a.ifemble en ces lieux
?
que
)) veulent dire
~es
handelettes
~
ces branches ' ces
)' fymboles de fuppliants? ..... • . Quelle crainte
~
»
quelle calamité , quel malheur préfent ou futur
>)
vous réunit aux pieds des -autels ? Parlez, me
,
voici pret
a
vous fecouri'r: je feróÍs infenúble
)>
fije
il
étois ému d'un fpeél:ade
fi
touchant ...
f.t le gtarrd-pretre lui répondre : " Vou·!;
oyez .;
\~
granel roí , cette troupe inclinée au pied de nos
»
autels. Voici des enfans
qtli
fe foutiennent
a
peine,
»
~s
facrificateurs courbés fous le. poids des an–
" nées,
&.
des jeunes hommes choiíis. Pour moi
je
tt
fuis le grand-pretre du fóuverain des dieux. Le
»
refie du peuple órné
de
couronnes eíl: difperfJ
" dans la place ; les uns.. entourent les deux
tem–
'' pies de Pallas ; les autres font autour des
aute~s
-,, d'
Apollon fur les bords
du
fleuve. La caüfe d'une
>)
fi vive douleur ne vous eíl: pas inco·nnue. Hélas
l
>'
Thebes prefqu'enfévelie d.ans un océan de maux
}>
pe'ut
a
peine
t~ver
la t&te
au · d~rrus
des abyme'
'' prófonds Cfui l'envinmnerlt. Déja la terre a
v.t
}) périr les moiifóns naiíla ntes ,
&
les tendres trou–
" peaux..
Les
enfans exoirent dans le fein de leurs
" m¡res. Un dieu ennemi, un fen dévorant , une
~'
pelte cruelle ravage la ville
&
enleve les habi–
'' táns. Le noir Pluton
~
enrichi de nos pertes,
fe
rit
>>
de nos gémiífemens
&
de nos pleurs. Tournés.
" vers les autels de vótre palais,
J}Chis
vous
invo~
,,
qu~s
'
fmon comn:le un dieu'
'dn
moins comtrle
'e<
l'e
plus grañd
·des
h'orhmes, fehl capable éle fou–
>>
lager nos maux,
~
d'appaifer la col ere du ciel ''·
Que1qu~fois
auffi un dialogue plus preífé dll
chamr avec
le perfonnage en aél:ion, étoit naturel
&
touchant, comme on le voit dans
PhiloRete.
Mais s'il
y
a dans le théatre Grec qYelques exern·
pies de cet heureux emploi du
chreur,
combien de
fois ne l'y ,voit-on pas inutile, oifeux, importun
&
contre toute vraífemblance? Quelle apparence que ,
Phedre confie fa honte aux femmes de Trezene
?,
De quel fecours eft
a
l'innocence d'Hyppolite ce
ch~ur
de femmes , ce
temo.inmuet, qui le voyant
condamné par fon pere , fe
cont~nte
de faire cette
froide réflexion: '' Qui des mortels peut- on ap•
'' peller heureux, quand on voit la fortune de nos
»
rois fujette á une
ú
trifie révolution
~<
?
Quoi de
plus froid encore
&
de plus
a
contre-tems' que cette
premiere partie du
chamr
qui fuit la fcene o
u
Phe--:
dre a pris la réfolution de mourir
?
'' Q ue ne fuis-je fur un rocher élevé ,
&
changé
" en oifeau!
a
la faveur de mes ailes je paíferois fur
t)
la mer Adriatique ,
&
fur les rives du Pó, ottles
H
infortunées fceurs de Phaeton répandent des lar–
»
mes d'ambre.
>>
'irois aux riches jardins des Hefpéndes,
nym.:
»
phes dont la douce·voix charme les orcilles, dans
,, ces climats on Neptune ne laiífe plus le paífage
H
iibre aux nauronniers; car il a pour terme le
>)
'iel foutenu par Atlas.
La
coulent toujours dw.
















