
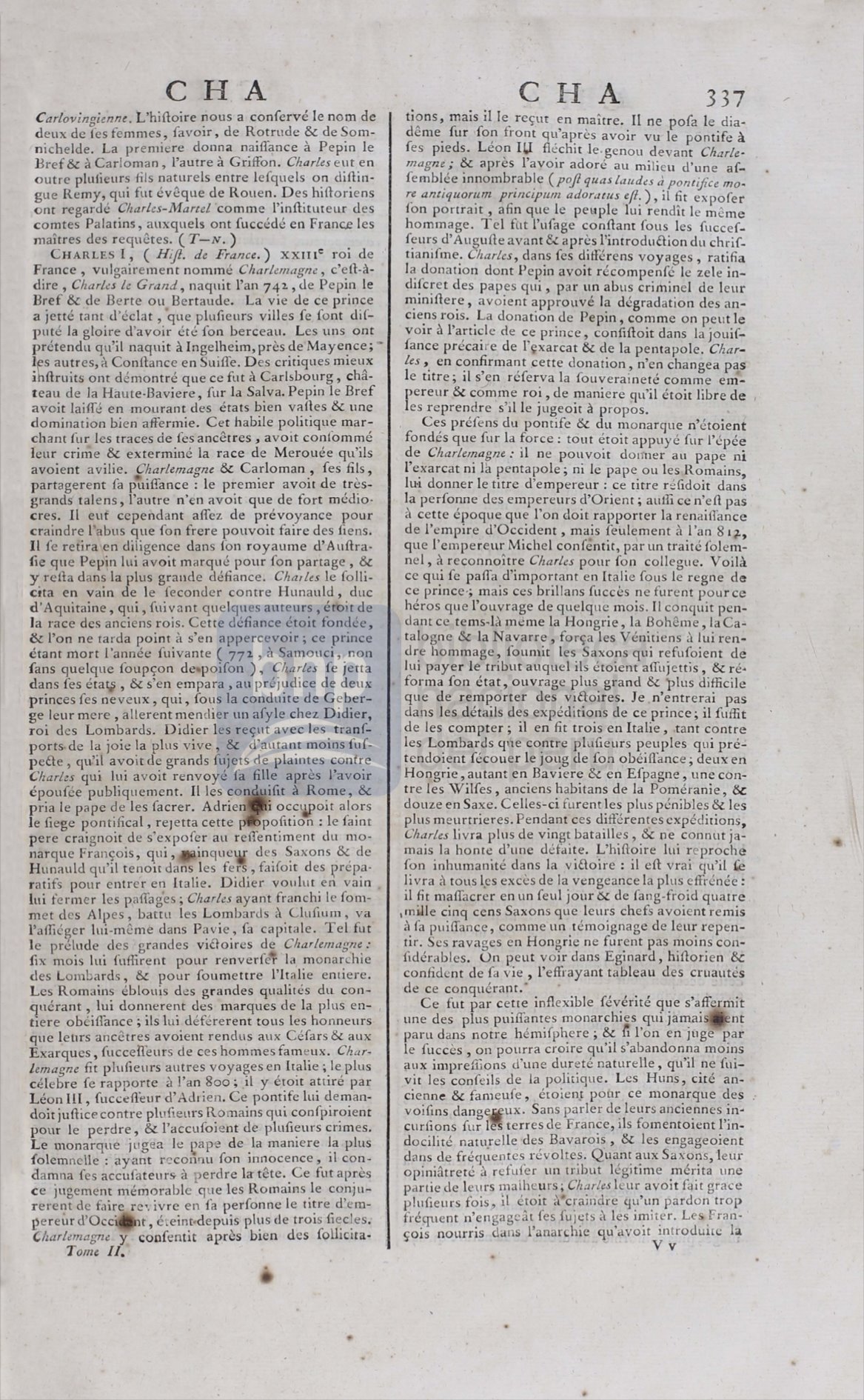
CHA
Carlovingienne.
L'hiftoire nous a confervé le nom de
deux de fes femmes, favoir, de Rotrude
&
de om–
nichelde. La premi re donna naiífance
a
Pepin le
l3ref
&
a
Carloman, l'autre
a
Griffon.
Charles
eut en
outre pluíieurs fils naturels entre lefquels on difl:in–
gue Remy, qui fut éveque de Rouen. Des hifroriens
ont regardé
Charles-Marte!
comme l'inftitureur des
comtes Palarins, auxquels ont fuccédé en Franc.e les
ma!tres des requ etes. (
T
-N.)
CHARLES
I, (
Hijl.
de France.)
XXIIIe
roi de
France , vu]gairement nommé
Charlemagne,
c'efr-a–
dire,
Charüs le Grand,
naqnit l'an 742, de Pepin le
Bref
&
de Berte ou Bertaude. La vie de ce prince
a jetté tant d 'éclat, que plufieurs villes fe font dif–
puté la gloire d'a voir éré fon berceau. Les uns ont
prétendu qu'il naquit
a
Ingelheim, pres de Mayence;
l~s
autres,
a
Confrance en uiífe. D es critiques mieux
i hfrruits ont d
1
montré que ce fut
a
Carlsbourg, cha–
teau de
la
Haute-Baviere, fur la Salva. Pepin le Bref
avoit laiffé en -mourant des états bien valles
&
une
dominarion bien affermie. Cer habite polirique mar–
chant fur les traces de fes ancerres
~
avoit confommé
leur crime
&
exterminé la race de Merouée qu'ils
avoient avilie.
Charlemagne
&
Carloman, fes fils,
partagerent fa puiífance : le premier avoit de tres–
grands talens, l'autre n'en avoit que de fort médio–
cres. Il euf cependant aífez de prévoyance pour
craindre l abus que fon frere pouvoit faire des fiens.
H fe retira en diiigence dans fon royaume d'
A
uíl:ra–
fie que Pepin luí avoit marqué pour fon partage,
&
y
refta dans la plus grande défiance.
Charles
le folli–
cita en vain de le fecon
der contre Hunauld, duc
d'Aquitaine, qui, fuivant quelqu.es auteurs, étoit de
]a race des anciens rois. Cette défiance étoit fondée ,
&
l'on ne tarda point
a
s'en appercevoir; ce prince
étant mort 1'année fui ante ( 772 ,
a
Samouci, non
fans quelque foupc;on de poifon ) ,
Clz.arLes
fe jetta
dans fes états,
&
s'en empara, a u pr ' judice de deux
princes fes neveux, qui, fous la condnite de Geber–
ge leur mere, allerent mendier un afyle chez Didier,
roi des Lombards. Didier les rec;ut avec les tranf–
ports de la joie la plus vive,
&
d'_autant moins fuf–
peae , qu'il avoit de grands fujets de plaintes contre
Charles
qui lui a voit renvoyé fa filie apres l'avoir
époufée publiquement. Illes conduiftt
a
Rome,
&
pria le pape de les facrer. Adrien
i
occu oit alors
le fiege pontifical, re1etta cette p
pofition : le fain t
pere craignoit de s'expofer au reífentiment du mo–
narque Franc;ois, qui,
inque r des Saxons
&
de
Hunauld qu'il tenoir dans les fers, faifoit des J?répa–
ratifs pour entrer en ltalie. Didier voulur en
ain
lui fermer les paífages ;
Charles
ayant franchi le fom–
met des Alpes, battu les Lombard
a
Clufium, va
l'affi '9er lui-meme dans Pa ie, fa capirale. Tel fut
le prelude des grandes viétoir s de
Charlemagne:
fix moi
lui fuffirent pour renverfer la monar
hie
des Lo1 bards ,
&
pour foumetrre l'ltalie emiere.
Les Romains éblouis des grandes qualités dtt con–
quérant , luí donnerent des marques de la plus en–
tiere ob ' iflance; ils lui déf; ' rerent tous les ho nneurs
que lettrs ancetres avoient rendus au x Céfars
&
aux
Exarques , fuccell"eurs de ces hommes fameux.
Char–
lemagne
fit plufteurs autres voyages en ltalie; le plus
cél bre fe r apporte
a
l'an 8oo; il y étoit at tiré par
Léon III, fucceífeur d' Adr ien. Ce pontife lui deman–
doit jufrice contre plufieurs Ro ains qui confpiroient
pour le perdre,
&
l'accufoient de plufieurs crimes.
Le monarque jugea le pape de la maniere la plus
folemnclle : aY'ant recorir-1u fon jnnocence, il con–
d amna fes accufateurs-
a
p erdre la tete. Ce fut apres
ce jugement mémorable que les RomaiFis le conju–
rerent de faire r e·. ivre en fa perfonne le ritre d'em–
pereur d'Occi nt, é -eint depuis plus de trois fiecles.
Cllarlemagne
y
'onfentit apres bien des follicita-
Tome. 11.
CHA
337
ti? ns, mais
il
le r e<;ut en mai tre.
Il
ne pofa le dia·
deme. fur fon front
qu
apres avoir vu le pontife
a
fes p1eds. Léon
IU
fléchi t le.genou de ant
Char!e–
magne ;
&
apres l'avoir adoré au milieu d'une af–
fembl~e innomb~ab!e
(pofl quas
laud~s
a
pontifice
mo~
re antLquorz:m prtnctpum adoratus efl.),
il
fit expofer
fon portralt, afinque le peHple lui rendlt le meme
hommage. Tel füt l'ufage confiam fous les fuccef–
f~ur_s
d'Augufie avant
&
apres
1
introduél:ion du chrif–
tiamfme:
Charles,
da~s
fes ditférens voyages, ratifia
1~
donatwn dont Pepm avoit récompenfé le zele in–
di~c:et
des papes qui, par un abus crimine! de leur
~m1fier_e,
avoient approuvé la dégradation des an–
Cle.nsr~ts.
_La donation. de Pepin, comme on peut le
VOlr
a1
artlcl e de Ce prmce COnfifioit dans la jouif–
{ance précaire de l'exarcat
&.
de la pentapole.
Char–
les'·
en
c?n~rma~t
cette donation, n'en changea pas
le utre; 1l sen referva la fouveraineté comme em–
pereur
&
comme roi, de maniere qu'il étoit libre de ,
les reprendre s'ílle jugeoit
a
propos.
Ce,s préfens du pon tife
&
~u ~n onarque
n'
1
toient
fondes que fur la force: tout
~t01t
appuyé fnr l'épée
~e
Charle,'!apne:
íl
ne
pot~volt
do11ner au pape ni
1
exarcat m la pentapole; m le pape o u les Romains
lu1 donner le titre d'empereur: ce rirre r éGdoit
dan~
la perfonne des empereurs d'Orienr; auífi ce n'eíl pas
a
cette époque que l'on doit rapporter la renaifiance
de l'empire d'Occident, mais feulement
a
1'an 8
1
'l–
que l' empereur Michel confentit, par un traité
folem~
nel'
a
reconnoitre
Charles
pour fon colleCTue. Voila
ce qu.i fe paífa.
d'impo~tant
en Italie fous
1~
regne de
ce pnnce·; mats ces bnllans fucces ne furent pour ce
héros que l'ouvrage de quelque mois . Il conquit pen–
dant ce tems-la meme la Hongrie, la Boheme , la Ca–
talogne
&
la Navarre, forc;a les Véniriens
a
luí ren–
dre hommage, foumit les Saxons qui refufoient de
lui payer le tribut auquel ils é roient aífujettis
&
réo~
forma fon état, ouvrage plus grand
&
plus clifficile
que de remporter des viéloires. Je n'entrerai pas
dans les détails des expéditions de ce prince; il fuffit
de
les
compter; il en fi.t trois en Italie, tant contre
les Lombards q 1e contre pltíieurs peuples qui pré–
tendoient fécouer le joug de fon obéiífance ; deux en
Hongrie, autant en Baviere
&
en Efpagne, une con–
tre les Wilfes, anciens habitans de la Poméranie,
&
douze en Saxe. Celles-ci fu rent les plus pénibles
&
les
plus meurtrieres. Pendant ces différentes expédirions
Clzarles
li vra plus de vingt batailles,
&
ne connut
ja~
mais la honre d'une défaite. L'hifi:oire lui r eproche
~on
inhumanité dans la v iétoire : il efi vrai qu'il fe
h vra
a
tous les exces de la vengeance la plus effr
1
née:
il fit maffacrer en un feul jour
&
de fang-froid quatre
,mille cinq cens Saxons que -leurs chefs avoient remis
a
fa puiífance' comme un témoignage de leur repen–
tir. Ses ravages en Hongrie ne furent pas moins con–
ftdérables. On peut voir daos Eginard, hifiorien
&
confi.d nt de fa
ie, l'effi·ayant tablean des cruautés
de ce conquérant. ·
Ce fut par cette inflexible févérité que s'affermit
une des plus pui.ífanres monarchies qui jamais · nt
paru dans notre h émifphere ;
&
1 l'on en juge par
le fu ce ' s, on pourra croire qu'il s'abandonna moins
aux impreffi ons d une dureté naturel'le, qu'il ne fui–
vit les confeils de la politique. Les Huns, cité an·
cienne
&
fam et~fe ,
éroient pottr ce monarque des
voifins dange ux. Sans parler de leurs anciennes in..
curfions fur les terres de France, ils fornentoient !'in–
docilité natu_r lle
de~ Bavaroi~
,
&
les engageoient
dans de frégue.nres r voltes. Quanr aux Sa xons, leur
opiniatreté
a
refufer un tribut légi time mérita une
partie de 1 urs maiheu rs;
Charles
1 ur avoit faít grace
pluíieurs fois' il étoit
a
c raindre qu'un pardon trop
fréquent n'engageat fes fujet
a
les imit er. Le
L
ran–
sois nourris dans l'anar hie qu avoit introduir
la
Vv
















