
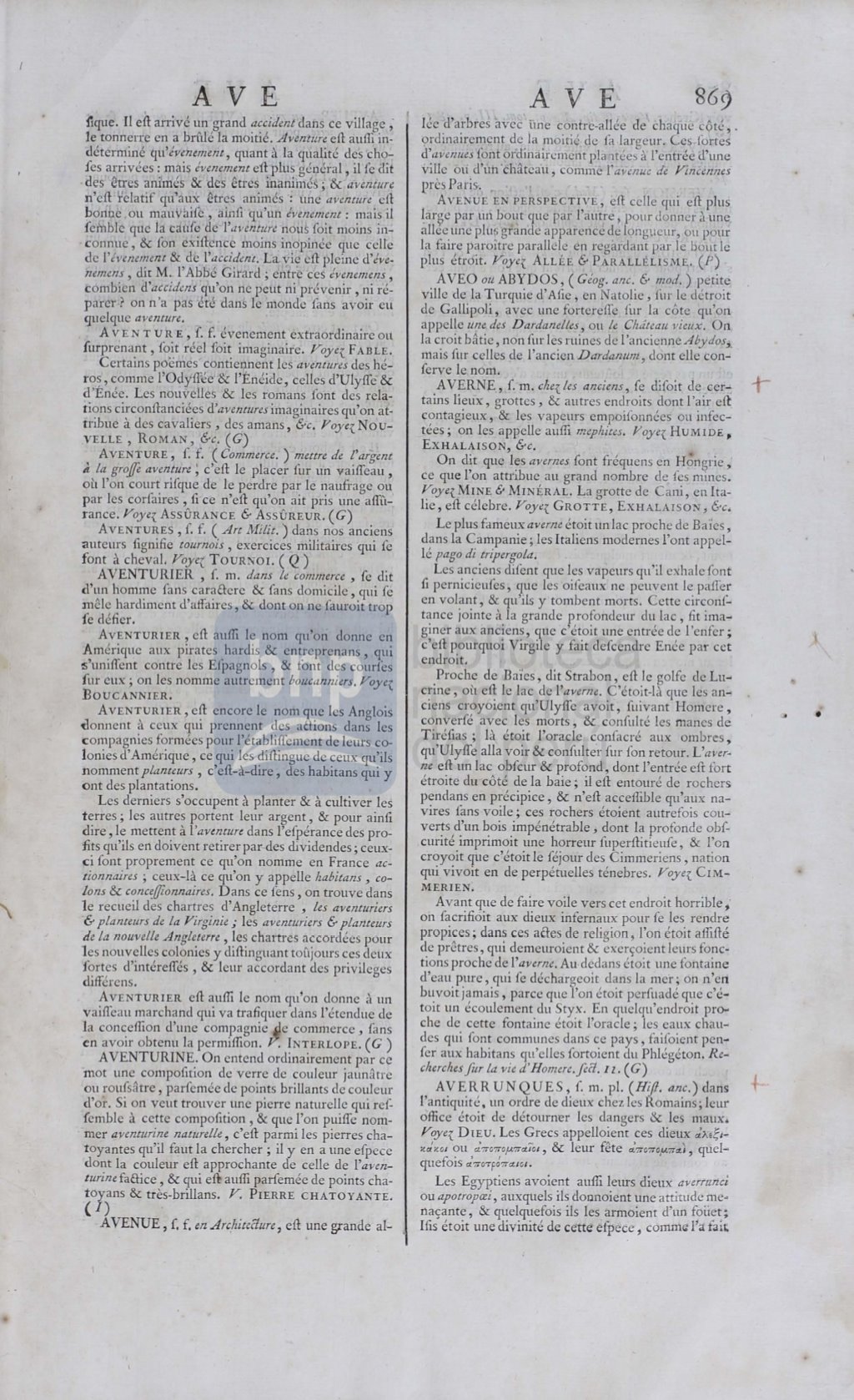
AVE
fIque. Il eft arrivé un grand
accidmt
dans ce village ;
le tonnerre en a brfllé la moitié.
Aventure
eft auíli in–
déterminé
qu'¿'venw¡ent,
quant a la ql1alité des cho–
fes arrivées : máis
évenenum
elt plus général , il {e
ilit
des erres ani'més
&
des erres inanihlés;
&
aventure
n'eft
~elatif
qu'aux etres anlmés : une
aventure
eft
bonue ou mauVhi{e , ainli qu'un
évenernem:
mais il
femblc que la
dure
de l'
aventure
nou!> foit moins in–
connue,
&
ron exiftencc moins inopinée que celle
de
l'évenernent
&
de
l'accident.
La vie cft pleine
d'.Ive–
nemens,
dir M. l'Abbé Girard; entre ces
évenemens ,
combien
d'actidcns
qu'on ne peut ni prévenir , ni ré–
pareT? on n'a paséré dans le monde [.1ns avoir eu
quelque
aventure.
A VE NT UR E, f. f. évenement extraordinaire
Oli
fnrpn::nant, {oit réel {oit imaginaire.
V oye{
FABLE.
Certains poemes contiennent les
aventures
des hé–
ros, comme l'Ody1I'ée
&
l'Énéide, celles d'UIyífe
&
d'Énée. Les nouvelles
&
les romans font des tela–
tions circonftanciées
d'avenwres
imaginaires qu'on at–
tribl1e
a.
des cavaliets, des amans ,
&c. Poye{ Nou–
VELLE, ROMAN,
&c.
(G)
AVENTURE, f. f.
(Commuce.) mettre de l'argent
.i
la gro./Je aventure ;
c'eft le placer
(lit
un vaiifeau ,
Oll l'on court ri{que de le perdre par le naufi'age
01.1
par les cor{aires , fi ce n'eft qu'on ait pris une aflll–
rance.
Voye{
ASSURANCE
&
ASSUREUR.
(G)
AVENTURES,
f.
f. (
Are Milit.
)
dans nos anciens
aurelll's fignifie
lournois
,
exercices militaires qui fe
font a cheva!.
Voyez
TOURNOI. (
Q)
AVENTURIER ,
f.
m.
dans le commerce
,
fe dit
el'un homme fans caraél:ere
&
fans domicile, qui (e
mele hardimenr d'atfaites,
&
dont on ne [aw-oir trop
fe défier.
AVENTURIER ,eft auíli le nom 'Iu'on donne en
Amérique aux pirates hardis
&
entreprenans, qui
lS'unifie nt contre les Ef¡)agnols ,
&
font des courú:s
fur eux ; on les nomme autremenr
boucanniers. Voye{
BOUCANNIER.
AVENTURlER, eft encore le nom que les Anglois
':¡onnent a ceux qui prennent des aélions dans les
eompagnies formées pour l'établiífement de lenrs co–
lonies d'Amérique, ce qui les diftingue de ceux qu'ils
nomment
plantwrs
,
c'eft-a-dire, des habitans qui y
ont des plantations.
Les derniers s'occupent a planter
&
a
cultiver les
terres ; les autres portent leur argent,
&
pour ainfi
elire, le menent
a
l'aventure
dans l'e{pérance des pro–
:firs qu'ils en doivent rerirer par des dividendes;
cewe–
ei font proprement ce qu'on nomme en France
ac–
tiollnaires
;
ceux-Ja ce qu'on y appelle
Izabitans
,
co–
lons
&
cOllc~[Jionllaires.
Dans ce ú:ns , on trouve dans
le recucil des chartres d'Angleterre ,
les aventuriers
& plantellrs de la rirgillie;
les
aventlLriers
&
plmtteurs
de lallouvelle Angleterre
,
les chartres accordées pour
les nouvelles colonies y diíl:inguant toftjours ces deux
fortes d'intéreífés ,
&
leur accordant des privileges
di1férens.
AVENTURIER eft auffi le nom qu'on donne
a
un
vaiífeau marchand
qui
va trafiquer dans l'étendue de
la conceílion d'une compagnie 'pe commerce, fans
en avoir obtenula permiffion.
Y.
INTERLOPE.
(G)
AVENTURINE. On entend ordinairement par ce
mot une compofttion de verre de couleur jaunatre
ou rotúsatre, parfemée de points briUants de couleur
d'or. Si on veut trouver une pierre nantrelle qui ref–
{emble
a
cette compolition ,
&
que l'on puiffe nom–
mer
aVelltllrine naturelle,
c'eíl: parmi les pierres cha–
toyantes qu'il fam la chercher ; il
Y
en a une efpece
dont la couleur eft approchante de celle de
l'aven–
lurine
failice ,
&
qui eíll auffi parfemée de points eha–
(61)ns
&
tres-brillans.
V.
PIERRE CHATOYANTE.
AVENUE,
r,
f,
en
Ar~hiteflure,
eíl: une grande al-
AVE
lée d'arbres avec tlne contre-allée de chaque cQté, .
ordinairemcnt de la moirié de
ú¡
largeul'. Ces {ortes
d'avellltes
font brdináircmcnt pla"ltées
a
l'entrée d'une
ville ou d'un 'chatea'u, comme
ravenuc de nnéémles
pres Paris.
AVENUE EN PERSPECTIVE, eíl: celle qui eíl: plus
!ar
g
e par un bout que par l'autre, pour Jonner
a
une
allee une
plu~
grande apparence de long\leur, ou pour
la faire paroltre paralléle en regardam par le bom le
plus étroit.
VoyC{
ALLÉE
&
PARALLÉLlSMf,.
(P)
AVEO
ou
ABYDOS, (
Géog. anc.
(,.
modo
)
perite
ville de la Turquie d'Afie, en atolie, filr le détroit
de Gallipoli, avec une forrereífe fm la cÓte qu'on
appelle
une
des Dardanelles,
ou
le Clzáuau vieux.
On
la croit batie, non{m les ruines de
l'ancienneAbydos,_
mais fm celles de l'ancien
Dardamllll,
dont elle con–
ferve le nomo
AVERNE,
r.
m.
che{ les anciens,
fe difoit de cer-
-t–
tains lieux, grottes,
&
autres endroirs dont l'air eft
contagieme ,
&
les vapeurs empoí{onnées ou infec-
tées ; on les appeUe auíli
meplzites. Poye{
HUMIDE .
EXHALAISON,
&c.
On dit que les
avernes
font fi-équens en Hongrie ,
ce que l'on attl'ibue au grand nombre de {es mines.
Voye{
MINE
&
MINÉRAL. La grotte de Cani, en Ita–
lie, eft célebre.
VoyC{
GROTTE, EXHALAISON ,
{,'c,
Le plus
fameuxaveme
étoit unlac proche de Bales,
dans la Campanie; les Italiens modernes l'ont appel–
lé
pago di tripergola.
Les anciens di{em que les vapeurs qu'il exhale font
fi
pernicieufes, que les oi{eaux ne peuvent le pa!fer
en volant,
&
qu'ils y tombent morrs. Cene circonf–
tance ¡ointe
a
la grande profondeur du lac , fir
ima~
giner aux anciens, que c'étoit une entrée de
1
'enfer ;
c'eft pourquoi Virgile y fait defcendre Enée par cet
endroit.
Proche de Bales, dit Strabon, eft le golfe de
Lu~
crine, on eft le lac de
l'averne.
C'étoit-la que les an–
ciens croyoient qu'Uly!fe avoit, fuivant Homere ,
conver{é avec les morts,
&
con{ulté les manes de
Tirélias; la étoit l'oracle confacré aux ombn:s ,
qu'Ulyífe alla voir
&
con{ulter {ur fon retour.
L'aller–
Ile
eft un lac ob{cur
&
profond, dont l'entrée efi fort
étroite du coté de la baie; il eft entomé de rochers
pendans en précipice,
&
n'eíl: acceílible qu'aux na–
vires fans voile ; ces rochers étoíent autrefois cou–
verts d'un bois impénétrable, dont la profonde obf–
cmité imprimoit une horreur {uperftitieufe,
&
l'on
croyoit que c'étoit le féjour des Cimmenens , nation
qui vivoit en de perpétuelles ténebres.
roye{
CIM–
MERIEN.
Avant que de faire voile vers cet endroit horrible,–
on facrifioit aux dieux infernaux pour (e les rendre
propices; dans ces aél:es de religion, l'on étoit aíliíl:é
de pretres, qui dememoient
&
exers:oient leurs fonc–
tions proche de l'
averne.
Au dedans étoit une fontaine
d'eau pure, qui fe déchargeoit dans la me'r; on n'en
buvoit jamais , parce que l'on étoit perfuadé que c'é–
toir un écoulement du Styx. En quelqu'endroit pro-–
che de cene fontaine étoit l'oracle; les eaux chau–
des qui font communes dans ce pays, faifoient pen–
fer aux habitans qu'elles fortoient du Phlégéton.
Re–
e/luclzesJitr
la
vie d'Homere.jeEl.
11.
(G)
AVERR UNQUES, f. m. pI.
(Hiji.
ane. )
dans
l'antiquité. un ordre dedieux chezles Romains; leur
office étoit de détourner les dangers
&
les maux.
V?ye{
D¡~u.
Les <?recs appellolent ,ces dieu?,
d.A,~,~"~D'
011
(J.'7TD'7TD!-,-'7Ttt.'D'
,
&
leur fete
tt.'7TD'7TD!-,-'7Ta..,
queI–
c¡uefois
d.'7TDTF~7Ttt.'DI.
Les Egyptiens avoient auffi leurs dieux
averrunci
ou
apotropai ,
auxquels ils doonoient une attitude me–
na<;ante,
&
quelquefois ils les armoient d'un foiier;
Ilis étoit une divinité de cette efpece, comm!: l'a fai.
















