
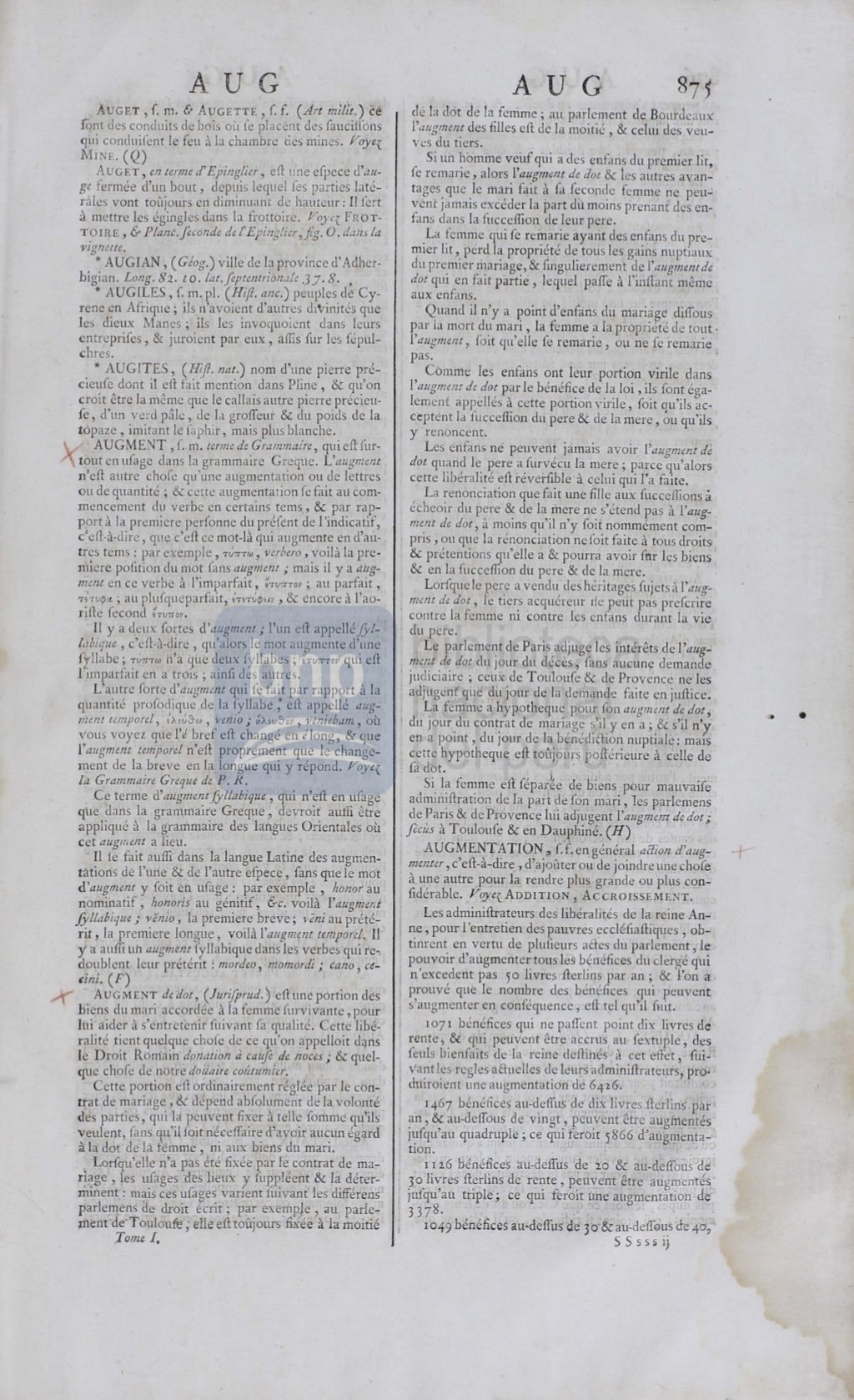
Aue
AUGET,
f.
m.
{,>
AUGETTE,
f.
f.
(Art milir.)
ce
font des condllits de bois
Olt
fe placent de [aucif!"ón
qui conduilcnt le feu a la chambre ¿es mines.
roye{
MI ·E.
(Q)
AUGET ,
en tume
ti'
Epillglier,
eíl: une e[pece d'
au–
ge
fermée el'un bout, depuis lequel fes parties laté–
rales vont toujours en diminuant de haut ur:
Il
(ert
a
mettre le égingles dans la frottoire.
Voy~{
FROT–
TOIRE,
&
Planc.foconde ddEpingltt:r,fig.
O.
d",'[J La
"igmue.
• AUGIAN ,
(G¿og.)
ville ele la province d Adher–
higian.
LOllg.82. lo.lat.fopwZlrion.z!e
.37. 8..
• AUGILES,
r.
m. pI.
(Hifl.
alIc.)
peuples de Cy–
rene en Afríque; ils n'avoient d'autres dl\rinités que
les díeux Manes; ils les ii1voquoíent dans leurs
entreprífes,
&
juroient par eux, affis f'tlr les f¿pul–
chres.
• AUGITES,
(H'tfl.
flat.)
nom d'une pierre pré–
cieufe dont íl eíl: faít mention dans Pline,
&
911'on
croít etre la meme que le callals autre pierre precieu–
fe, d'un verd pale , de la groífeur
&
du poids de la
tópaze, imitant le ¡¡-¡phir, mais plus blanche.
AUGMENT ,
r.
m.
lmm de Grammaire,
qui eíl: fur–
tout en ufage dans la grammaire Greque.
L'flIlgmem
n'eíl: autre chofe qu'une augmentation ou de lettres
ou de quantité ;
&
celte augmentatíon fe fait au com–
rnencement du verbe en certains tems,
&
par rap–
P.ort a la premiere perfonne du préfent de l'indicatif,
c'eíl:-a-dire, que c'eíl: ce
mot-l~
(¡ui augmente en d'au–
tres tems : par exemple ,
7~7T'T"',
verbero,
voila la pre–
miere polition du mot fans
allgll/em
;
mais il ya
attg–
m,em
en ce verbe
11
l'iml?arfait?
t'TU7T'TOV;
au
pa,rf~it
,
"''TU,!>"
;
au plufqucparfalt,
'7ITO,!>'" ,
&
encore a
1
ao–
riíl:e fecond
:'TU7T01'.
Il
ya dem: fortes
d'augmelll;
l'un eíl: appelléiY/–
/tlbi,/ll~
,
c'~íl:-¡'¡-d!re
, qu'alors le mot aU,pmente d'nnc
ftllabe;
'TU7T'T'"
n a que deux fyllabes ;
''TU7T'TDI'
'1111
eíl:
l'imparfait en a trois ; ainli des atltres.
L'autre forte
d'augmml
qui fe fait par rapport a la
quantité
profo(!iq~le
de la
~ylla,be
; eíl:
apl~ellé aug~
n}mt lempore!,
,).,u-'7""
vemo;
,,).w-'7,,'
,
vemehtlm,
ou
vous voyez que
l'é
bref eíl: changé en élong,
&
Cjue
l'augmem temporel
n'eíl: proprement que le change–
ment de la breve en la longue
qui
y
répond.
roye{
la Grammaire Greque d. P. R.
Ce terme
d'allgment.fYllabique,
qui n'eíl: en ufage
qtle dans la grammaire Greque, devroit aulll etre
appliqué
a
la grammaire des langues Orientales oLI
cet
aug1l,ml
a lieu.
Il
le fait auffi dans la Jangue Latine des augmen–
tations de l'une
&
de l'autre efpece, fans que le mot
d'allgment
y foit en ufage: par exemple ,
!tono/'
au
nominatif,
honoris
au génitif,
&c.
voilll l'
auglTulIt
fyllabique; venio,
la premiere breve;
l'tni
au prété–
rir, la premiere longue, voila
I'allgmem tempore/.
Il
)" a auffi un
ollgme~~
Iyllabique dans les
v~rbes
qui re–
doublent lem pretent :
mordeo, momordt; cano, ce–
,ini. (F)
AUGME T
dedot, (Jurifprud.)
eíl:uneportiondes
hiens du mari accordée a la femme furvivante, pour
lui aider a s'entr tenir fuivant fa qualité. Cette libé–
raEté rienrquelque chofe de ce qu'on appelloit d¡¡ns
le Droit Rorrtain
dOllation
ti
callfo.
d~
noces;
&
quel–
que chofe de notre
doÍiaire co(ullmier.
Cette portion eíl: ordinairement réglée par le con–
trat de mariage ,
&
dépend abfolllmenr de la volonté
des parties, qui la peuvent fixer
a
telle fomme qu'ils
veulent, fans qu'il fOlt néceífaire d'avoir aUClm ég¡¡rd
a
la dot de la femme, ni aux biens du mari.
Lorfqu'elle n'a pas été fuée par le contrat de ma–
rlage , les llfages des liellx y filppléenr
&
la dérer–
minent: mais ces lIfages varíenr li.úvant les dífférens
parlemens de droit écrit; par exemp)e , au parle–
¡nenr de Toulouft:, elle eíl:toújonrs fixée
a
la moirié
Tome
1,
Aue
dé
l~
dot de la femme ; au parlement de Bourcleaux
l'allgmu/l
des filIes eíl: de la moitié,
&
celui des veu–
ves du tiers.
Si un homme veufqui a des enfans du premier lit,
fe remarie, alors
l'augmam de dOl
&
les aun-es avan–
ragcs que le mari fait
a
fa feconde femme ne peu–
vcnt jamais excéder la part dÍ! moins prenanr des en–
[¡\11S
dans la fucceffion de leur pere.
.
La femme c¡ui fe rt!marie ayant des enfans du pre–
miel' lit, perd la propriété de tous les gains nuptiaux
du premier mariage,
&
linguüerement de l'
ollgmemde
dOl
qui en fait partie, lequel paífe a l'infiant meme
aux enfans.
Quand il n'y a point d'enfans du mariage diífous
par la mort du mari , la femme a la propriété de tout .
l'augmenl,
loit <jl1'elIe fe remarie, ou ne fe remarie
pas.
Comme les enfans ont leur portion virile dans
l'
allgmem de dOl
par le bénéfice de la loi , ils (onr éga–
lemenf appellés a cette ponion virile, foit qu'ils ac–
ceptent la fucceffion di! pere
&
de la mere, ou qu 'ils
y renoncenr.
Les enfans ne peuvent jamais avoir
l'augment
d~
dOl
<jlland le pere a furvécu la mere; parce qu'alors
cette libéralité eft révedible a celui qui I'a faite.
La renonciation que fait une filIe aux fucceffions
a
écheoir du pere
&
de la mere ne s'étend pas a
l'aug–
mem de dOl,
a
moins qu'íl n'y foit nommément
COO1-
pris, on que la rénonciation ne foit faite a tous droits
&
prétentions c¡u'elle a
&
pourra avoir fnr les biens
&
en la fucceffion dil pere
&
de la mere.
Lorfquele pere a vendu des héritages fujets a l'
allg–
lIlent d. dOl,
le tiers acql1éreur rle peut pas prefcrire
contre la femme ni contre les enfans durant la vie
du pere.
Le parlemenr de Paris adjuge les intérets de l'
allg–
lIlenl de dOl
dn jour du déces, fans aucune demande
judiciaire ; ceux de Toulou(e
&
de Provence ne les
adjugent <jlH:! dll jour de la demande faite en juíl:ice.
La femme a hypothec¡ue pour fon
ollgment de dot;
du jonr du contrat de mariage s'il y en a;
&
s'il n'y
en a point , du jour de la b 'nédiétion nuptiale : malS
cette hypotheque eíl: tOtljours pofiérieure a celle de
fa
dbt.
~
Si la femme eíl: féparee de biens pour mauvaife
adminiíl:ration de la part de ron mari, les parlemens
de Paris
&
de Provence lui adjugent l'
allgmem de dot;
flcUs
a Touloufe
&
en Dauphiné.
(H)
AUGMENTATION '"
f.
f. en général
aaion d'allg–
menter,
c'eíl:-a-dire ,d'ajollter ou de joindreune chofe
a
une autre pour la rendre plus grande ou plus con–
lidérable. Vo/e{ADDITlON, ACCROISSEMENT.
Les admíniíl:rateurs des libéralités de la reine An–
ne, pour
1
'entretien des pauvres eceléliaíl:i<jlles , ob–
tinrent en vertl1 de plulieurs aétes du parlement, le
pouvoir d'augmenter tous les bénéfices du clergé quí
n'excedent pas 50 livres i1:Cl'lins par an ;
&
1'on a
prouvé que le nombre des bénéfices qui pellvent
s'augmenter en conféc¡uence, efr
te!
qu'il fuit.
1071 bénéfices <jlIÍ ne paífent point dix livres de
rente,
&
qui peuvent etre accrus au fexmple, des
feuls bienfaits
de
la reine deíl:ihés
11
cet effet, fui–
"antles regles afruelles de leurs adminiíl:rateurs, pro–
chlÍroient une augmentation de 641.6.
1467 bénéfices au-deífus de dix
livres1l:erlin~
par
an ,
&
au-deífous de vingt, peuvent etre augh1entés
jufqu'au quadruple; ce <jllÍ feroit 5866 d'augmenta–
tion.
1
li6 bénéllces
~-deí[l1s
de 1.0
&
au-deífous de
JO
livres íl:erlins de rente, pel1vent &tre al1gmentés
jufqu'au triple; ce
qui
feroit (me augmentation
de
337 8.
1049
bénéfices al1-deífl1s
de
30-&
au-deífous de
4
0,
S S
s
ss ij
•
















