
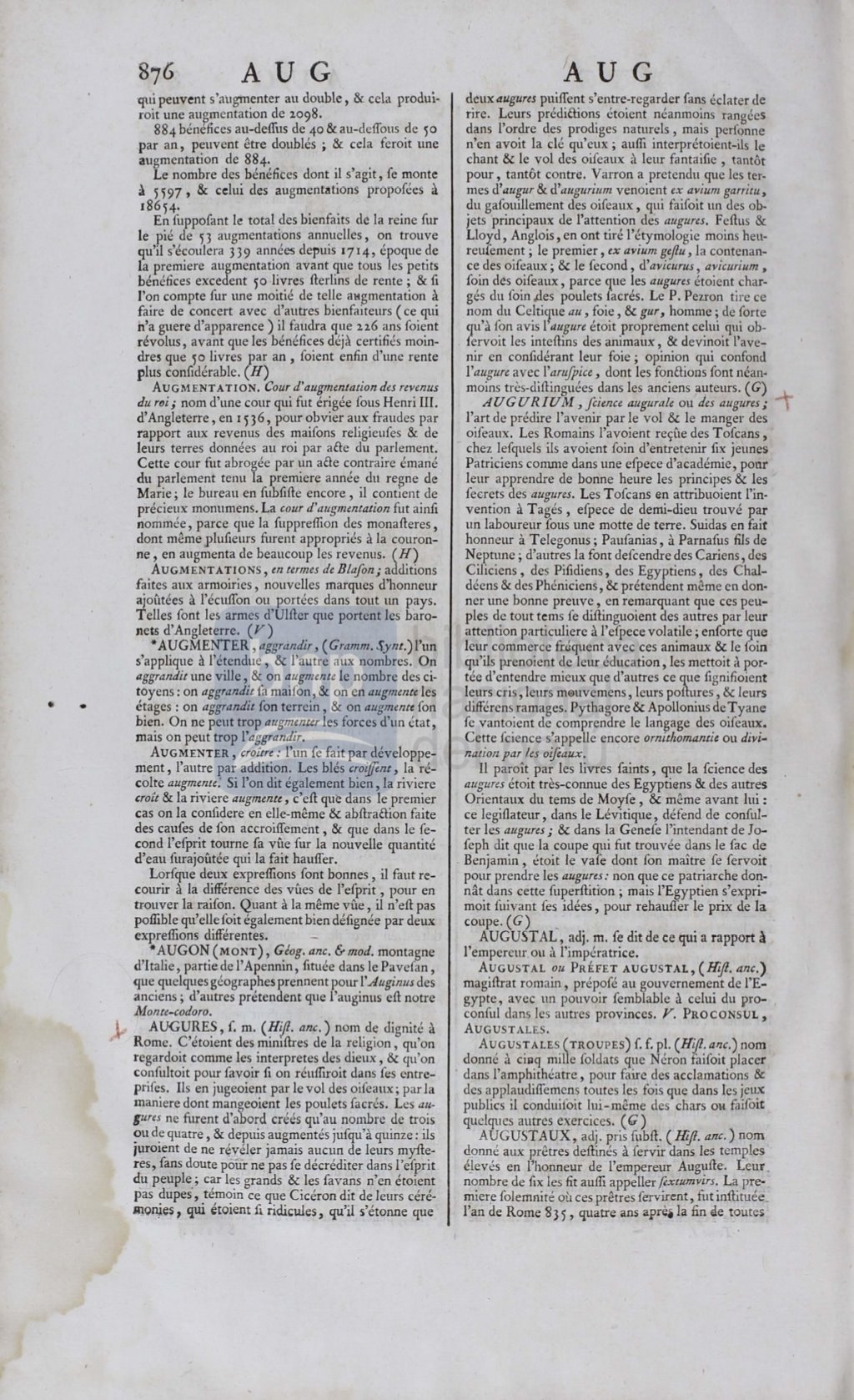
AUG
qui
peuvent s'allgmenter au double,
&
cela produi–
roit une augmentation de 1098.
884 bénéllces au-defi'us de 40
&
au-dcífous de 50
par an, peuvent etre doublés ;
&
cela feroit une
3ugmentanon de 884.
Le nombre des bénéfices dont il s'agit, fe monte
¡\
5597,
&
celui des augmenrations propofées a
1$654'
En fuppofant le total des bienfaits de la reine fur
le pié de 53 augmentations annueHes, on trouve
qu'il s'écoulera 339 années depuis 1714, époque de
la premiere augmentation avant que tOllS les petits
bénéfices excedent 50 livres fierlins de rente;
&
íi
l'on compte fur une moitié de telle aligmentation
a
faire de concert avee d'autres bienfaireLUs ( ce qui
n'a guere d'apparence ) il faudra que u6 ans foient
révolus, avant que les bénélices déja certiliés moin–
dre5 que 50 livres par an, foienr enlin d'une rente
plus coníidérable.
(H)
AUGMENTATION.
Cour d'augmentation des revenus
du roí;
nom d'une cour qui fut érigée fous Henri
ur.
d'Angleterre, en 1536, pOltr obvier aux fraudes par
rapport aux revenus des maifons religieufes
&
de
leurs terres données au roi par aéte du parlement.
Cettc cour fut abrogée par un aéte contraire émané
du parlement tenu la premiere année du regne de
Marie; le bureau en fubfille eneore , il contient de
précieux
monumens.Latour d'augmentalÍon
fut ainii
nommée, parce que la fuppreffion des monafieres,
dont meme plufieurs furent appropriés a la couron–
ne, en augmenta de beaucoup les revenus.
(H)
AUGMENTATIONS,
en
termes de BlaJon;
additions
{aites aux armoiries, nouvelles marques d'honneur
ajolltées a I'écuífon ou portées dans tout un pays.
Telles font les armes d'Uiller que portent les baro–
nets d'Anglererre.
(V)
*
AUGMENTER,
aggrandir, (Gramm. Synt.)l'un
s'applique a I'étendue,
&
I'autre allx nombres. On
Ilggrandit
une ville,
&
on
augmtnee
le nombre des ci–
toyens: on
aggrandit
fa maiCon,
&
on en
augmente
les
étages : on
aggrandit
fon terrein ,
&
on
augmenu
fon
bien. On oe peut trop
augmenur
les forces d'un état,
mais on peut trop l'
aggrandir.
AUGMENTER,
eroítre:
I'un fe fait par développe–
ment, I'autre par addition. Les blés
eroif{ent,
la ré–
eolte
augmenu:
Si 1'0n dit également bien, la riviere
erOle
&
la riviere
augrn.ente,
c'efi que dans le premier
eas on la confidere en elle-meme
&
abfuaétion faite
des caufes de fon accroiífement,
&
que dans le fe–
cond l'efprit tourne fa vlle fur la nouvelle quantité
d'eau furajoutée qui la fait halllfer.
Lorfque deux expreffions font bonnes , il faut re–
eourir a la différence des viles de l'efprit, pour en
trouver la raifon. Quant
a
la meme vlle,
il
n'efi pas
polfilile qu'ellefoit également bien déíignée par deux
expreilions différentes.
-
*
AUGON (MONT),
Géog. ane.
&
modo
montagne
d'Italie, partie de l'Apennin, íinlée dans le Pavefan ,
que qllelquesgéographesprennent pOLU
l'Auginus
des
anciens; d'autres prétendent que I'allginlls efi notre
Monee-eodoro.
AUGURES, f. m.
(Hi/!.: ane.)
nom de dignité
a
Rome. C'étoient des mirufues de la religion, qll'on
regardoit comme les interpretes des diellx,
&
qu'on
eonfultoit pOLU favoir íi on réuffiroit dans fes entre–
priCes. lis en jugeoient par le vol des oifeallx; par la
maniere dont mangeoient les pOlllets facrés. Les
au–
gures
ne furent d'abord créés qu'au nombre de trois
?u d.e quatre,
&
dep,uis augmentés jufqu'a quinze: ils
¡UrOlent de ne
r~veler
jamais aucun de leurs myfre–
res, fans doute pour ne pas fe décréditer dans l'efprit
du peuple; car les grands
&
les favans n'en étoient
pas dupes, témoin ce que Cicéron dit de leurs céré–
InQllÍes, qui étoient
f¡
ridicules) qu'il s'étonne que
:Aue
deux
augures
puilfent s'entre-regarder fans éclater de
rire. Leurs prédiétions étoient néanmoins rangées
dans l'ordre des prodiges nanlrels, mais perConne
n'en avoit la cié qu'eux; auffi interprétoient-ils le
chant
&
le vol des oifeaux
a
leur fantaifie , tantot
pour, tantot contre. Varron a pretendu que les ter–
mes d'
augur
&
d'
augurimn
venoient
ex avium garrim,
du gaCouillement des oifeaux, qui faifoit un des ob–
jets principaux de l'attention des
augures.
Fefius
&
Lloyd, Anglois, en ont tiré I'étymologie moins heu–
reu[ement; le premier,
ex avium gejlu,
la contenan–
ee des oifeaux;
&
le fecond, d'
avieuru5, avieunum,
{oin des oifeaux, parce que les
augures
étoient char–
gés du foin .des poulets facrés. Le P. Pezron tire ce
nom du
Celti~ue
au,
foie ,
&
gur,
homme ; de forte
qu'a fon avis
1
augure
étoit proprement celui qui ob–
fervoit les intellins des animaux,
&
devinoit l'ave–
nir en conúdérant leur foie; opinion qui confond
l'augure
avec l'
arufpiee,
dont les fonétions font néan–
moins tres-dillinguées dans les anciens auteurs.
(G)
AUGURIUM ,jcience augurale
ou
des augures;
l'art de prédire l'avenir par le vol
&
le manger des
oifeaux. Les Romains I'avoient
re~tle
des Tofcans,
chez lefquels i1s avoient [oin d'entretenir íix jeunes
Patriciens corrune dans une efpece d'académie, poor
leur apprendre de bonne heure les principes
&
les
fecrets des
augures.
Les Tofcans
cm
attribuoient l'in–
vention a Tagés, efpece de
demi~dieu
trouvé par
un laboureur fous une motte de terreo Suidas en fait
honnenr
a
Telegonus; Paufanias,
a
Parnafus lils de
Neptune; d'autres la font defcendre des Cariens, des
Ciliciens, des Pifidiens, des Egyptiens, des Chal–
déens
&
des Phéniciens,
&
prétendent meme en don–
ner une bonne preuve, en remarquant que ces peu–
pies de tout tems fe difringuoient des autres par leur
attention particuliere
a
l'efpece volatile; enforte que
leur commerce fréquent avee ces animaux
&
le foin
qu'i1s prenoient de leur éducation, les mettoit
a
por–
tée d'entendre mieux que d'autres ce que íignilioient
leurs cris, lellrs m0uvemens, leurs pofrures ,
&
leurs
différens ramages. Pythagore
&
Apollonius deTyane
fe vantoient de comprendre le langage des oifeaux_
Cette [cience s'appelle encore
omithornamie
ou
divi–
nalÍolZ par les oiflaux.
11 parolt par les livres faints, que la fcience des
augures
étoit tres-connue des Egyptiens
&
des autres
Orientaux du tems de Moyfe,
&
meme avant lui :
ce legi/lateur, dans le Lévitique, défend de conful–
ter les
augures;
&
dans la Genefe l'intendant de Jo–
feph dit que la coupe qui fut trouvée dans le fac de
Benjamin, étoit le vafe dont fon maltre fe fervoit
pour prendre les
augures:
non que ce patriarche don–
nat dans certe fuperilition ; mais l'Egyptien s'expri–
moit fuivant fes idées, pour rehauífer le prix de la
coupe.
(G)
_
AUGUSTAL, adj. m. fe dit de ce qui a rapport
¡\
l'empereur ou
a
l'impératrice.
AUGUSTAL
ou
PRÉFET AUGUSTAL,
(Hifl.
ane.)
magifirar romain , prépofé au gouvernement de l'E–
gypre, avec un pouvoir [emblable a celui du pro–
conCul dans les mItres provinces.
V.
PROCONSUL,
AUGUSTALES.
AUGUSTA LES (TROUPES) f. f. pI.
(HiP.ane.)
nom
donné
a
cillq mitle foldats que Néron taifoit placer
dans I'amphithéatre, pour faire des acclamations
&
des applaudiífemens toures les f01s que dans les jeux
publies il conduiCoit lui-meme des chars OH faifoit
quelques autres exercices.
(e)
AUGUSTAUX, adj. pris fubfi.
(Hzjl.
ane.)
nom
donné aux pretres defunés
a
[ervir dans les temples
élevés en l'honneur de I'empereur Augufie. Leur
nombre de íix les lit auffi appeller
(extumvirs.
La pre–
miere folemnité Ol! ces prerres fervirent, ti¡t iníl:ituée_
l'an de Rome 835, quatre ans apre¡la fin de toutes
















