
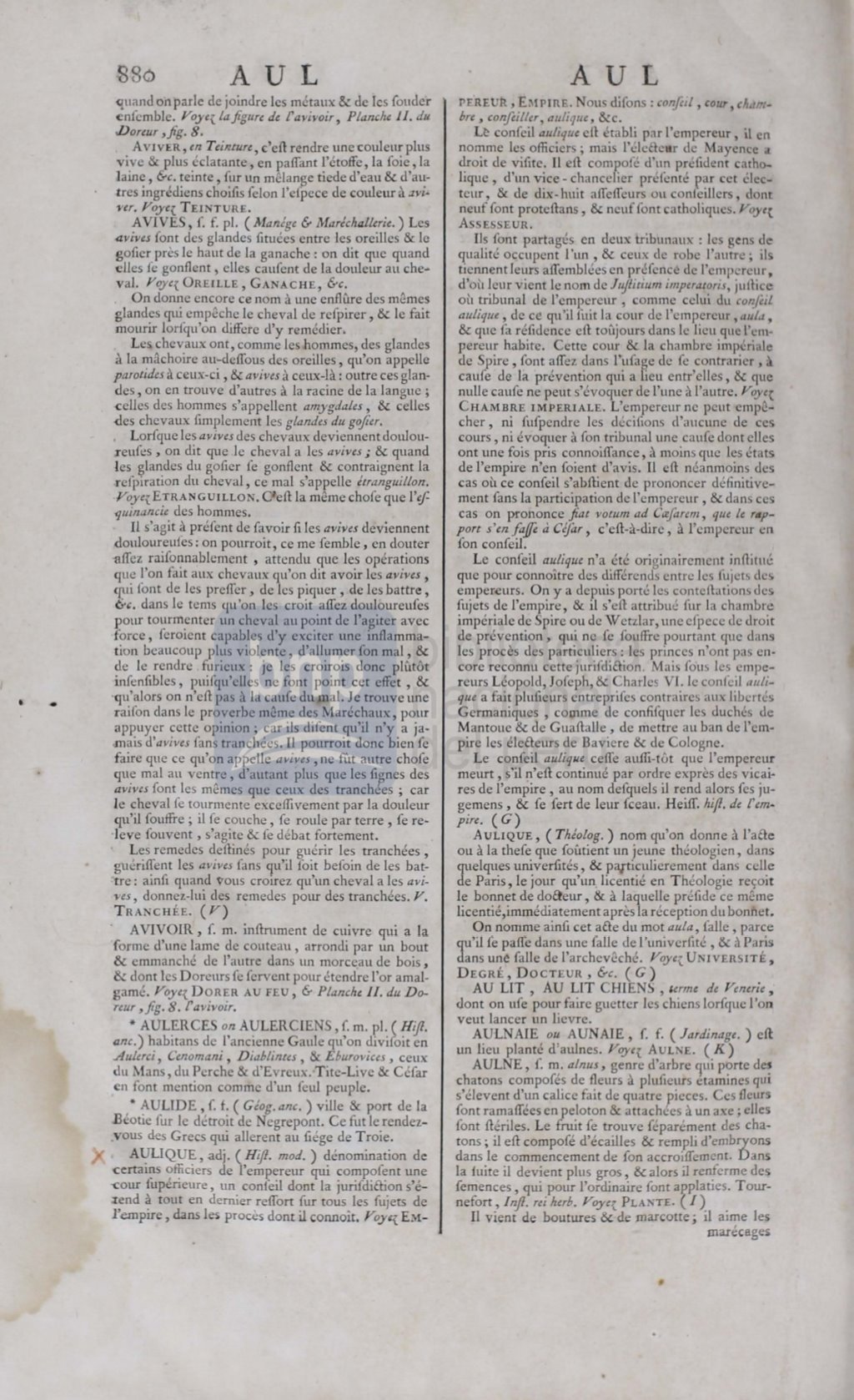
880
AUL
<¡uand on parle de joindre les métaux
&
de les fouder
en(emble.
YOyt{ la jigl/U de t'avivoi" Planche
11.
du
J.)oreur ,jig.
8.
A
V1VER,
w
TeilUU,e,
c'efi rendre une couleur plus
vive
&
plus éclatante, en palI'ant l'étolfe, la foie, la
laine,
&c.
reinte, fur un melange riede d'eau
&
d'au–
tres ingrédiens choifts felon I'efpece de couleura
avi"
ver. Yoye{
TEINTURE.
AVIVES, f. f. pI.
(Manlge
&
Martchalúrie.
)
Les
avives
(Ont des glandes firuées entre les oreilles
&
le
golier pres le haut de la ganache : on dit que quand
elles fe gonflent , elles caufent de la doulellr au che–
val.
f/oye{
OREILLE, GANACHE,
&c.
On donne eneore ce nom a une enfllire des memes
glandes qtú empeche le cheval de refpirer ,
&
le fair
mourir lor{qtl'on differe d'y remédier.
Les chevaux ont, comme les hommes, des glandes
a
la
m~choire au~deífous
des oreilles, qu'on appelle
parotides
a
cellx-ci ,
&
avives
a
ceux-la; outre ces glan–
des, on en trouve d'autres
a
la racine de la langue ;
eelles des hommes s'appeJlent
amygdales,
&
celles
¿es chevaux funplement les
glandes du gojier.
, Lor{que les
avives
des chevaux deviennentdoulou–
reufes , on dü qtle le cheval a les
avives;
&
quand
les glandes du gofier fe gonflent
&
contraignent la
refpiration du cheval, ce mal s'appelle
üranglúllon.
Yoye{ETRANGUILLON. CleO: la meme chofe que
l'ej
~uinancie
des hommes.
II
s'agit
a
préfent de favoir fdes
aviyes
deviennent
Qouloureufes; on pourroit, ce me femble , en douter
-alI'ez raifonnablement , artendu que les opérations
que l'on fait aux chevaux qu'on dit avoir les
avives,
qlÚ font de les pre!fer, de lcs piquer , de les bartre,
&c.
dansle tems qu'on les creit a!fez douloureufes
pour tourmenter un cheval au point de l'agiter avec
force, feroient capables d'y exciter une inflamma–
tion beaucoup plus violente, d'aHumer fon mal,
&
de le rendre furiellx; je les croirois donc plutot
infenúbles, puifqu'eUes ne font point cet effet ,
&
'qu'alors on n'eO: pas
a
la caufe dn mal. Je trouve une
raifon dans le proverbe meme des Maréchaux, ponr
appuyer cette opinion ; car
ils
Ment qtl'Ü n'y a ja–
.mais
d'avives
fans tranchées.
Il
pourroit donc bien fe
faire que ce qtl'on appeLle
avives,
ne ñlt autre chofe
que mal au ventre, d'amant plus que les fignes des
avives
font les mellles que ceux des tranchées ; car
le cheval fe tourmente exccffivement par la douleur
qu'il fouffTe; il fe couche, fe roule par terre , fe re·
leve Couvent , s'agite & fe débat fortement.
Les remedes dellinés pour guérir les tranchées,
guéri{[ent les
avives
fans qn'il foit be[oin de les bat–
tre; ainfl quand ,,"ous croirez qu'un cheval a les
avi–
ves,
donnez-lui des remedes ponr des tranchées.
Y.
TRANCHÉE.
(Y)
AVIVO
IR,
f.
m. infullment de cuivre qui a la
forme d'une lame de couteau, arrondi par un bout
&
emmanché de l'autre dans un morceau de bois,
&
dont les Doreurs fe fervent pour étendre ['or amal–
gamé.
Yoyt{
DORER AV FEU,
&
Planche ll. du
D~
reur ,jig.
8.
t'avivoi,.
*
AULERCE
on
AULERCIENS,c.
m,
pI. (
Hijl.
anc.)
habitans de l'ancienne Ganle qu'on divi(oit en
Aulerci, Cmomani, Diahlintes,
&
Eburovices
,
ceux
du Mans, du Perche & d'Evreux. Tite-Live & Cé[ar
en fout mention comme d'tUl feul peuple.
.. AULlDE ,
f.
f. (
Géog. anc.
)
ville
&
port de la
.B
'oue fur le détroit de egrepont. Ce fut le rendez–
vous des Grecs qtú allerent au fiége de Troie.
Al!UQ
E,
adj.
(Hijl.
modo
)
dénominauon de
<:ertal~
officier. de I'empereur
qui
compofent une
our lupérieure , un conleil dont la jurifdiétion s'é–
l:end
a
toue en dernier re!fort fur tous les fujets de
l'empire, dans les proces dont il connotr.
YOY'{
E;\[-
AUL
PERE R,
E~IPIRE.
ous difons ;
confid
,
COUT, C!..lnl–
bre, confliller, allli'lut,
&c.
Le
confeil
al/fique
en rabli par l'empereur, il en
nomme les officier ; mais
l'
éleétellr de
1a
yence
d
droit de vilite.
Il
en compofé d'un prélident carho–
lique, d'un vice - chancelier prélenté par cet é\ec–
teur,
&
de dix-huie a!felI'euTs ou confeillers, dont
neuf font protenans,
&
neuf[ont carholiqtles.
Yoye{
ASSE EUR.
lis font partagés en deux tribunallx : les gens de
qtlalité occupent l'un ,
&
ceux de robe I'autrc; ils
uennent leurs aífemblées en préfence de l'empcreur.
d'ollleur vient le nom de
Jujlitium imperatorrs,
juíl:ice
on tribunal de l'empereur , comme cclui du
cOfljell
auli'l"e,
de ce qll'il1iút la cour de l'emperenr,
dllfa,
&
que [a rélidence e/1 toujours dans le [ieu que \'cm–
pereur habite. Cette cour
&
la chambre impériale
de Spire , font a!fez dans l'ufage de fe contrarier ,
a
caufe de la prévention
qt.tia lieu enrr'elles,
&
que
nuLle caufe ne peut s'évoqtler de ¡'une
a
l'autre.
Voye{
CHAMBRE IMPERIALE. L'empereur ne pent empe–
cher, TÚ fufpendre les déciúons el'allcune de ces
cours, ni évoqtler
a
(on tribunal une c¡Jufe dont elles
ont une fois pris connoilI'ance, a moins que les états
de l'empire n'en foient d'avis.
n
efi néanmoins des
cas on ce confeil s'abftient de prononcer définitive–
ment fans la participation de l'empereur ,
&
dans ces
cas on prononce
jiat voturn ad ClIlfarern, que
le
r4p–
port s'en faJ!e
a
Cijar,
c'e/1-a-dire,
a
l'empercur en
fon confeil.
Le confeil
auliqrte
n'a été originaircment infiilu<;
qtle pour connoitre des différends entre les fujces elcs
empereurs. On ya deptús porté les conteíl:ations dcs
flljets de l'empire,
&
il s'e/1 artribllé {m la chambre
impériale de Spire ou de Wetzlar, une efpece de droit
de prévention, qui ne fe foufl're pourtant que dans
les proces des particuliers ; les princes n'ont pas en–
core reconnu certe jurifdillion. Mais (ous les empe–
renrs Léopold, Jofeph,
&
Charles VI. le con(cil
(llt/i–
que
a fait pluGeurs entreprifes contraires aux
libcrt~s
GermaTÚqtles , COOlme de confifquer les duchés de
Mantone
&
de Gnaí1:alle, de mettre au ban de l'em–
pire les élelleurs de Baviere
&
de Cologne.
Le confeil
aulique
ceíf'e auili-tot que l'empercur
meurt, s'il n'efi continué par ordre expres des vicai·
res de l'empire , au nom defquels il rend alors (es ju–
gemens,
&
fe fert de leur (ceall. HeilI'.
hifl.
de
l'
em·
pire.
(G)
A
ULlQUE,
(Théolog.
)
110m qu'on donne
a
I'alle
Oll
a
la thefe qtle foutient un jeune (héologicn, dans
qtlelques univerntés,
&
pa¡ticulierement dans celle
de Paris, le jom qu'un. licentié en Théologie
re~oir
le bonnet de doéteur ,
&
a
laquelle prélide ce méme
licentié,immédiarementapres la récepuon du bonnet.
On nornme
ainíi
cet alle dn mor
aula,
falle, parce
qu'ü fe pa!fe dans tUle falle de l'univerlité
,&
a
Paris
dans une (alle de l'archev@ché.
Yoye{
UN1VERS1TÉ.
DEGRÉ, DOCTEUR ,
&c.
(G)
AU
LIT , Av LIT CHIENS
,'trme de Yemri"
dont on lIfe pOUT faire guetter les chiens lorfque
1
'on
veut lancer un ¡jeVTe.
AULNAIE
01t
AUNAIE,
f. f.
(Jardinage.
)
en
un lieu planté d'aulnes.
Yoye{
AVLNE.
(K)
AVL E, f. m.
alnus,
genre d'arbre
~ui
porte des
chatons compofés de fleurs
a
plllfienrs etamines
quí
s'élevent d'un calice fait de quatre ¡ieces. Ces ileurs
font ramaíf'ées en peloton
&
artachees
a
un
axe ; elles
font /1ériles. Le fmit fe trouve féparément des cha–
(ons; il e/1 compoCé d'écailles
&
rempli d'embryons
dans le commencement de fon accroilI'emcnt. Dans
la fllite
il
devient plus gros,
&
alors
jj
ren!crmc de
[emences, qui pouJ' l'ordinaire (ont applatles. Tour–
nefort,
Injl. rti herb. Yoye{
PU.:\"TE.
(1)
n
vienr de boutures
&
de ¡narcotte; il aime les
marécages
















