
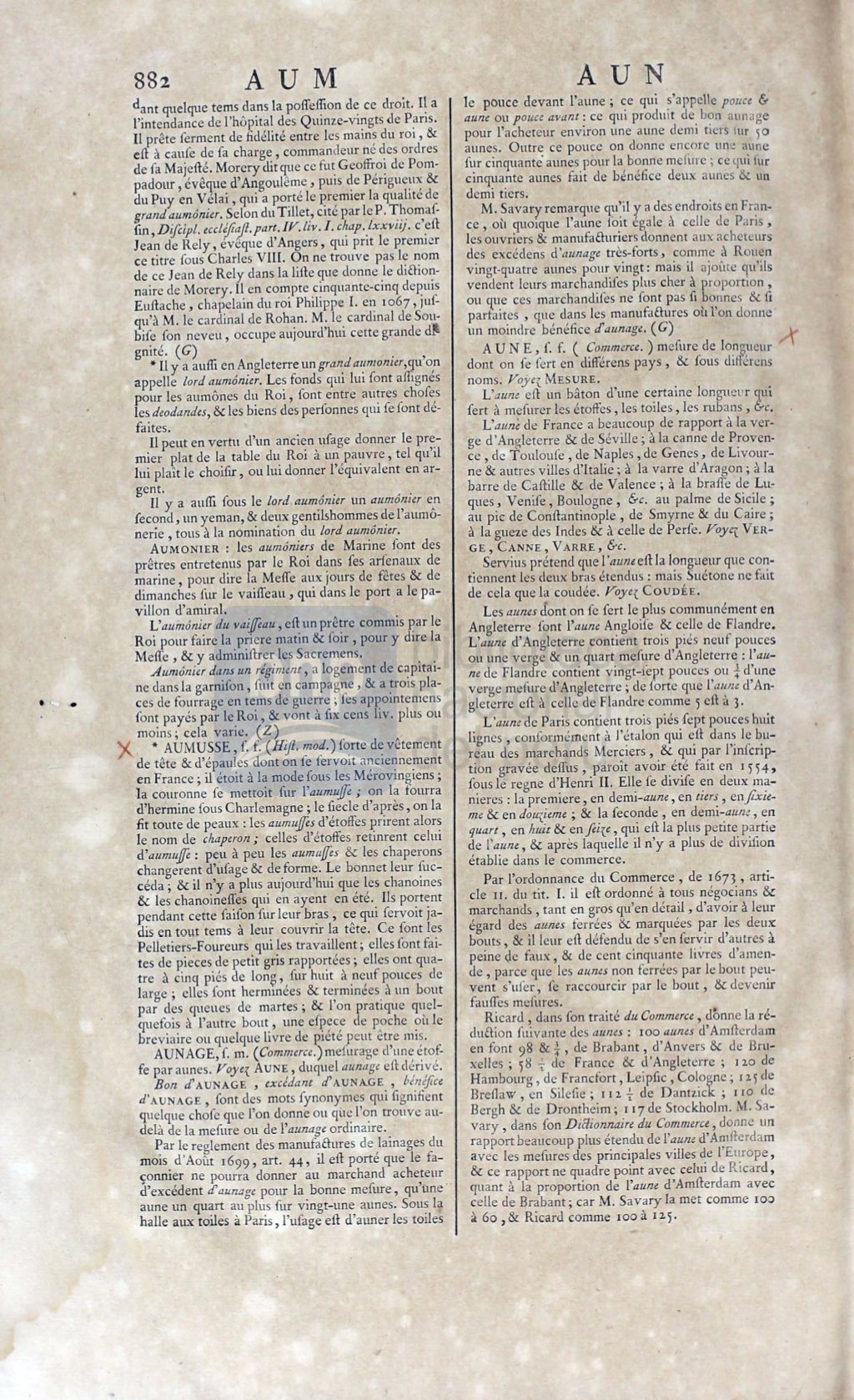
882
AUM
dant quelque tems dans la poífeffion de ce droit. II a
j'intendance de l'hopital des Quinze-vingts de Paris.
Il prete ferment de fidélité entre les mains du roi ,
&
efr a caufe de fa charge, commandeur né des ordres
de fa Majeíl:é.
Morerydit~lIe
ce fut Geoffroi de Pom–
padour ,
éve~ue
d'Angouleme, puis de Périgueux
&
du Puy en Ve!ai , qui a porté le premier la qualité de
crandaumonier.
Selon du Tillet, ciré par leP.Thomaf–
fm,Difcipl. ecc''It.part.lV.liv.l. chap.lxxviij.
c'eíl
Jean de Re!y, eveque d'Angers, qui prit le premier
ce titre fous Charles VIII. On ne trouve pas le nom
de ce Jean de Rely dans la Iiíl:e que donne le difrion–
naire de Morery. II en compre cinquante-cinq depuis
Euílache, chapeIain du roi Philippe 1. en 1067, juf–
qu'a M. le cardinal de Rohan. M. le cardinal de
S~u
bife fon neveu, occupe aujourd'hui cette grande d,
gnité.
(G)
*
II ya auíli en Angleterre un
grand aumonier,qu'on
appelle
lord aumonier.
Les fonds qui lui font affignés
pour les aumones dn Roi, font entre autres chofes
les
deodandes,
&
les biens des perfonnes qui fe font dé–
faites.
II pent en verttl d'un ancien ufage donner le pre–
mier plat de la table du Roi
a
un pauvre, tel qu'il
lui plalt le choifir, onlui donner l'équivalent en ar–
gent.
11 y a auíli fous le
lord.aumonier
un
aumonier
en
fecond, un yeman,
&
deux gentilshommes de I'aumo–
nerie , tons a la nomination du
lord allmonier.
AUMONIER : les
allmoniers
de Marine font des
pretres entretenus par le Roi dans fes arfenaux de
marine, pour dire la Meífe aux jours de fetes
&
de
dimanches fur le vailreau , qui dans le port a le pa–
villon d'amiral.
l'
aumonier du vaiffeau,
eíl: un pretre commis par le
Roi pour faire la priere matin
&
foir , pour y dire la
Meífe ,
&
Yadrnlnillrer les Sacremens.
Aumonier dans un régiment
,
a logement de capitai–
ne dans la garnifon , fuit en campagne,
&
a trois pla–
ces de fourrage en tems de guerre ; fes appointemens
font payés par le Roi,
&
vont
a
fix cens liv. plus OL!
moins; cela varie.
(Z)
><
*
AUMUSSE,
f.
f.
CHifl.
mod.)
forte devetement
de tete
&
d'épaules dont on fe fervoit anciennement
en France ;
iI
étoit
a
la mode fous les Mérovingiens ;
la couronne fe mettoit (ur
l'aumuf!e;
on la tourra
d'hermine [ous Charlemagne ; le fieele d'apres, on la
fit tollte de peaux : les
aumuf!es
d'étoffes prirent alors
le nom de
c!zaperon;
celles d'étoffes retinrent celui
d'aumuf!e:
pe.u a peL! les
aumflf!es
&
les chaperons
changerent d'ufage
&
de forme. Le bonnet leur (uc–
céda;
&
iI
n'y a plus aujourd'hui que les chanoines
&
les chanoineífes qui en ayent en été. Ils portem
pendant cette [aifon [ur leur bras, ce qui fervoit ja–
dis en tout tems a lem couvrir la tete. Ce (ont les
Pelletiers-Foureurs qui les travaillent; elles font fai–
tes de pieces de petit gris rapportées; elles ont qua–
tre a cinq piés de
lon~,
fur huit a neuf pouces de
large ; elles lont hernunées
&
terminées
a
un bout
par des queues de martes;
&
l'on pratique quel–
c¡uefois a l'autre bout, une eepece de poche ollle
breviaire ou que!que livre de piété peut etre mis.
AUNAGE,f. m.
(Commerce.)
me[urage d'une étof–
fe par aunes.
Voye'{
AUNE, duque!
allnage
eíl: dérivé.
Eon
d'
AUNAGE ,
excédant
d'
AUNAGE ,
bénéjice
d'AUNAGE, font des mots (ynonymes qui fignifient
quelque chofe que I'on donne ou que l'on trouve au–
dela de la mefme ou de l'
azmage
orrunaire.
Par le reglement des manufafrures de lainages du
mois d'Aollt 1699, arto 44,
il
eíl: porté que le fa–
¡;onnier ne pourra donner au marchand acheteur
d'excédem
d'
aunage
pour la bonne me[ure, qu'une '
aune un quart au plus fur vingt-une aunes. Sous la
halle aux toiles
a
Paris , l'ufage eíl d'almer les toiles
AUN
le ponce devant I'aune; ce qui s'appelle
pOTlee
&
aune
ou
pOllce avant
:
ce qui produit de bon aunage
pour l'acheteur environ une aune demi ticrs tur 50
aunes. Outre ce pouce on donne encore une aune
fur cinquante' aunes pour la bonne mefme; ce qui {ur
cinquante aunes fait de bénéfiee deux aunes
&
un
demi tiers.
M. Savary remarque qu'il ya des endroits en Fran–
ce , 011 quoique l'aune (oit égale
a
celle de Paris,
les ouvriers
&
manufafruriers donnent aux acheteurs
des excédens
d'aunage
tres-forts, comme
a
Rouen
vingt-quatre aunes pour vingt: mais il ajourc qu'ils
vendent leurs marchandifes plus cher a proportion ,
ou que ces marchandifes ne font pas
íi
bonnes
&
li
parfaites ,
q.uedans les manufafruTes ol¡ \'on donne
un moindre bénéfiee
d'
flunage. (G)
A U N E
I
f.
f. (
Commerce.)
merure de longueur
dont on fe fert en différens pays,
&
fous diffl rens
noms.
Voye'{
MESURE.
L'aune
eíl un baton d'une eertaine 10nguel1r qui
{ert a mefurer les éto!l:es, les toiles , les rubans ,
&c.
L'aune
de France a beaucoup de rapport
a
la ver–
ge d'Angleterre
&
de Séville;
a
la canne de Proven–
ce, de Touloufe, de Naples, de Genes, de Livour–
ne
&
mItres villes d'{talie; a la varre d'Aragon;
¡'¡
la
barre de Caílille
&
de Valence ;
a
la bralre de Lu–
ques , Venife, Boulogne,
&c.
au palme de Sicile ;
au pie de Confl:antinople , de Smyrne
&
du Caire;
a la gueze des Indes
&
a celle de Perfe.
Voyt'{
VER–
GE, CANNE, VARRE,
&c.
, Servius prétend que
I'auneefr
la 10nguenT que con–
tiennent les denx bras érendus : mais Suétone ne fait
de cela que la coudée.
Voye'{
COUDÉE.
Les
aunes
dont on fe [ert le plus communément en
Angleterre font l'
aune
Angloife
&
celle de Flandre.
1'azllle
d'Angleterre 'Contient trois pies neuf pouces
ou une verge
&
un quart mefure d'Angleterre :
l'au–
ne
de Flandre conrient vingt-fept pouces ou
t
d'une
verge me[ure d'Angleterre; de forte que
l'aulle
d'An–
gleterre eíl:
a
celle de Flandre comme 5eíl:
a
3.
L
'aune
de Paris conrient trois piés fept pouces hlút
lignes , conformément
a
J'étalon qui efl: dans le bu–
reau des marcbands Merciers,
&
qui par l'infcrip–
tion gravée delrus, parolt avoir été fait en 1554,
{OllS le regne d'Henri
n.
Elle fe divife en dellx ma–
nieres : la premiere , en de
mi-aune
,
en
tiers
,
enlLXie–
me
&
en
dou{ieme
;
&
la feconde , en demi-azme, en
'luart
,
en
futit
&
en
fli'{o,
qui eíl: la plus perite partie
de
l'aune ,
&
apres laquelle
iI
n'y a plus de diviíion
établie dans le commerce.
Par l'ordonnance dn Commerce, de 1673 , arti–
ele
II.
du tito
1.
iI
efr ordonné
a
tons négocians
&
marchands , tant en gros qu'en dérail , d'avoir a leur
égard des
aunes
ferrées
&
marquées par les deux
bOllts,
&
illeur eíl défendu de s'en fervir d'aurres
a
peine de faux,
&
de cent cinquante livres d'amen–
de, paree que les
aunes
non ferrées par le bout peu–
vent s'u[er, {e raccourcir par le bout,
&
devenir
fauífes me{ures.
Ricard , dans Con traité
du Commerce
,
dónne la ré–
duéEon (uivante des
aunes:
100
aunes
d'Amíl:erdam
en fom 98 &
t,
de Brabant, d'Anvers
&
de Bru–
xelles; 58
~
de France
&
d'Angleterre; 120 de
Hambourg , de Francfort, Leipíic, Cologne; 125 de
Breflaw , en Silefie; 112
+
de D aOlzick ;
I
ro de
Bergh
&
de Drontbeim; 117 de Stockholm. M. Sa–
vary, dans Con
Diaionnaire du Commerce,
donne un
rapport beaucoup plus étendu de
I'aune
d'Amll:erdam
avec les mefures des principales villes de l'Europe ,
&
ce rapport ne quadre point avec celui de Ricard ,
quant
a
la proportion de
l'aune
d'Amíl:erdam avec
celle de Brabant; car M. Savary la met comme 100
a
60 , & Ricard comme
100
a
125.
















