
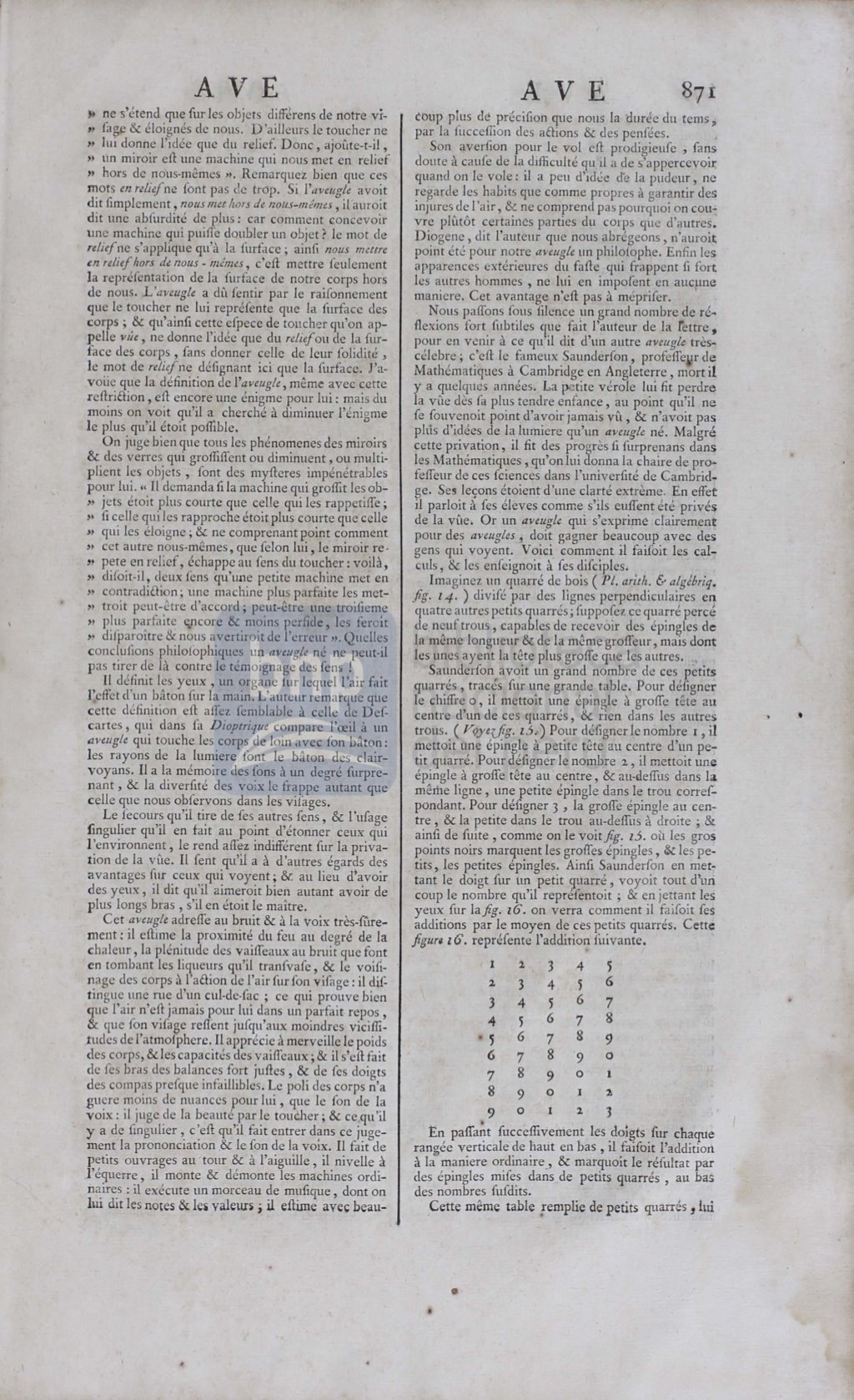
AVE
~
ne s'étend que fur les objets diffJrens de notre vi–
" [age
&
éloignés de nous. D'ail1eurs le toucher ne
" lui donne l'idée que du relief. Donc, ajollte-t-il ,
" un miroir ea une machine qui nous met en relief
" hors de nous·memes ". Remarquez bien que ces
mots
en rdiif
ne (ont pas de trOpo Si
l'aymgle
avoir
dit fimplement,
nOll5 mee l,or5
dt
notlS-lIIéme5,
ilauroir
dir une ab(urdité de plus; car commenr c;oncevoir
une machine qui puiiTe doubler un objet? le mot de
relief
ne s'applique qu'a la furface; ainfi
nOlls meure
~n
rdief
hors
dt
nollS
-
mémes,
c'ea mettre (eulemenr
la repré(cntation de la furface de notre corps hors
de nouS.
L'aywgle
a dil (entir par le rai(onnemenr
que le roucher ne lui repréfenre que la furface des
corps ;
&
qu'ainÍl cette e(pece de tOllcher qu'on ap–
pelle
Vlte,
ne donne l'idée que du
reliefou
de la fm–
face des corps , (ans donner celle de leur folidité ,
le mot de
relief
ne délignant ici que la (urface. J'a–
voiie que la délinition de l'
avellgle,
meme avec cctte
reariaion ,
ea
encore une énigme pOUl' lui ; mais du
moins on voit qu'il a cherché a diminuer l'énigme
le plus qu'il étoit poílible.
On juge bien que tous les phénomenes des miroirs
&
des verres qui grolTiiTent ou diminuent, ou multi–
plient les objets, (ont des myfreres impénétrables
pour lui. " Il demanda
ÍI
la machine qui grolTit les ob–
" jets étoit plus courte que celle qui les rappetiiTe ;
,. ÍI
celle qui les rapproche étoit plus courte que ,elle
" qui les éloigne; & ne comprenant point
comm~nt
" cet autre nous-memes, que (elon lui, le miroir re·
" pete en relief, échappe au (ens du toucher : voilil,
" di(oit-il , deux [ens qu'une petite machine met en
" con'tradiaion; une machine plus parfaite les met–
" troit peut-etre d'accord; peut-etre une troiiieme
" plus parfalte
~ncore
& moins perlide, les feroit
" di(paroltre
&
nous avertiroit de l'errem
1/.
Quelles
concluÍlons philofophiques un
aveugle
né ne peut.i!
pas tirer de
la
contre le témoignage des (ens
!
11 délinit les yeux , un organe tur lequell'air fait
I'effet d'un baton (ur la main. L'auteur remarque qüe
cette délinition efr aiTez (emblable
a
celle de De(–
cartes, qui dans (a
D iop1ri'llle
compare l'ceil a un
averrgle
qui touche les corps de loin avec (on bihon;
les rayons de la lumiere (om le baton des clair–
voyans. Il a la mémoire des fons
a
un degré (urpre–
nant,
&
la diverÍlté des voix le frappe autant que
celle que nous ob(ervons dans les vifages.
Le JecOLUS qu'il tire de [es autres [ens,
&
1 'ufage
fingulier qu'il en fait au point d'étonner ceux qui
l'environnent , le rend alfez indifférent [ur la priva–
tion de la vLle. 11 (ent qu'il a
a
d'autres égards des
avantages (m ceux qui voyent;
&
au lieu dlavoir
des yeux, il dit qu'il aimeroit bien autant avoir de
lJlus longs bras , s'i! en étoit le maltre.
Cet
aveugle
adrelfe au bmit & a la voix tres-fCue–
ment; il efrime la proximité du feu au degré de la
chaleur, la plénitude des vai1I'eaux au bruit que font
en tombant les liqueurs qu'il tran(va(e, & le voiÍl–
nage des corps
a
l'aaion de l'air fur [on vifuge; il dir–
ringue une me d'un cul-de·[ac ; ce qui prouve bien
que l'air n'efr jamais pour lui dans un parfair repos ,
&
que fon vi[age
rem~nt
ju(qu'aux moindres vicilTi–
tudes de l'atmo(phere. Il apprécie
a
merveille le poids
des corps, &les capacités des vaiiTeaux;
&
il
s'ea
fait
de [es bras des balances fort juíl:es, & de (es doigts
des compas pre(que infaillibles. Le poli des corps n'a
guere moins de nuances pour ltú , que le (on de la
voix ; il juge de la beauté par le toucher;
&
ce qu'il
ya de /ingulier, c'eíl: qu'il fair eotrer dans ce juge–
ment la prononciation & le (on de la voix. Il fait de
petits ouvrages au 'tour &
a
l'aiguille , il niveUe
a
l'équerre, il monte & démonte les machines ordi–
naires: ii exécute un morceau de mu/ique, dont on
luí dit les notes
&
le,
yale~U'~
;
il
efrime avee beau-
AVE
coup plus dé preciÍlon que nous la durée du tems,
par la (uccelTion des aaions & des pen(ées.
Son averfion pour le vol efr prodigieu[e , (ans
doute
a
cau(e de la difficulté qUll a de s'appercevoi,
C]uand on le vole : i! a peu d'idée
d'e
la pudeur, ne
regarde les habits que comme propres
a
garantir des
injures de 1 'air,
&
ne comprend pas pOl1l'C]lIoi on
cou~
vre pllltót certaincs parties du COI ps que d'autres.
Diogene, dit l'auteur que nous abrégeons, n'auroit
point été pour notre
aveugle
un philoíophe. Enfin les
apparences cxtérieures du fafre qui frappent
ÍI
fort
les autres hommes , ne lui en impo(ent en aucpne
maniere. Cet avantage n'efr pas
a
mépri(er.
Nous paiTons [ous (úence
~lJl
grand nombre de ré–
flexions fort (ubtiles que fait l'auteur de la rettre.
pour en venir
a
ce qu'il dit d'un autre
aveugle
tres–
célebre; c'eíl: le fameux Saunder(on,
profelfe~r
de
Mathématiques
a
Cambridge en Angleterre, mort il
y a quelques années. La petite vérole lui lit perdre
la vlle des (a plus tendre enfance, au point qu'il ne
(e (ouvenoit point d'avoir jamais VlI , & n'avoit pas
pltis d'idées de la lumiere qu'un
avellgle
né. Malgré
cette privation, il lit des progres
[¡
(urprenans dans
les Mathématiques ,qu'on lui donna la chaire de pro–
feiTeur de ces (eiences dans l'univerÍlté de Cambrid–
ge.
Ses
lecons étoient d'une clarté extreme. En effet
il parloit
~
(es éleves comJr.e s'ils euiTent été privés
de la vlle. 01' un
aveugle
qui s'exprime clairement
paur des
aveugles,
doit gagner beaucoup avec des
gens qui voyent. Voici comment il faifoit les cal–
culs, & les en(eignoit
a
(es di(ciples.
Imaginez un quarré de bois (
PI. aril".
&
algtbri'l'
fig.
14- )
divi(é par des lignes perpendiculaires en
quatre autres petits quarrés; (uppo(ez ce quarré percé
de neuf trous , capables de recevoir des épingles de
la meme longueur & de la m@me groiTeur , mais dont
les unes ayent la tete plus grolfe que les autres. _' .
Saunderfon avoit un grand nombre de ces petlts
quarrés , tracés (m une grande table. Pour dé/igner
le chiffre o, il mettoit une épingle
a
groiTe tete au
centre d'un de ces quarrés, & rien dans les autres
trous.
(V<Jye{fig.
¡j.)
Pour dé/igner le nombre
1 ,
iI
mettoit une épingle apetite t&te au centre d'un pe–
tit quarré. Pom dé/igner le nombre
2,
il mettoit une
épingle il groiTe tete au centre, & au-deiTus dans la
meme ligne, une petite épingle dans le trou eorre(–
pondant. Pour dé/igner 3 , la groiTe épingle aL! cen–
tre, & la perite dans le trou au-deiTus
a
droite ;
&
ain/i de (uite , comme on le voitfig.
¡j.
011
les gros
points noirs marquent les gro!fes épingles ,
&
les pe–
tits, les petites épingles. AinÍl Saunder[on en met–
tant le doiut (ur
(lJl
petit 9uarré, voyoit tout d'un
coup le
no~bre
qu'il repre(entoit ;
&
en jettant les
yeux (ur
lafig.
z6.
on yerra comment il fai(oit [es
additions par le moyen de ces petits quarrés. Cette
figllTi
z6.
repré(ente l'addition fiüvante.
4
)
2
4
)
6
4
5
6
7
4
5
6
7
&
. 5
6
7
8
9
6
7
8
9
o
7
8
9
o
8
9
o
9
o
1
2
En
paiTa~t
fucceffivement les do:gts
tUl'
chaqUe
rangée verticale de haut en bas , il fai[oit l'additior\
a
la maniere ordinaire., & marquoit le ré(ultat par
des épingles mires dans de petits quarrés , au has
des nombres (u(dits.
Cette meme table !emplie de petits quarrés; iui
•
















