
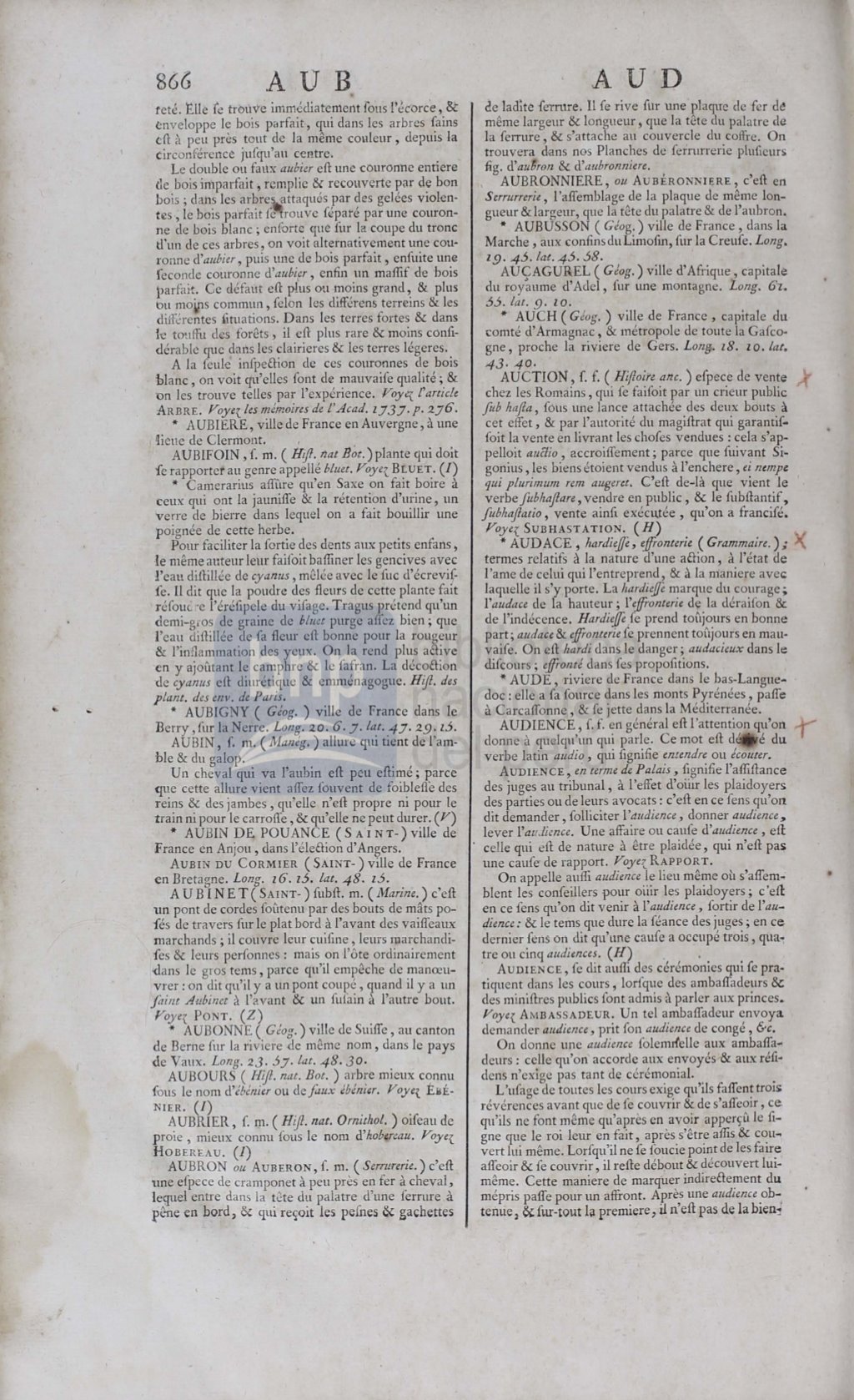
866
AUB
teté. rUe fe trbuve immédiatement fous
!'~éorce,
&
enveloppe le bois p¡,rfait, qui dans les arbres fains
ca
a
peu pres tout de la meme couleur, depuis la
circonfércllce jllfqu'au ceNtre.
Le double ou faHx
aubier
ea une cOuronne enriere
de bois imparfait , remplie
&
recouverte par de bon
bois ; dans les arbres
~ttaquós
par des gelées violen–
tes, le bois parfait fe frouvc f€paré par une couron–
ne de bois blanc ; enÍ'ortc que fur la coupe du tronc
tI'un de ces arbres, on voit alternatlvement une cou–
roilne
d'a"bier,
puis lme de bois parfait, enfuite une
feconde cOlll'onne d'
aubifr,
enfin un mallif de bois
parfait. Ce défaut eil: p!us ou moins gr·and, & plus
bu
mo~s
commun , felon les différens terreins & les
diíf¿rentes lituations. Dans les terres fortes
&
dans
le tO'.lffu d€s forets, il ea plus rare
&
moins confi–
dérable que dans les clairieres
&
les tcrres légeres.
A la feule inIpefrion de ces couronnes de bois
blanc, on voit qtl'elles font de mauvaife qtlalitó; &
tlll
les trouve teUes par I'expérience.
Voy¿¡: l'articü
ARBRE.
Voye{ les m'moires de t'Acad. z:J3:J. p. 2:J6.
*
AUBIERE, villede France en Auvergne,
a
une
qiel1e de Clermont.
.
AUBIFOIN,
f.
m. e
H1'.
J2at
E~t.)
plante qui doit
fe rapporter au genre appelIé
bLUel.
Voye{
BLUET.
(1)
*
Camerarius amlre qu'en Saxe on fait boire
a
ceux qui ont la jaunUre & la rétention d'mine, un
'Verre de bierre dans lequel on a fait bOllillir une
poignée de cette herbe.
Pour faciliter la fertie des dents ame petits enfans,
le meme
al~teur
leur faifoit balIiner les gencives avec
reau diftilIée de
cyanus,
melée avec le fuc d'écrevi(–
fe.
Il
dit que la poudre des fleurs de cetre plante fait
réfou¿ 'e l'éréfipele du vifage. Tragus prétend qu'un
demi-gros de graine de
bluet
purge aITez bien; que
l'eau diíl:illée de fa flem ea bonne pour la rougeur
& l'in!lammation des yeux. On la rend plus afrive
en yajolltant le camphre
&
le fafran. La décoélion
-de
cyanus
eíl: diurétique & emménagogue.
Hij!. des
planto des env. de Paris.
*
AUBIGNY e
Géog.
)
ville de France dans le
Berry ,fur la Nerre.
Long.
20.
6.
:J.lal. 4:J.
29.
d.
AUBIN, f. m. e
Manég.)
allure qui tient de l'am–
ble
&
du galopo
Un cheval qui va l'aubÍn eíl: peu efi:imé; parce
<¡ue cette allure vient aITez fouvent de foiblefle des
reins
&
des jambes ,qu'elle n'eíl propre ni pour le
train ni pour le carrofl'e
,&
qu'eUe ne peut durer. eV)
*
AUBIN DE POUANCE eSAINT-)ville de
France en Anjou, dans l'élcaion d'Angers.
AUBIN DU CORMIER e SAINT- ) ville de France
en Bretagne.
Long. 16. z.s. lat.48.
d_
A
U B I
N
E T e SAINT- ) fubíl:. m. e
Marine.
)
c'eíl:
1m
pont de cordes fOlltenu par des bOllts de mats po–
fés de travers fur le plat bord a l'avant des vaiITeaux
marchands; il couvre leur cuifine , leurs rnarchandi–
fes
&
leurs perfonnes: mais on l'ote ordinairement
<dans le gros tems , parce qu'il empeche de manceu–
vrer : on dit qu'il ya un pont coupé, quand il y a un
foint A"binec
a l'avant
&
un (urain
a
l'autre bout.
Voye{
PONTo eZ)
*
A
UBONNE e
Geog.
)
ville de Suiífe, au canton
de Berne fur la riviere <le meme nom, dans le pays
de Vaux.
Long.
23 .
.s:J.lat,
48. 30.
AUBOURS (
Hij!. nato Bot.
)
arbre mieux connu
fous le nom
d'¡]bénier
ou
defoux ¿bénier. Voye{
ÉIIÉ–
NIER.
(1)
AUBRlER, f. m. e
Hij!. nato Ornithol.)
oifeau de
proie , mieux connu fous le nom
d'¡'obereart. Voye{
HOBEREAU.
(1)
AUBRON
ou
AUBERON,
f.
m. e
Sermrerie.)
c'eíl:
tlne efp ce de cramponet
a
peu pres en fer
a
cheval,
lequel entre dans la tete du palatre d'une íerrure
a
l'ene
en bord,
&
'lui resoit les pe(nes
&
ga~hettes
AUD
de ladite {e:rntre.
II
fe rive fur une plaque de fer dI!
m~me
largeur
&
longlleur, que la tete du palatre de
la femlre,
&
s'attache au couvercle du coffre. On
trouvera dans nGS Planches de fermrrerie plllfieurs
fig.
d'au!Jron
&
d'aubronniere.
AUBRONNIERE,
ou
AUBÉRONNIERE, c'ea en
Strrurrerie,
l'aR'emblage de la plaque de
m~me
lon–
gueur &largenr, que la tete du palatre & de l'aubron.
*
AUBUSSON (
Géog.)
ville de France , dans la
Marche, aux confinsduLimoflll, fur la Creufe.
Long.
z9·
4.s. lal. 4.s . .58.
AUCAGUREL e
Geog.)
ville d'Afrique, capitale
du royilllme d'Adel, fur lme montagne.
Long.
61.
.s.s. lato
9.10.
*
AUCH e
Géog.
)
ville de France , capitale du
comté d'Armagnac, & métropole de tollte la Gafco–
gne, proche la riviere de Gers.
Long.
z8.
10.
lato
43· 40.
AUCTION, f. f. (
Hifloire anc.)
efpece de vente
chez les Romains , qui fe faifoit par un crieur pubJie
jitb hajla,
fóus une lance attachée des deux bOlltS
¡\
cet effet, & par ¡'autorité du magillrat qui garantir.
foit la vente en livrant les chofes vendues : cela s'ap–
pelloit
au8io,
accroilTement; parce que fuivant Si–
gonius, les biens étoient vendus
a
l'enchere,
el
nempe
'lui plurimum rem augere&.
C'eíl: de-la que vient le
verbe
Jublzajlare,
vendre en public,
&
le fubíl:antif,
jitbluzjlatio,
vente ainfi exécutée , qu'on a francifé.
roye{
SUBHASTATION. eH)
*
AUDACE,
hardieffi, iffromerie
e
Gramma;re.);
termes relatifs a la nature d'tille aélion,
a
l'état de
l'ame de celui qui l'entreprend, &
a
la maniere avec:
laquelle jI s'y porte. La
hardie.ffi
marque du courage;
l'audace
de la hauteur;
l'eflTonterie
de la d¿raifon
&
de l'indécence.
Hardie.ffi
re
prend tOlljours en bonne
part;
audace
&
iffronurie
te prennent tofljours en mall–
vaue. On ea
Izardi
dans le danger ;
audacieu:r:
dans le
difcours;
effromé
dans fes propoútions.
*
AUDE, riviere de France dans le has-Langue.
doc : elle a (a (ource dans les monts Pyrénées , paITe
a
CarcaITonne , & fe jette dans la Méditerranée.
AUDIENCE,
f.
f. en général eíl: l'attention qu'on
í
donne
a
quel'lu'un qui parle. Ce mot eíl: d' é du
verbe latin
audio,
qui fignifie
entendre
ou
écolUfr_
AUDlENCE,
en terme de Palais,
fignifie l'alIiftance
des juges au tribunal,
a
l'effet d'oÜ1r les plaidoyers
des parties ou de leurs avocats : c'eíl: en ce fens qu'on
dit demander , folliciter
1
'dudience,
donner
audience,
lever
l'all./ience.
Une affaire ou caufe
d'audience,
eíl::
ceHe qui eíl: de nature
a
etre plaidée, qui n'eíl: pas:
une cauié de rapport.
Voye{
RAPPORT.
On appelle aulIi
audience
le lieu meme Oll s'aR'em–
blent les confeillers pOtLr oiiir les plaidoyers; e'eíl:
en ce {ens qu'on dit venir a
l'audience,
fortir de
l'au–
dienee:
&
le tems que dure la féance des juges ; en ce
dernier fens on dit qu'une caufe a occupé trois , qua-
tre ou cinq
audiences. (H)
.
.
. AUDlENCE, fe dit aulIi des eérémonies qui fe pra–
tiquent dans les cours, lorfque des ambaITadeurs
&
des miniíl:res publics font admis
a
parler aux princes.
Voye{
AMBASSADEUR. Un tel ambaITadeur envoya
demander
audience,
prjt fon
audience
de congé ,
&c.
On donne une
audience
(olem~lle
aux amba{[a–
deurs: celIe qu'on accorde aux envoyés & alLX réfi–
dens n'exige pas tant de cérémoniaJ.
L 'u(age de toutes les cours exige qu'ils faITent trois
révérences avant que de fe couvrir & de s'aITeoir, ce.
qu'ils ne font meme qu'apres en avoir
apper~u
le fi–
gne que le roi leur en fait, apres s'etre aflis
&
COll_
vertlui meme. Lorfqu'il ne fe {oucje pointde les faire
a/feoir
&
fe couvrir ,
il
reíl:e débout
&
découvert luj–
meme. Cette maniere de marquer indirefrement du
mépris paITe pour un alfront. Apres une
alldience ob–
tenue,
&
ÚII-tout
la
premiere,
il
n'eíl: pas de la bienj
















