
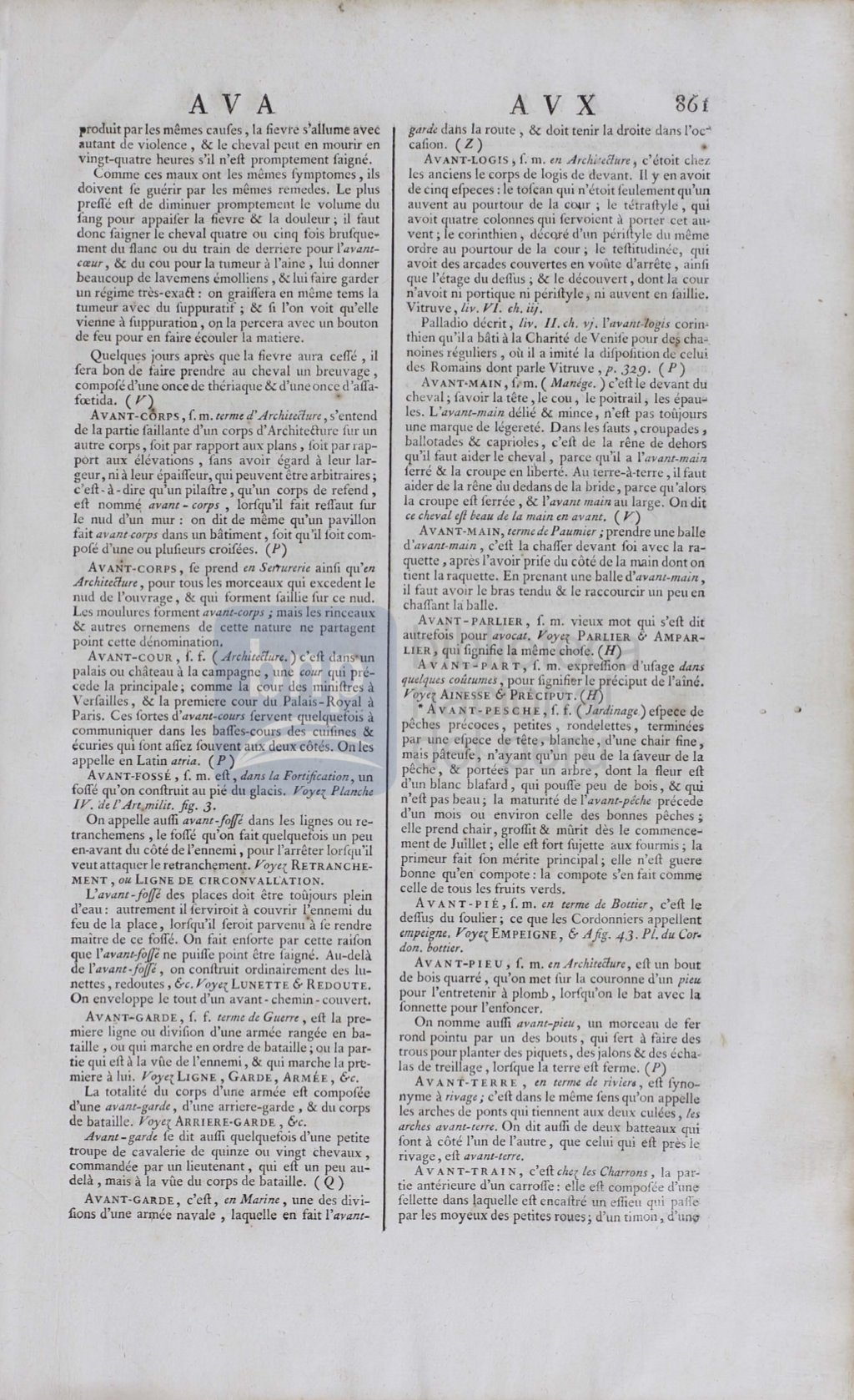
AVA
produit par les memes caufes , la fiev/"e
s~allume
avec
lIutant de violence,
&
le cheval peut en mourir en
vingt-quatre heures s'il n'el!: promptement úligné.
Comme ces maux ont les memes fyl11ptomes, ils
doivent fe guérir par les l11el11es remedes. Le plus
prell'é el!: de diminuer promptement le volume du
fang pour appaifer la nevre
&
la douleur; ü faut
clone faigner le cheval quatre ou cinq fois brufque.
nlent du flanc ou du train de derrien:: pour
l'avam–
clZur,
&
du cou pour la tumeur
a
l'aine, lui donner
beaucoup de lavemens émoIliens ,
&
lui faire garder
un régime rres-exaél:: on grailfera en meme tems la
tumeur avec du fuppuratif;
&
íi I'on voit ql.l'eIle
vienne
¡\
fuppurarion , on la pcrcera avec un bouton
de feu pour en faire écouler la matiere.
Quelqu~s
jours apres que la fievre aura celfé , il
{era bon de faire prendre au cheval un breuvage ,
compofé d'une once de thériac¡ue
&
d'une once d 'alfa-
fretida.
(V)
.
AVANT-CORPS,
f.
m.
temu d'Arehiuél!1re,
s'entend
de la partie faiIlante d'un corps d'Architeél:ure fur un
alare corps, Coit par rapport aux plans, foit par rap–
port aux élévations , fans avoir égard a lem lar–
geur, ni a leur épailfeur, qui peuvent etre arbitraires;
c'el!:· a -dire qu'un püafue, qu'un corps de refend ,
el!:
nomm~
avam
-
eorps
,
lorfqu'il fait relraur fur
le nud d'un mur: on dit de meme qu'un pavi110n
fait
avam·corps
dans un baIÍment , foit qu 'il 10ir com–
poCé d'une ou pluíieurs croifées.
(P)
AVANT-CORPS, fe prend
en
Serrurerie
ainíi (Iu'en
Arehiteaure,
pour tous les morceaux qui excedent le
nud de I'ouvrage,
&
qui formenr faillie fur ce nudo
Les moulures forment
avant-eorps
;
mais les rinceaux
&
autres ornemens de cetre nature ne partagent
point cette dénomination.
AVANT-COUR,
C.
f.
(Arehiteaure.)
c'el!: danS'un
palais ou chateau
a
la campagne , une
eour
qui pré–
cede la principale; comme la cour des miniíl:res a
VerCailles,
&
la premiere cour du Palais- Royal a
Paris. Ces fortes
d'avant-eours
fervent quelquefois a
communiquer dans les balfes-cours des cuiíines
&
écuries qui font alfez fouvent aux deux cotés. On les
appelle en Latin
atria. (P)
AVANT-FOSSÉ, f. m. el!:,
dans la Fortijication,
un
folfé qu'on conl!:ruit au pié du glacis.
Voye{ Planche
IV.
"del'Art.milit. fig.
3.
On appelle auffi
avam-fofF
dans les
li~nes
ou re–
tranchemens , le folfé qu'on fait quelquefois un peu
en-avant du coté de I'ennemi, pom I'arreter lorfqu'il
vemattaquer le retranchement.
.voye{
RETRANCHE–
MENT,
ou
LIGNE DE CIRCONVALL'ATlON.
L'avant-fofF
des places doit etre tOtljours plein
d'eau: autrement il Cerviroit a couvrir l'ennemi du
feu de la place, lorfqu'il feroit parvenu"a Ce rendre
maitre de ce folfé. On fait enCorte par cette raifon
que
l'avant-fofF
ne puj{fe point etre (aigné. Au-dela
de
l'avant-fofF,
on conftmit ordinairement des lu–
nettes, redoutes,
&c.
Voy~{LuNETTE
&
REDOUTE.
On enveloppe le tout d'un avant- chemin - couvert.
AVANT~GARDE,
f.
f.
terllledeGuerre,
ea la pre–
miere ligne Ol! diviíiOfl d'une armée rangée en ba–
taille , ou qui marche en ordre de bataiIle; ou la par–
tie qui eíl:
¡\
la vlle de l'ennemi,
&
qui marche la pre–
miere
a
lui.
.vcrye{
LIGNE , GARDE, ARMÉE,
&e.
La totalité du corps d'une armée el!: eompo(ee
d'une
avant-garde,
d'une arriere-garde ,
&
du corps
de bataille. Voye{ARRIERE-GARDE,
&c.
Avant-garde
Ce dit auffi quelquefois d'une petite
troupe de cavalerie de quinze ou vingt chevaux,
eommandée par un lieutenant, qui el!: un peu au–
dela , mais
a
la vue du corps de bataiIle.
(Q)
AVANT-GARDE, c'el!:,
en Marine ,
une des divi–
f¡ons d'une an,née navale , laqucJIe en fait
I'avant-
AVX
861
garde
dahs la roure ,
&
doit tenir la rlroite dans I'oc'"
caíion.
(Z)
.
AVANT-LOGIS
¡
C.
m.
m Arehi'eaure,
c'étoit chez
les anciens le corps de logís de devant. Il
y
en avoit
de cinq efpeees: le tofean quí n'étoit feulement qu'un
auvent au pourtom de la
a04lr
;
le tétraíl:yle, quÍ
avoit c¡uatre colonncs 'luí Cervoicnt
a
porter cet al!–
vent; le eorinthien, décQré d'un péril!:yle dl! meme
ordre au pourtour de la eour; le tefiitudinéc, 'lui
avoit des arcades couvertes en voí'tte d'arrete, ainfi
que l'étage du delfus ;
&
le découvert, dont la eour
n'avoit ni portique ni périíl:yle, ni auvent en faillie"
Vitruve,
liv. Vl. ch. iij.
PaIladio décrit,
liv. l/. ch.
vj.
l'avalll-logis
eorin–
thien qu'il a batí a la Charité de Venite pour
de~
eha–
noines reguliers ,
O~I
il a imité la dif¡)ofitioll de ceIui
des Romains dont parle Vitruve
,p.
329.
(P)
AVANT'MAIN,
f.
m.
(Manége.)
c'el!:le devant du
eheval; Cavoir la tete, le cou, le poitrail, les épau-'
les.
L'avant-main
délié
&
mince, n'el!: pas
toí'tjours
une marque de légereté. Dans les fauts ,croupades ,
balIotades
&
capriole , c'eíl: de la rene de dehors
gu'il fam aider le cheval, paree c¡u'ü a
I'avant-main
lerré
&
la croupe en liberté. Au teITe-a-terre,
Ü
faut
aider de la rene du dedans de la bride, paree c¡u 'alors
la croupe el!: ferrée,
&
I'avant main
au large. On dit
ce
eheval
ejl
beau de la main en avant.
(V)
AVANT-MAIN,
cermede Paumier
;prendre uneballe
d'avallt-main,
c'eH la chalfer devant (oi avec la ra–
quette , apres I'avoir prife du coté de la m.ain dont on
tient la raquette. En prenant une baIle d'
avant-main,
il faut avoir le bras tendu
&
le raccourcir un peu en
chalfant la baIle.
AVANT-I'ARLIER,
f.
m. vieux mot c¡ui s'efi dit
autrefois pour
avoeat. roye{
PARLIER
&
AMPAR–
LIER, qui fignifie la meme chofe.
(H)
A v ANT - PAR T,
f.
m. expreffion d'uCage
dans
<juel'lues eoútumes
,
pour fignifiBr I:yrécipur de I'ainé.
Voye{
AINESSE
&
PRÉCIPUT.
(H)
*
Av ANT- PE
S
CHE,
f.
f. (
J
ardinage
)
eCpece 4e
peches précoces, petites, rondelettes , terminées
par une e(pece de tete, blanche, d'une chair fine,
mais pilteufe, n'ayant qu'un peu de la (aveur de la
peche,
&
portées par un arbre, dont la fleur eíl:
d'un blanc blafard, qui poulfe peu de bois,
&
qu,i
n'el!: pas beau; la maturité de
l'avant-pülze
précede
d'un mois Ol! environ celle des bonnes peches;
elle prend chair, groffit
&
mtlrit des le
commence~
ment de JuilIet; elle el!: fort fujette <tux fourmis; la
primeur fait fon mérite principal; elle n'el!: guere
bonne (¡u'en compote: la compote s'en fait comme
ceIle de tous les fmits verds.
AVAN T- PIÉ,
f.
m.
en terme de Bottier,
c'el!: le
delfus du foulier; ce que les Cordonniers appelIent
elllpeigne. roye{
EMPEIGNE,
&
Afig.
43.
PI. du Cor–
don. bottier.
Av ANT-P I EU,
f.
rn.
en Arehiteaure,
el!:
un bout
de bois quarré, qu'on met lllr la couronoe d'un
pieu
pour I'entretenir
a
plomb, lor(qu'on le bat avec la
fonnerte pour I'enfoncer.
On nomme auffi
avant-pieu,
ün
morceau de fer
rond poinul par un des bouts, qui Cert
a
faire des
trous pour planter des pic¡uets, des jalons
&
des écha.
las de treillage , lorfc¡ue la terre el!: ferme.
(P)
AVANT-TERRE,
en
terme de
rivier,
,
el!: Cyno–
nyme a
rivage;
c'efi dans le meme fens qu'on appelIe
les arches de ponts qui
~iennent
aux deux culées,
les
arehes avant-terre.
On dlt auffi de deux batteaux 'luí
font a coté I'un de l'autre, que celtú qui el!: pres le
rivage, eíl:
avallt-terre.
Av AN T-T RAI N, c'el!:
ehe{ les CllarrollS,
la par·
tie antérieure d'un carrolfe: elle eíl: compolce d'une
fellette dans laqllelIe el!: encaíl:ré un effieu qui paíl'e
par les moyeux des petites roues
j
d'un timon , d'un"
















