
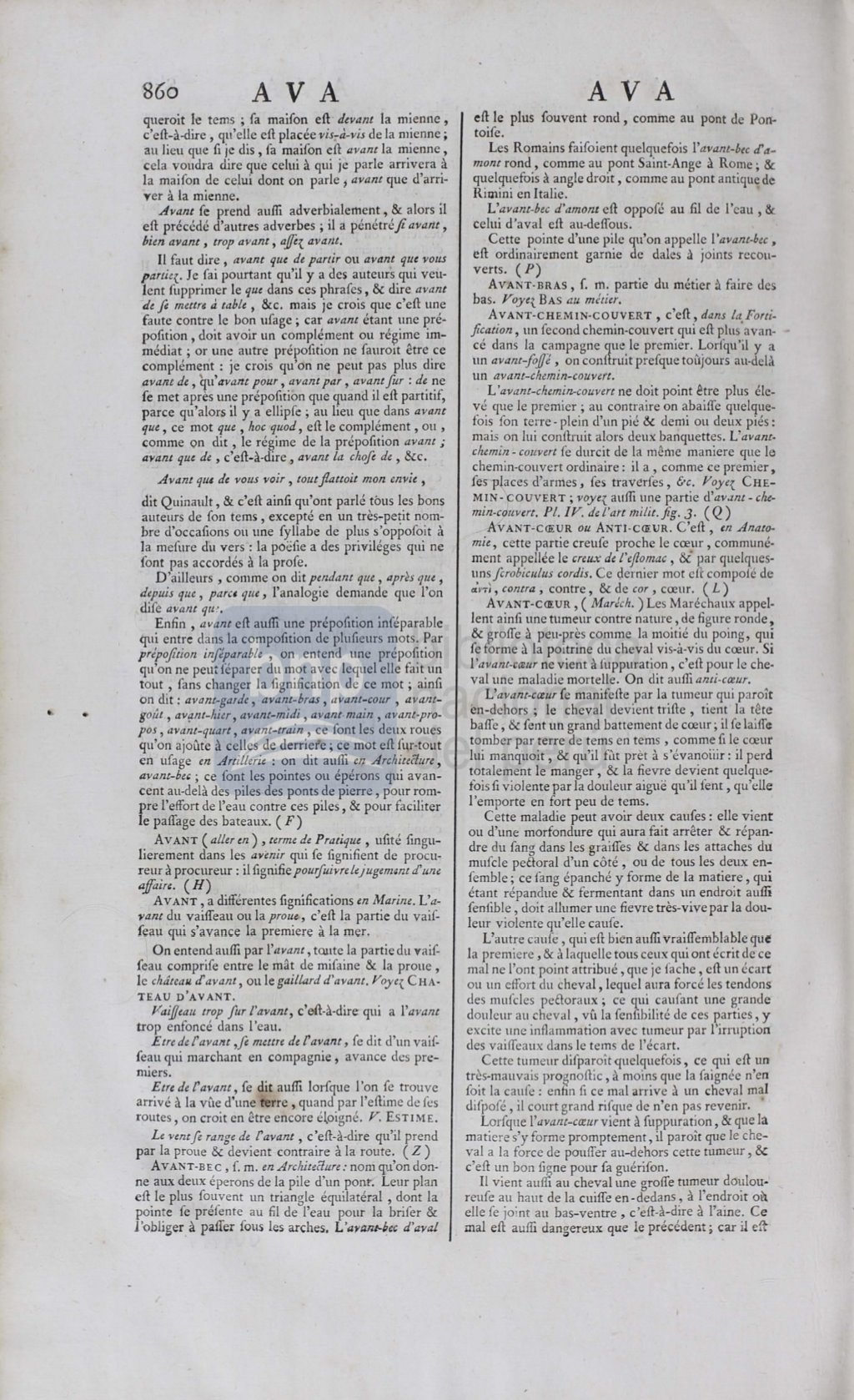
860
AVA
queroit le tems ; fa maifon efi
tÚvant
la mjenne,
c'efi-a-dire, qu'elle efi plaeéevis-ti-vis de la mienne;
au lieu que fi je rus , fa maifon efi
avane
la mienne,
cela voudra ru!e que ce!ui a qui je parle arrivera a
la maifon de eeluí dont on parle
j
allane
que d'arri–
yer a la mienne.
Avant
fe prend auffi adverbialement,
&
alors jI
efi préeédé d'autres adverbes ; il a pénétré
fl
allant ,
bien allant
,
trop allant
,
alfo{ avallt.
11
faut rure,
avant que de partir
OU
allane que 1I0lLS
panie{.
le fai pourtant qu'il ya des auteurs qui veu–
lent fupprimer le
que
dans ees phrafes ,
&
dire
avant
de ft mettre
ti
tabte,
&e.
mais je erois que c'efi une
faute contre le bon ufage ; car
avant
étant une pré–
pofition , doit avoir un complément ou régime im–
médiat ; or une autre prépofition ne faurolt etre ce
complément : je erois qu'on ne peut pas plus rure
avant de
,
qu'
avant pour
,
allant par, avantfur
:
de
ne
fe met apres une prépofition que quand il efi partitif,
paree qu'alors il y a ellipfe; aulieu que dans
allant
'lue,
ce mot
que, hoc quod,
efi le complément , ou ,
comme on rut, le régime de la prépofition
avant ;
ayant que de,
e'efi-a-dire,
allant la chafo de,
&c.
AlIant qUI de 1I0ILS 1I0ir
,
toutflattoit mon cnllie ,
dit Quinault ,
&
c'efi ainú qu'ont parlé tbus les bons
aureurs de fon tems , excepté en un tres-petit nom–
bre d'occafions ou une fyllabe de plus s'oppofoit
a
la mefure du vers : la poefie a des priviléges qui ne
font pas aeeordés a la profe.
D'ailleurs , comme on dit
pendant que, I1pres qm ,
depuis que, paree
'Irte,
l'analogie demande que I'on
dife
avant qU!.
Enfin ,
avant
efi auffi une prépofition inCéparable
qui entre dans la compofition de plufieurs mots. Par
prépojition infJparable
,
on entend une prépofition
<¡u'on ne peut féparer du mot avec leque! elle fait un
tout , fans changer la fignification de ce mot ; ainfi
on dit :
avant-garde, avant-bras, avant-cour
,
avant–
gont, allflnt-hitr, avant-mldi
,
allant.main
,
avant-pro–
pos, allant-quart
,
allant-train
,
ce font les deux roues
qu'on ajoute a cenes de derrieie; ce mot efi fm-tout
en ufage
en Artillerie
:
on dit auffi
en ArchiuClure,
avant-bu;
ce font les pointes ou épérons qui avan–
cent au-dela des piles des ponts de pierre , pour rom–
pre l'eIFort de I'eau contre ces piles,
&
pour faciliter
le palfage des bateaux.
(F)
. AvANT (
alIer en
) ,
arme de Pratique
,
ufité fingu–
herement dans les
ayénir
qui fe fignifient de procu–
reur a procureur : il figrufie
pourfuillrelejugemmt d'une
affaire.
(H)
AVANT, a ruIFérentes úgnílications
en
Marine. L'a–
yant
du vailfeau ou la
proue,
c'efi la partie du vaif–
feau qui s'avance la premiere
a.
la mero
On entendauffi par
I'avant,
tante la partiedu yaif–
feau comprife entre le mar de miCaine
&
la proue
le
cháteall d'avant,
oule
gaillard d'allant. I/oye{
CHA~
TEAU D'AVANT.
Paifleau trop fur {'allant,
c'()fi-a-dire qui a
l'allant
trop enfoncé dans I'eau.
E tre de l'avam ,ft mmTe de l'avant,
fe dit d'un vaif–
(e~ll
quí marchant en compagnie, avance des pre–
nuers.
Et" de l'allant,
fe dit auffi lorfque l'on fe trouve
arrivé a la vlle d'une terre , quand par I'efiírne de fes
routes, on croit en etre eneore éloigné.
fT.
ESTIME.
Leventft range de l'allant,
c'efi-a-rure qu'il prend
par la proue
&
devient contraire a la route.
(Z)
AVANT-BEC ,
f.
m.
en ArchiteClure:
nom qu'on don–
ne aux deux éperons de la pile d'un pon!': Leur plan
efi.leplus
fO~lvent
un triangle équilatéral , dont la
pomte fe prefente au fil de l'eau pour la brifer
&
l'obli&er a palfer fous les arehes, L
'arant-bec
d'aval
AVA
ellle plus (ouvent rond, comme au pont de POIl–
toife.
Les Romains faifoient quelquefois
I'avant-btc d'a–
mont
rond.. comme au 'p0nt Saint-Ange aRome;
&
quelquefols a angle drOlt, comme au pont antique de
Rimini en ltalie.
L'avant-bec d'amont
efi oppofé au
fil
de l'eau
&
eelui d'aval efi au-delfous.
'
Cew~
p.ointe d'une pile qu'on appelle I
'avant-bec ,
ell ordmalrement garnie de dales
a
joints recou–
verts.
(P)
AVANT-BRAS, f. m. partie du métier
a
faire des
baso
Yoye{
BAS
O/l
mélier.
AVANT-CHEMIN-COUVERT, c'ell,
dans la Fofti–
fication,
un fecond cherrun-couvert qui efi plus'avan–
cé dans la c,ampagne que le premier. Lor/qu'il y a
un
avant-/o./l¿
,
on confiruit prefque toujours au-deJa
un
avant-chemin-couvert.
L'allanl-chemin-couvert
ne doit point
~tre
plus élc–
':'~
que le premier ; au contraire on abai{fe quelque–
fOls fon terre - plein d'un pié
&
demi ou deux piés :
mais on lui coníl:.ruit alors deux banquettes. L'
avant–
clLemi~z
-
COl/vert
fe
dt~rci.t
de !a
meme
maniere que le
chemm-couvert ordmalre: 1I a , comme ce premier
fes places d'armes, fes traverfes,
&c. I/oye{
CHE:
M.IN- COUVERT;
1I0ye{
auffi une partie
d'all.tnt
-
che–
rmn-coltvert. PI. 1
f/.
de
l'
aft milit. fig.
3.
(Q)
AVANT-CQi:UR
Ol/
ANTI-CQi:\JR. C'efi,
tn
Anato–
mie,
cette partie creufe proche le creur, communé–
ment appeIlée le
crellX
de l'eflomac
,
&.
par quelques–
uns
JcrobicllllLS cordis.
Ce dernier mot ell: compolé de
';VT)
,
contra,
contre,
&
de
cor
,creur.
(L)
AvANT-CQi:UR , (
MarJch.
)
Les Maréchaux appe!–
lent ainfi une tumeur contre nature, de figure ronde,
&
grolfe
a
peu-pres comme la moitié du poing, qui
fe forme
a
la poitrine du cheval vis-a-vis du creur. Si
I
'avant-cawr
ne vient a fuppuration , c'efi pour le che–
val une maladie mortelle. On dit auffi
ami-cauro
L'
avant-caur
fe manifelle par la tumeur qui paroi't
en-dehors; le cheval devient trifie , tient la tete
balfe,
&
fent un grand battement de creur; il fe lailfe
tomber par terre de tems en tems , comme fi le creur
lui manquoit,
&
qu'il
fUt
pret
a
s 'évanoiiir: il perd
t.o~alement
le manger ,
&
la fievre devient quelque–
tOISfi violente par la douleur aigue qu'il fem, qu'elle
l'emporte en fort peu de tems.
Cette maladie peut avoir deux caufes: elle vient
ou d'une morfondure qui aura fait arreter
&
répan–
dre du (ang dans les grailfes
&
dans les attaches du
mufcle peaoral d'un coté, ou de tous les deux en–
femble; ce limg épanché y forme de la matiere, qui
étant répandue
&
fermentant dans un endroit auili
fenfible, doit aUumer une fievre tres-vive par la dou–
leur violente qu'elle caufe.
L'autre caufe , qui efi bien auffivrailfemblable qUe:!
la premiere,
&
a
laquelle tous ceux qui ont écrit de ce
mal ne I'ont point attribué, que je fache , efi un écart
ou un eIFort du cheval, lequel aura forcé les tendons
des mufcles peaoraux; ce qui caufant une grande
douleur au cheval , vllla fenfibilité de ces parties,
y
excite une inflammation avec tumeur par l'irruptioll
des vailfeaux dans le tems de I'écart.
Cette tumeur difparoit quelquefois , ce qui efi un
tn!s-mauvais pro§nollic ,a moins que la faignée n'en
foit la caufe : enfin fi ce mal arrive a un cheval mal
difpofé, il coun grand rifque de n'en pas revenir.
Lorfque
I'avant-caurvient
a fuppuration,
&
que la
matieres'y forme promptement , il parolt que le che–
val a la force de poulfer au-dehors cette tumeur ,
&
c'efi un bon figne pour fa guérifon.
11 vient auffi au chevalune grolfe tumeur doulou–
reufe au haut de la cuiífe en-dedans, a I'endroit
01\
elle fe joint au bas-ventre, c'efr-a-dire
a
I'aine. Ce
mal efi auili dan&ereux que le précédent; car il eir
















