
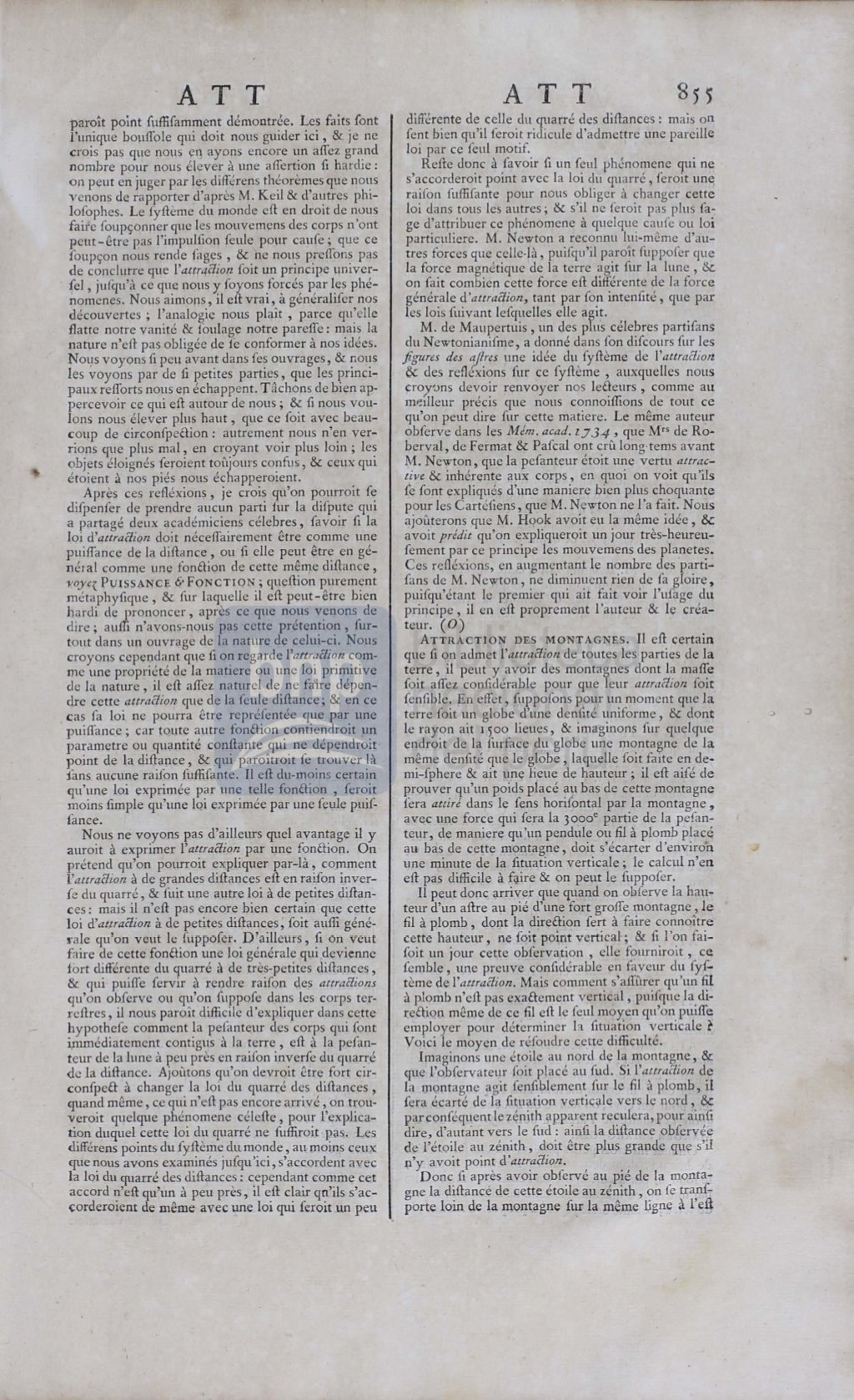
ATT
paro!t point fuffifamment démontrée. Les faits font
l'unique
bO~IÍrole
qui doit nous guider ici ,
&
je ne
erois pas que nous en ayons encore un a{fez grand
nombre pour nous élever
a
une a{fertion ú hardie:
on peut en juger par les différens théoremes que nous
venons de rapporter d'apres M. Keil
&
d'autres phi–
lofophes. Le fyfreme du monde efr en droit de nous
faire fOt¡ps;onner que les mouvemens des corps n'ont
pent-etre pas !'impulúon feule pour calúe; que ce
{oupc;:on nous rende fages ,
&
ne nous pre{fons pas
de conclurre que
l'attr4aion
foit un princ1pe nniver–
{el, jUfqu'a ce que nons y foyons forcés par les phé–
nomenes. Nous aimons, il efr vrai,
a
généralifer nos
découvertes; l'analogifi; nous plalr , parce qu'elle
flatre norre vanité
&
foulage notre pareífe: mais la
nature n'efr pas obligée de re conformer a nos idées.
NOt.lsvoyons ú peu avant dans fes ouvrages,
&
nous
les voyons par de ú petites parties, que les princi–
paux reíforts nous e¡l échappent. Tachons de bien ap–
percevoir ce qui efr autour de nous;
&
{¡
nous vou-
10ns nous élever plus haut, que ce foir avec beau–
coup de circon(peél:ion: autrement nous n'en ver–
rions qtle plus mal, en croyant voir plus loin ; les
objers éloignés feroient tOlljours confu$,
&
ceux qui
étoient
a
nos piés nous échapperoient.
Apres ces refléxions, je crois qu'on pourroit fe
di(pen(er de prendre aucun parti lilr la di(pute qui
a partagé deux académiciens célebres, favoir ú la
loi d'attraaion
doir néce{fairement erre comme une
pui{fance de la difrance, ou ú elle peut etre en gé–
néral comme une fonaion de cette mem,e difrance ,
'Voye{
PUISSA¡'¡CE {/ FONCTION ; queilion purement
métaphyfiqtle, & fur laquelle il efr pellt-erre bien
hardi de prononcer, apres ce que nous venons de
dire; aum n'avons-nous pas 'cette prétention, (ur–
tout dans un ouvrage de la nature de celui-ci. Nous
eroyons cependant qtle
Ú
on regarde
I'attraaion
com–
me une propriété de la matiere ou une loi primitive
de la nature , il efr aífez naturel de ne filre dépen–
dre eette
attraaioll
qtle de la (eule difrance;
&
en ce
cas (a loi ne pourra erre repréfentée que par une
pui{fance; car route autre fonaion contiendroit un
parametre ou quanriré confrante qui ne dépendroit
point de la difrance,
&
qui paroitroit fe trouver la
:lans aucune raifon fuffifante. 11 efr du-moins certain
qu'une loi exprimée par une telle fonétion , (eroit
moíns úmple qu'une Iqi exprimée par une feule pllif–
{ance.
Nous ne voyons pas d'ailleurs qtlel avantage il y
auroit a exprimer
l'
attraaion
par une fonajon. On
prétend qu'on pourroit expliqtler par-la, comment
I'attraaion
a de grandes difrances efr en rai{on inver–
fe du qllarré,
&
(uit une autre loi a de petites difran–
ces: mais il n'efr pas encore bien certain qUfi; cette
loi
d'attraaion
a de petires difrances, {oit auffi géné-
1'ale qu'on veut le (uppofer. D'ailleurs, ú on veut
faire de cetre fonaion une loi générale qui,devienne
fort différente du qtlarré a de tres-petites difrances ,
&
qui pui{fe {ervir a rendre rai{on des
attramons
qu'on obIerve ou qtl'on {uppo(e dans les corps ter–
reftres,
il
nous parolt difficile d'expliquer dans cette
hyporhe{e comment la pe(anteur des corps qui {ont
i.rnmédiatement conrigus a la terre, efr
a
la pe{an–
teur de la lune
a
peu pres en rai{on inverfe du quarré
de la difl:ance. Ajoutons qu'on devroit etre forr cir–
confpea
a
changer la loi du quarré des diil:ances ,
qtland meme, ce qtli n'efr pas encore an;ivé, on trou–
veroit qtlelqtle phénomene céleíl:e, pour l'explica–
tion duquel cette loi du quarré ne {uffiroit paso Les
différens poinrs du fyfreme dn monde, au moins ceux:
que nous avons examinés ju{qll 'ici, s'accordent avec
la lqi du quaué des difl:ances: cependant comme cet
accord n'eft qu'un a peu pres, il efr
c1air
qa'ils s'ac–
corderoient de meme avec une loi qtlÍ feroit un peu
ATT
différente de celle du qtlarré des difrances: mais on
{ent bien qu'il {eroit ridicule d'admettre une pareille
loi par ee {elll motif.
Refre done
a
{avoir ú un {elll
ph~nomene
qui ne
s'accorderoit point avec la loi du qtlarré, {eroit une
rai{on {uffi{ante pour nous obliger a cbanger cette
loi dans tous les autres; & s'il ne feroit pas plus {a–
ge d'attribuer ce phénomene
a
Cjllelque caufe ou loi
parriculiere. M. Newton a reconnu lui-meme d'au–
ues forces que celle-Ia, pui{qu'il paroir (uppo/er que
la force magnétique de la rerre agir {ur la lune, &
on {ait combien cette force eíl: différente de la force
générale d
'attraaion,
tant par ron intenúté, que par
les lois {uivanr le{quelles elle agito
M. de Maupertuis, un des plus célebres partifans
du Newtoniani{me, a donné dans ron di(cours {ur les
figures des ';ft.res
une idée du {yfreme de
l'attraaiOll
&
des reflexions {ur ce fyfreme , auxquelles nous
crol~ns
devoir renvoyer nos leaeurs , comme al!
mf!¡Jleur précis qtle nous connoil1ions de tour ce
qtl'Ol1 peur dire {ur cette matiere. Le meme auteur
ob{erve dans les
Mém.
acad.
lJ
34, que Mrs de Ro–
herval, de Fermat
&
Parca! onr crltlong'tems avant
M. Ne'.lrton, que la pe{anreur étoit tme vertll
attrac–
ti'Ve
&
inhérente aux corps, en quoi on voir qu'ils
{e {ont expliqtlés d'une maniere bien plus choquante
pour les Cartéúens, qtle M. Newton ne I'a fait. Nous
ajouterons c¡ue M.
Hqok
avoir eu la meme idée,
&
avoit
prédit
qll'on expliqueroit un jour tres-heureu–
{ement par ce principe les mouvemens des planetes_
Ces ,eíléxions, en augmentant le nombre des parti–
fans de M. Newton , ne diminuent rien de (a gloire.
puiIqu'érant le premier qtli ait fa ir voir l'túage du
principe, il en efr proprement I'auteur
&
le créa–
teur.
(O)
ATTRACTION DES MONTAGNES. Il eft certain
que ú on admet
I'attraaioll
de routes les parties de la
terre, il peut y avoir des montagnes donr la maífe
{oit alfez conúdérable pour que leur
attraaioll
{oit
fenúble. En effet, {uppo{ons pour un moment que la
terre {oit un globe d'une denfIté uniforme, & dont
le rayon air
1500
lieues,
&
imaginons {ur quelqlle
endroit de la {urface du globe une montagne de la
meme denúré que le globe , laqtlelle {oit faire en de–
mi-{phere
&
ait une lieue de hauteur; il efr airé de
prouver
~u'un
poids placé au bas de cette montagne
lera
auire
dans le {ens horiContal par la montagne,
avec une force qui {era la
3000e
partie de la peCan–
teur, de mal¡iere qu 'un pendule ou
/i1
a plomb
plac~
au bas de cette montagne, doit s'écarter d 'environ
lme minute de la útuation verticale; le calenl n'en
eíl: pas difficile a f"ire
&
on peut le fuppo{er.
II peut donc ª,rriver que qtland on ob{erve la hau–
teur d'un aíl:re au pié d'une fort groífe montagne , le
fil
a plomb, dont la direél:ion {ert a faire connoItre
cette hauteur, ne {qir point vertical;
&
ú 1'on fai–
{oit un jour cette obfervation , elle foumiroit, ce
{emble, une preuve conúdérable en faveur du fy{–
teme de
I'attraaion.
Mais comment s'aífftrer qu'un
fil
a plomb n'efr pas exaaemenr vertical, pui{que la di–
r:eétiQn meme de ce fil efr le {eul moyen qu'OJ1 puiífe
employer
pour déterminer
la
úruation verticale?
Voici le moyen de ré{oudre certe difficulté.
Imaginons une étoile au nord de la monragne,
&
que I'ohfervareur {oir plaeé au {ud. Si
l'attraaion
de
la !.I1ontagne agit {enúblement {ur le 61
a
plomb,
ir
{era écarté dé la útuarion verric¡¡le vers le nord,
&
parcon{éqtlentlezépith apparent reculera, pour ainu
dire, d'amánt vers le {ud: ainú la di{lance obfervée
de l'étoile au zénith, doit etre plus grande que s'ü
n'y avoit point
d'auraail)n.
Donc
íi
apres avoir obfervé au pié de la monta–
gne la difrance de certe étoile au zénith , on {e rran{–
porte loin de la montagne fur la meme l,igne
a
I'eft
















