
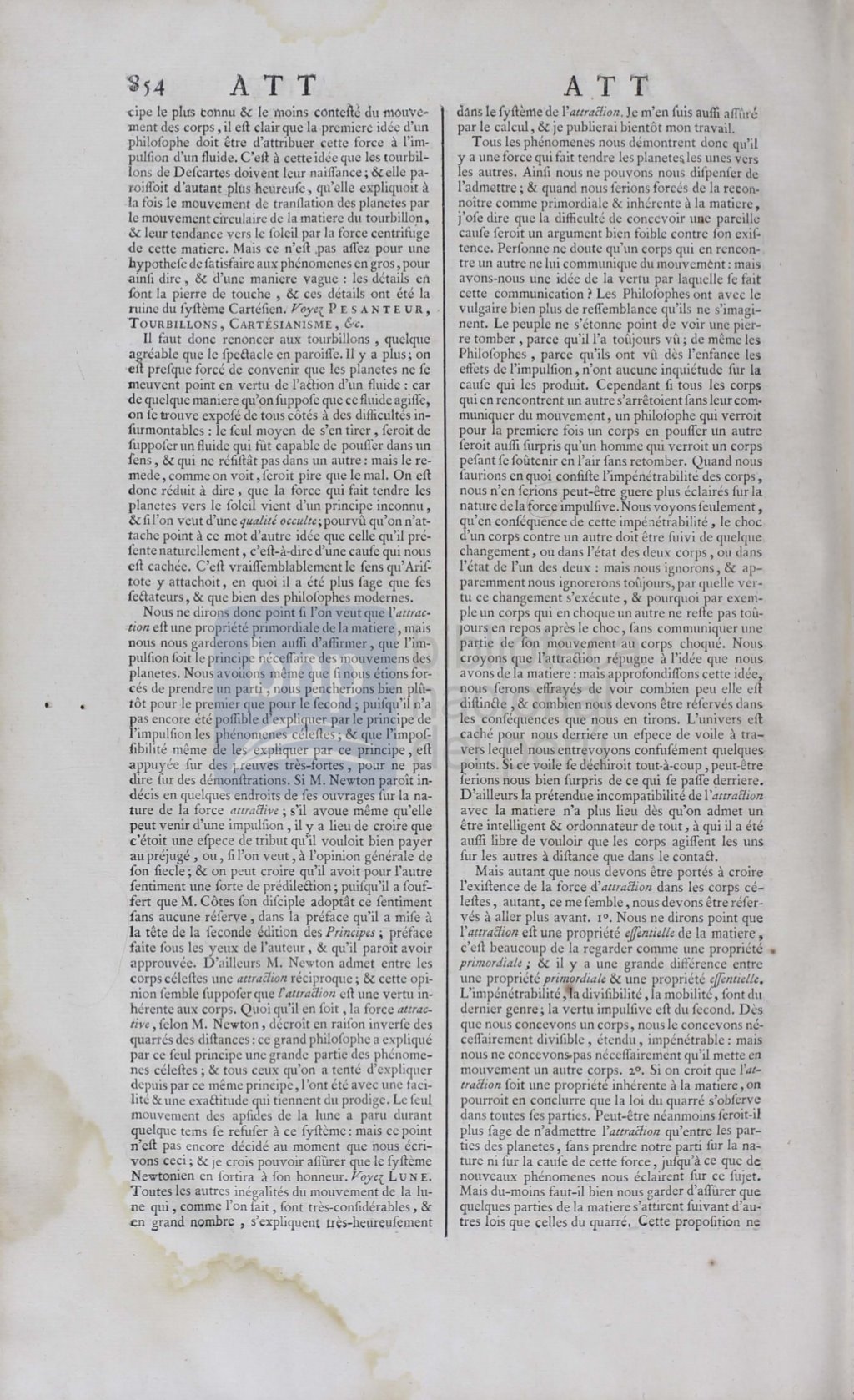
~54
ATT
<:ipe le plus tonnu & le 'i\1oins contellé du
mouve~
ment des corps ,il efr c1air que la premiere idée d'un
philofophe doit &tre d'·attribuer cette force a I'im–
pulfion d'un fluide. C'ea
a
cette idée que les tourbil–
lons de D efcartes doivent leur nai{[ance;
&
elle pa–
roi{[oit d'aurant .plus henreufe} qll'elle e:l:pliquoit
a
la fois 1e mouvement de tranllation nes planeres par
le
mouvementdrclllai.rede la matiere du tOllrbillon,
&
leur tendance vers le foleil par la force centrifu·ge
de cette matiere. Mais ce n'efr .pas aífez pour une
hypothe(e de (atisfaire aux phénomenes en gros, pour
ainli dire, & d'une maniere vague: les détails en
font la pierre de touche , & ces détails ont été la
ruine du fyfreme Carréfien.
Voye{
P
E S A N T E U R, .
TOURllILLONS, CA-RTÉSIANISME,
&c.
II faut done renoncer aux tourbillons , quelque
agréable que le fpeétacle en paroi{[e. II ya plus; on
efr prefque forcé de convenir que les planetes ne fe
meuvent poin! en vertu de I'a&on d'un fluide : car
de quelque maniere qu'on fuppofe que ce
fhlÍdea~i{[e,
on
le
1!rouve expofé de tous cotés a des difficultes in–
furmontables : le [eul moyen de s'en tirer , feroie de
fuppofer un fluide qui ftte capable de poufier dans un
fens, & c¡ui ne réfiíl:ar pas dans un autre: mais le re–
mede, comme on voie ,(eroir pire que le mal. On efr
donc réduit a dire, que la force qui fait tendre les
planetes vers le (oleil vienr d'un principe inconnu ,
&fil'on veutd'une
qualité occulte;pourvll
qu'on n'at–
tache point
a
ce moe d'autre idée que celle qu'i1 pré–
{ente naeurellemene , c'eíl:-a-dire d'une caufe qui nous
eíl: cachée. C'efr vrai{[emblablemene le fens qu'Arif.
tote y attachoir, en quoi
iI
a éré plus fage que fes
feétareurs, & que bien des philofophes modernes.
Nous ne dirons done point fi l'on veutque
l'otITac–
tiOlL
eíl: une propriéré primordiale de la matiere, mais
nous nous garderons bien auffi d'affirmer, que l'im–
pulfion foit le principe néce{[aire des mouvemens des
planeres. Nous avoiions meme que fi nous étions for–
cés de prendre un parti , nous pencherions bien plll–
tot pour le premier que pour le fecond ; Plli{qu'il n'a
pas encore été poffible d'expliquer par le principe de
I'impulfion les phénomenes céleíl:es; & que I'impof–
fibilité meme de les expliquer par ce principe, efr
appllyée fur des ¡-reuves tres-forres, pour ne pas
dire fm des démonfuations. Si M. Newton parolt in–
décis en quelques endroits de {es ouvrages {ur la na–
ture de la force
attraélive;
s'il avoue m&me qu'eUe
peut venir d'une impulíion ,
iI
Y a lieu de croire que
c'étoit une efpece de tribut qu'il vouloit bien payer
au préjugé , ou, fi I'on veut, a I'opinion générale de
fon fiecJe; & on peut croire qu'il avoit pour I'autre
fentiment une forte de prédileilion; plli{qu'il a fouf–
fert que M. Cotes ron difciple adoptat ce fentiment
fans aucune réferve , dans la préface qu'il a mire
a
la tete de la feconde édition des
PrilLcipes;
préface
faite fous les yeux de I'autenr, & qu'il parolt avoir
approuvée. D'ailleurs M. Newton admet entre les
corps céleíl:es une
attraEliolL
réciproque ; & certe opi–
nion {emble fuppofer que
l'
atLraélioll
eíl: une vertu in–
hénmte aux corps. Quoi qu'il en foit , la force
attrac–
tive,
{elon M. Newton, décrolt en raifon invene des
quarrés des difrances: ce grand philofophe a expliqué
par ce feul principe une grande partie des phénome–
nes céleíl:es; & tous ceux qll'on a tenté d'expliquer
depuis par ce meme prineipe, I'om été avec une faci–
lité&une exailitude
qui
tiennent du prodige. Le (eul
mouvement des apfides de la lune a paru durant
quelque tems fe refu{er a ce fyfreme: mais ce point
n'eíl: pas encore décidé au moment que nous écri–
vons ceci ;
&
je crois pouvoir a{[frrer que le fyfreme
Newtoruen en forura a (on honneur.
Voye{
L u
NE.
Toutes les aurres inégalités du mouvement de la lu–
ne qui, comme I'on íait , {ont tres-confidérables, &
en grand nombre, s'expliquent tres-heureufement
ATT
d<lns le {yfl:(:n1e de l'
attraaioll.
J
e m'en (uis auffi a/TlIré
par le calctú, & je publierai bientot mon travail.
Tous les phénomenes nous démontrent done qu'i!
y a une force qui fait tendre les planetes les unes vers
les autres. Ainíi nous ne pouvons nous difpcn(er de
I'admertre ; & c¡uand nous ferions forcés de la recon–
noitre comme primordiale & inhérente a la matiere,
j'o{e dire que la difficulté de concevoir une pareillc
cau{e feroit un argument bien foible contre fon exi[·
tence. Perfonne ne doute qu'un corps qui en rencon–
tre un aUtre ne lui communique du mouvcmént: mais
avons-nous une idée de la vertu par laquelle fe fait
cette communication? Les Philoíophes ont avec le
vulgaire bien plus de re{[emblance qu'ils ne s'imagi–
nenr. Le peuple ne s'éronne point de voir une pier–
re tomber , paree qu'ill'a tOlljours
VII;
de meme les
Philofophes , paree qu'ils ont
Vll
des l'enfance les
eftets de I'impulfion , n'ont aucune inc¡uiétude {ur la
caufe c¡ui les produit. Cependant fi tous les corps
qui en rencontrent un autre s'arretoientfans leurcom·
muniquer du mouvement, un philofophe qui verroit
pour la premiere fois un corps en pou/Ter un autre
{eroit auffi furpris qu'un hornme qtú verroit un corps
pe{ant fe {outenir enl'air fans retomber. Quand nous
faurions en quoi confiíl:e I'impénétrabilité des corps,
nous n'en {e,ions peut-&tre guere plus éclairés fur la
nature de la(orce impulfive. Nous voyons feulement,
qu'en conféc¡lleÍlce de cette impéaétrabilité, le choc
d'un corps contre till autre doit etre fuivi de quelque
changement,
01.1
dans l'état des dellx corps, ou dans
I'état de l'un des deux : mais nous ignorons, & ap–
paremment nous ignorerons tOlljOurs, par quelle ver–
tu
ce changement s'exécute , & pourquoi par exel11-
pIe un corps qui en choque un autre ne reíl:e pas toll–
jours en repos apres le choc, fans communiquer une
partie de fon mouvement au corps choqué. Nous
croyons que I'attraétion répugne a I'idée que nOU5
avons de la matiere: mais approfondi/Tons certe idée,
nous {erons effrayés de voir combien peu elle efr
diftinéte , & combien nous devons etre réfervés dans
les conféquences que nous en tirons. L'univers elt
caché pour nous derriere un efpece de voile a tra–
vers lec¡uel nOlls entrevoyons confufément quelc¡ue5
points. Si ce voile fe déchiroit tout-a-coup ,peut-etre
ferions nous bien furpris de ce qui fe pa{[e derriere.
D 'ailleurs la prétendue incompatibilité de I
'attraélio!l.
avee la matiere n'a plus lieu des qu'on admet un
&tre intelligent & ordonnateur de tour, a qui il a été
auffi libre de vouloir que les corps agi{fent les uns
fur les autres a diíl:ance que dans le contaét.
Mais autant que nous devons &tre portés a croire
l'exiíl:ence de la force
d'atlraéliOlL
dans les corps cé–
lefres, autant, ce mefemble , nous devons &treré{er–
vés a allcr plus avant.
l°.
Nous ne dirons point que
l'
attraélioll
efr une propriété
effintielle
de la matiere ,
c'efr beaucoup de la regarder comme une propriété
pri17lordiale;
& il Y a une grande di/férence entre
une propriété
pri17lordiale
& une propriété
effilltielü.
L'impénétrabilité, la divifiliilité, la mobilité, {ont du
dernier genre; la vertu impulfive efr du fecond. Des
que nous concevons un corps, nous le concevons né–
ce{[airement diviíible, étendu, impénétrable : mais
nous ne concevons.pas néce{[airement qu'il mette en
mouvement un autre cor,Ps.
2°.
Si on croit que
1'0/–
traéliolL
foit une propriéte inhérente a la matiere, on
pourroit en conclllrre que la loi du quarré s'ob(erve
dans toutes fes parties. Peut-&tre néallmoins {eroit-il
plus fage de n'admertre
l'attraéliolL
c¡u'entre les par–
ties des planetes, fans prendre notre paru fur la na·
ture ni (m la caufe de cette force, jtúqll'a ce que de
nouveaux phénomenes nous éclairent (ur ce fujet.
Mais du-moins faut-il bien nous garder d'a{[t¡rer que
c¡uelques parties de la matiere s'artlrent fllivam d'all–
tres lois que celles du quarré, Cette propofition ne
















