
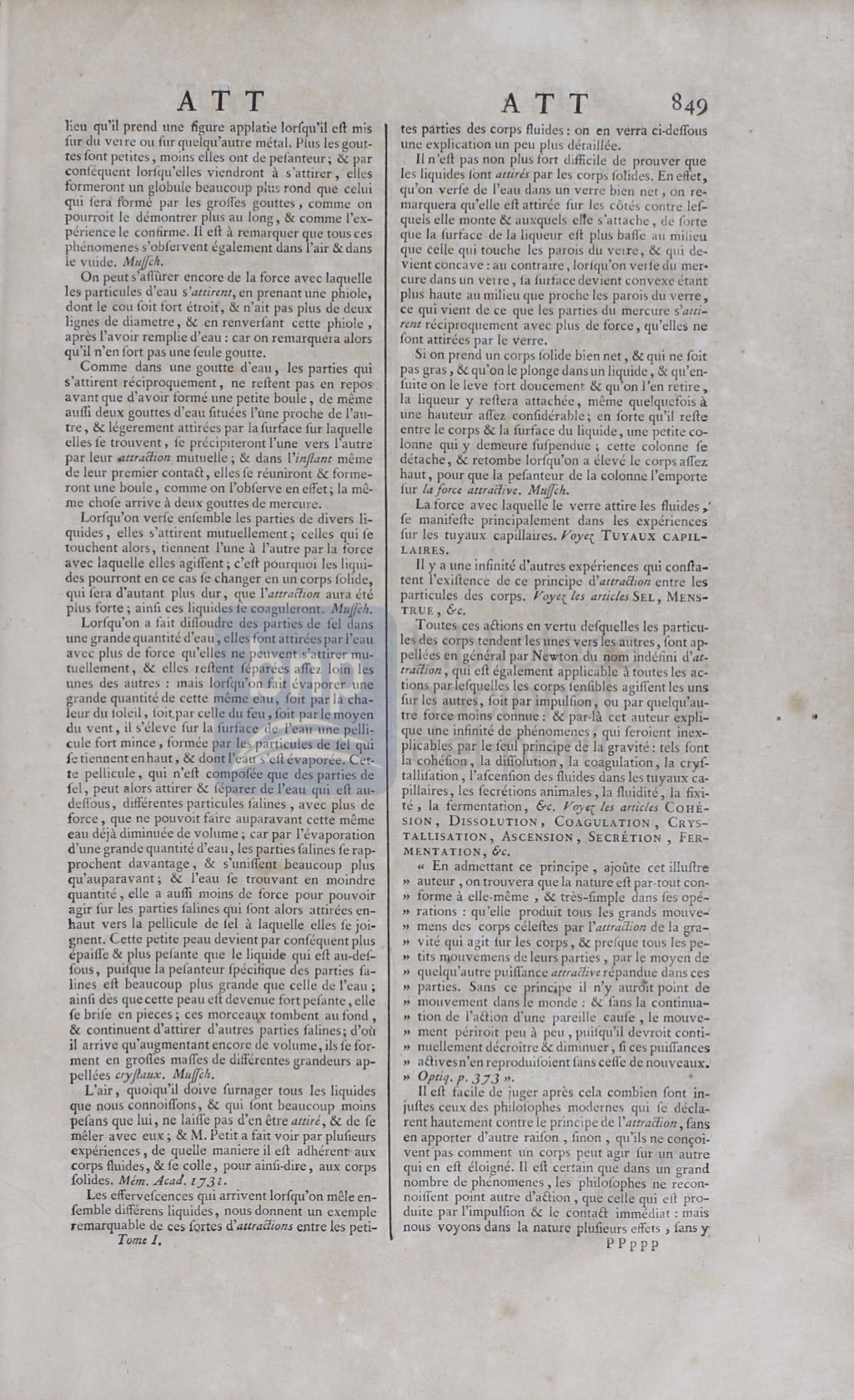
ATT
Iieu qu'iI prend une figure applatie lorfqu'il e/l: mis
{¡Ir du vel re
Ol!
(m quelqu'autre métal. Plus les gout–
tes (ont petites, moins elles ont de pe(anteur;
&
par
conlequent 10ríC:lu'elles viendront a s'attirer, elles
formeront un
~lobule
beaucoup plus rond que celui
qui (era forme par les groffes gouttes, comme on
pourroit le démontrer plus au long, & comme l'ex–
périence le confirme.
Il
eíl: a remarquer que tous ces
phénomenes s'ob(ervent également dans l'air &dans
le vuide.
Muf[c/t.
On peut s'aílllrer encore de la force avec laquelle
les particules d'eau
s'auirent,
en prenantune phiole,
dont le cou (oit fort étroit,
&
n'ait pas plus de deux
lignes de diametre,
&
en renver(ant cette phiole,
apres l'avoir remplie d'eau: car on remarquera alors
qu'il n'en (ort pas une (eule goutte.
Comme dans une goutte d'eau, les parties qui
s'attirent réciproquement, ne reíl:ent pas en repos
avant que d'avoir formé une petite boule, de meme
auffi deux gouttes d'eau {¡tuées l'une proche de I'au–
tre,
&
légeremem attirées par la (urface (ur laquelle
elles (e trouvent, (e précipiteront I'une vers I'autre
par leur
auraaion
mutuelle;
&
dans
I'injlarzt
meme
de leur premier contaét, elles (e réuniront
&
forme–
ront une boule, comme on I'ob(erve en effet; la me–
me chofe arrive a deux gollttes de mercure.
Lor(qu'on ver(e en(emble les parties de divers li–
<jllides, elles s'attirent mutuellement; celles qui (e
touchent alors, tiennent I'une a I'autre par la force
avec laquelle elles agiffent; c'eíl: pourquoi les liqui–
des pourront en ce cas (e changer en un corps (olide,
qui (era d'autant plus dur,
cr.uel'auraaLOn
aura été
plus forte; ainíi ces liquides le coaguleront.
Mufleh.
Lor(qu'on a fait diffoudre des parties de
(el
dans
une grande quantité d'eau, elles (ont attiréespar I'eau
avec plus de force qu'elles ne peuvent s'attirer mu–
tuellement,
&
elles refient (eparées affez loin les
unes des autres : mais lor('lu'on fait évaporer une
arande <jllantité de cette O1eme eau, (oit par la cha–
¡eur du loleil, (oit,.par celle du feu , (oit par le moyen
du vent, il s'éleve (ur la (urface de I'eau une pelli–
cule fort mince , formée par les particules de (el qui
fetienoentenham,
&
dontl'eau s'eíl:évaporée. Cet–
te pellicule, qui n'eíl: compofée <jlle des parties de
fel, peut alors attirer
&
(éparer de l'eau qui eíl: au–
delfous, différentes particules (alines , avec plus de
force, que ne pouvoit faire auparavant cette meme
ean déja diminuée de volllme; car par I'évaporation
d'une grande quantité d'eau, les parties (alines (e rap–
prochent davantage,
&
s'lIniífent bcaucoup plus
qll'auparavant;
&
l'eau (e trouvant en moindre
qllantité, elle a allffi moins de force pour pouvoir
agir (ur les parties (alines 'lui (ont alors attirées en–
haut vers la pellicule de lel
a
laquelle elles (e joi–
gnent. Cette petite peau devient par conCéquent plus
épailfe & plus peCante que le liquide qui efi au-def–
fous, pui(que la pe(anteur (pécifi<jlle des parties fa–
hnes eíl: beaucoup plus grande que celle de l'cau ;
ainíi des quecette peau efi devenue fort pefante, elle
fe bri(e en pieces; ces morceau.x tombent au fond ,
& continuent d'attirer d'alltres parties (alines; d'oit
jI
arrive qu'augmentant encore de volume, ils fe for–
ment en groiles maffes de différentes grandeurs ap–
pellées
eryjlaux.
Mu({ch.
L'air, quoi'lu'il doive fllrnager tous les liquides
que nouS connoiífons,
&
qui (ont beaucoup moins
pe(ans que lui, ne lailfe pas d'en etre
auid,
&
de (e
meler avec ellX; & M. Petit a fait voir par pluíieurs
expériences, de quelle maniere il efi adhérent aux
corps fluides, & fe colle, pour ainíi.dire, aux corps
folides.
Mém.
Aead. l73Z.
Les efferve(cences qui arrivent lor(qu'on mele en–
femble différens liquides, nous donnent un exemple
remarquable de ces fQrtes d'
attra[/ions
entre les peti–
Tom,¡.
ATT
tes parties des corps fluides : on en yerra ci·deffous
une explication un peu plus détaillée.
Il
n 'eíl: pas non plus fort uifficile de prouver que
les liquides 'ont
auirés
par les corps (olides. En eftet,
qu'on ver(e de l'eau dans un vetre bien ner, on re–
marquera qu'elle eíl: attirée
(ur
les catés contre le(–
quels elle monte
&
auxquels elle s'attache, de (orte
que la lilrface de la liqueur eíl: plus baile au mjlieu
que celle qui touche les parois du vel re,
&
qlli de–
vient cOncave :
aU
contraire, lorlqu'on velfe uu mer–
cure dans un ve! re , fa (urface elevient convexe étant
plus haute au milieu que proche les parois du verre,
ce qui vient ele ce que les parties du mercure
s'atti–
rent
réciproquement avec plus de force, qu'elles ne
font attirées par le verre.
Si
on prend un corps (olide bien net ,
&
qui ne (oit
pas gras,
&
qu'on le plonge dans un liquide,
&
qu'en–
ruite on le leve fort doucement
&
qu'on
1
'en retire.
la liqueur y refiera attachée, meme quelquefois
a
une hauteur alfez coníidérable; en forte qu'i1 refie
entre le corps
&
la (urface du liquide, une petite co–
lonne qui y demeure (u(pendue; cette colonne fe
détache,
&
retombe 100{'lu'on a élevé le corps alfez:
ham, pour que la pefanteur de la colonne I'emporte
li.lrlaforce auraéZive. Muf[ch.
La force avec laquelle le verre attire les fluides,–
fe manifeíl:e principalement elans les expériences
fur Ics tuyaux capillaues.
Voye{
TuyAUX CAPIL–
LAIRES.
Il
y
a une infinité d'autres expériences qui coníl:a–
tent l'exiíl:ence de ce principe d'
attraélion
entre les
particules des corps.
Voye{ les artides
SEL, MENS–
TRUE,
&c.
Toutes ces aétions en vertu defquellesles particu–
les des corps tendent les unes vers les autres, (ont ap–
pellées en général par Newton du nom indéfini
d'at–
traaion,
qui efi également applicable
a
toutes les ac–
tions par le(quelles les corps leníibles agiffent les uns
fur les autres, (oit par impullion, ou par <jllelqu'au–
tre force moins connue:
&
par-la cet allteur expli–
que une infinité de phénomenes, <jl,i feroient inex–
plicables par le feul principe de la gravité: tels (ont
la cohéíion, la diffolution, la coagulation, la cryf–
talli(ation, I'a(ceníion des fluides dans les tuyaux ca·
pillaires, les (ecrétions animales, la fluidité, la
fuci.
té, la fermentation,
&e. Vo)',\ les aNides
COHÉ–
SION, DlSSOLUTION, COAGULATION, CRYS–
TALLlSATION, ASCENSION, SECRÉTION ,
FER–
MENTATION,
&e.
" En admcttant ce principe, ajoíhe cet illuftre
" auteur, on trouvera que la nattlre eíl: par-tout con·
" forme
a
elle-meme ,
&
tres-íimple dans {es opé–
" rations : qu'elle produit tous les grands mouve–
" mens des corps célell:es par
l'auraaion
de la gra–
" vité qui agit lür les corps,
&
pre(<jlle tous les pe–
" tits mouvemens de leurs parties, par
II!
moyen de
" qllelqu'autre puiffance
auraaive
répandue dans ces
" parties. Sans ce principe il n'y aurdít point de
" mouvement elans le monde:
&
fans la continua–
" rion de l'aétion d'une pareille cau(e , le mouve–
" ment périroit peu
a
peu
I
Plli{qu'il devroit conti–
" nuellement décrottre
&
diminuer, íi ces puiffances
" aétives n'en reproduifoient fans celfe de nouveaux.
" Optic¡. p.
373
>l.
Il
eíl: facile de jugcr apres cela combien font in·
jufies ceux des philofophes modernes qui fe décia–
rent hautement contre le principe ele l'
auraaion,
fans
en apporter d'autre raifon , fll10n , qu'ils ne conc;oi–
vent pas comment un corps peut agir
(ur
un autl'e
qui en eíl: éloigné.
II
efi certain que dans un grand
nombre de phénomenes ,les philo(ophes ne recon–
noilfent point alltre d'aétion , que celle qui eíl: pro–
duite par I'implllíion
&
le contaa immédiat: mais
nous voyons dans la nature plulieurs effets , fans
y,
P P P
pp
















