
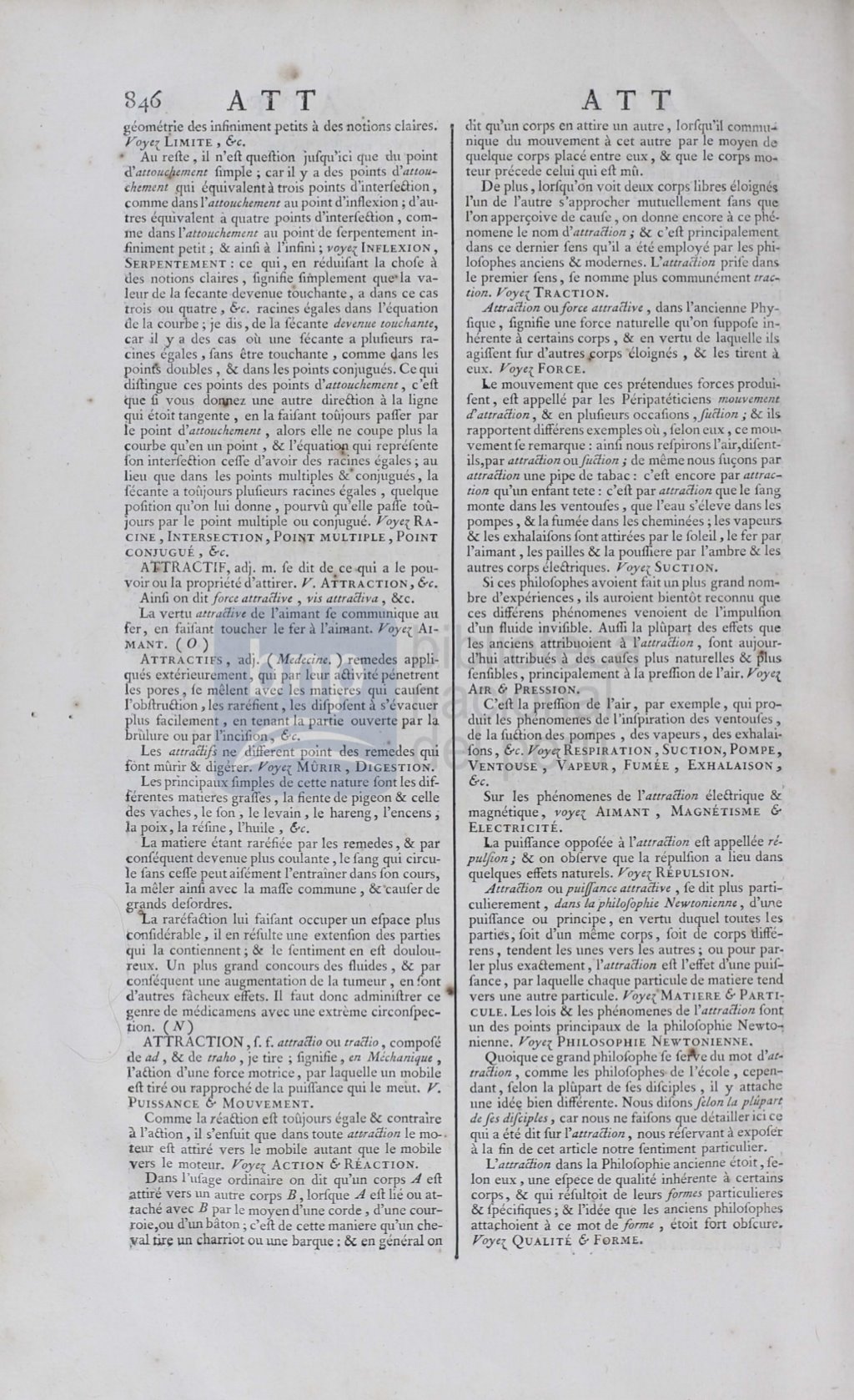
ATT
géométrie des infiniment petits
a
des nctions claires.
Voye{
LIMITE,
&c.
. Au reíl:e , il n'eíl: quefiion ltúqu'ici que du point
d'atloltcjument
limpIe; car
il
ya des points
d'auolt–
chement
Alli équivalenta trois points d'interfe&ion,
comme dans
l'auoltc/ument
au point d'inflexion ; d'au·
tres équlvalent
a
quatre points d'interfeél:ion , com–
me dans
l'attouchement
au point'de ferpentement in–
Jiniment petit;
&
ainíi
a
l'infini;
voye{
[NFLEXION ,
SERPENTEMENT : ce qui, en réduifant
la
chofe
a
des notíons c1aires, lignifie liinplement que-la va–
lem de la fecante devenue touchante, a dans ce cas
troís ou quatre,
&c.
racines égales dans l'équation
de la courbe ; je rus, de la fécante
devmut touchante,
car
jI
:y
a des cas Oll une fécante a pluúeurs ra–
cines égales, fans &tre touchante , comme dans les
poinis doubles ,
&
dansles points conjugués. Ce qui
diíl:ingue ces points des points
d'atlouchement,
c'eíl:
que
fi
vous dOl\l1ez une autre direél:ion
a
la ligne
~ui
étoit tangente, en la faifant tOlljOurS paffer par
le point
d'auoltcl,ement,
alors elle ne coupe plus la
combe qu'en un point , & l'équatiop qui repréfente
ton interfeRion ceffe d'avoir des racines égales ; au
lieu que dans les poínts multiplcs
&.
conjugués, la
fécante a tOlljOurS pluúeurs racines él?ales , quelque
poútion qu'on lui donne , pourvU. 9.u elle paife tOll–
jours par le point multiple ou conjugué.
Voye{
RA–
CI E, INTERSECTION, POINT MULTIPLE, POINT
CONJUGUÉ,
&c.
AITRACTIF, adj. m. fe dit de ce qui a le pou–
voir oula propriété d'attirer.
V.
kÍ"TRACTION,
&c.
Ainfi on dit
force attraaive
,
vis attraaiva,
&c.
La
vertu
attracuve
de l'aimant fe communique au
fer, en faifant toucher le fer a l'aimant.
Voye{
AI–
MANT.
(O)
ATTRACTIFS, adj.
(Medecine.
)
remedes appli–
qués extérieuremenr, qui par leur ailivité pénetrent
les pores, le m&lent avec les matieres qui caufent
l'obíl:ruél:ion, les raréfient, les difpofent a s'évacuer
plus facilement, en tenanr la partie ouverte par la
brúlure ou par l'inciflon,
&c.
Les
auraétifi
ne di/ferent point des remedes qtú
fónt murir
&
digérer.
f/oye{
MORIR, DIGESTION.
Les principaux limpies de cette nature font les dif–
férenres matieres graffes , la fiente de pigeon
&
celle
8es vaches ,
le
fon, le levain , le hareng, l'encens ;
la poix , la réfine, l'huile,
(,oc.
La matiere étant raréfiée par les remedes,
&
par
conféquent devenue plus cOlúante , le fang qui circu–
le fans ceife peut auémenr l'entralner dans fon cours,
la m&ler ainú avec la maffe commune, & 'calúer de
grands defordres.
".La raréfaél:ion lui faifant occuper un efpace plus
tonfidérable, il en réfulte une extenfion des parties
qui la contiennent;
&
le fcntiment en eíl: doulou–
reux. Un plus grand concours des fltúdes, & par
conféquent une augmentarion de la nlmeur , en (onr
d'autres facheux e/fets.
Il
faut donc adminifuer ce
genre de médicamens avec lme extreme circonfpec–
rion.
(N)
ATTRACTION,
r.
f.
attraaio
OH
trtU1io,
compofé
de
ad,
& de
traho
,
je tire; fignifie,
en Méchanique ,
l'ailion d'une force mot:rice, par laquelle un mobile
eíl: tiré on rapproché de la puiffance
qui
le meilt.
V.
PUISSANCE
&
MOUVEMENT.
Comme la réafrion eíl: toujours égale & contraire
a
l'aél:ion , il s'enfuit que dans toute
attraaion
le mo–
teur eíl: attiré vers le mobile autant qtle le mobile
vers le moteur.
Voye{
ACTION
&
RÉACTION.
Dans l'IlCage ordinaire on dit qu'un corps
A
eíl:
$tttiré vers un alltre corps
B,
lorfque
A
eíl: lié ou at–
taché avec
B
par le moyen d'une corde , d'une cour–
roie,ou d'tm baton; c'efl: de cette maniere qu\m che–
~al ti.r~
un charriot
Ol!
une barquc ; & en général on
ATT
dit qu'un corps en atti..re un autre, lorfqu'il commu";
nique du mouvement a cet autre par le moyen de
qtlelque corps placé entre cux,
&
que le corps mo–
teur précede celui qui eíl: mll.
De plus, lorfqu'on voit dellx corps libres éloignés
l'tm de I'autre s'approcher mutucllement fans que
1'0n apperc;:oive de caufe, on donne encore
a
ce phé.
nomene le nom
d'tluraaionj
& c'eíl: principalement
dans ce dernier fens qu'il a été employé par les phi–
lofophes anciens
&
modemes.
L'attraaion
prife
dan
le premier fens, fe nomme plus communément
trae.
&ion. Voye{
TRACTION.
Auraaion ouforce attraaive,
dans l'ancienne Phy–
fique, fignifie une force naturelle qu'on Cuppofe in–
hérente
a
certains corps ,
&
en vertu de laqucllc ils
agiffent fur d'autres .corps éloignés , & les tirent a
eux.
Voye{
FORCE.
Le
mouvement qtle ces prétendues forces produi–
fent, eíl: appellé par les Péripatéticiens
f!LQ/tvemel1t
ti'
attraaion,
&
en plnfieurs occafions
,fuaion;
& ils
rapportent différens exemples otl, felon eux, ce mou–
vementfe remarque: ainú nous refpironsl'air,difent–
ils,par
attraaion oujitaion
j
de m&me nous fuc;:ons par
attraaion
une pipe de tabac: c'eíl: encore par
attrac–
don
qu'un enfanr tete: c'eíl: par
attraaion
que le fang
monte dans les ventoufes, que l'eau s'éleve dansles
pompes ,
&
la fumée dans les cheminées ; les vapeurs
& les exhalauons font atrirées par le foleil , le fer par
l'aimant, les pailles & la pouffiere par l'ambre
&
les
alltres corps élefuiques.
V~e{
SUCTION.
Si ces philofophes avoient fait un plus grand nom–
bre d'expériences, ils auroient bientot reconnu que
ces différens phénomenes venoient de l'impulfion
d'un fluide invifible. Auffi la plllpart des e/fets que
les anciens attribuoient a
!'attrac!ion,
font aujour–
d'hui attribués a des caufes plus naturelles & plus
fenGbles, principalement
a
la preffion de l'air.
Voye{
AIR
6>
PRESSION.
C'eíl: la preffion de l'air, par exemple, qui pro–
duit les phenomenes de l'irúpiration des venroufes,
de la fuél:ion des pompes , des vapeurs, des exhalai–
fons,
&e. Voyer
RESPIRATION, SUCTlON, POMPE,
VENTOUSE , VAPEUR, FUMÉE, EXHALAISON
~
&c.
,
Sur les phénomenes de l'
attraaion
éleél:riqlle
&
magnétique,
voye{
AIMANT, MAGNÉTlSME
&
ELECTRICITÉ.
La puilfance oppofée
a
l'
attraaion
eíl: appellée
ré–
puijion;
&
on obferve qtle la répuLfion a
lieu
dans
qllelques e/fets naturels.
Yoye{
RÉPULSION.
Attramon
ou
puiffancc attraaive
,
fe dit plus parti–
culierement,
dans la philofoplúe Newtonienne,
d'une
puiffance ou principe, en vertu duqtlel toutes
les
parties, foit d'un m&me corps, foit de corps tliffé–
rens, tendent les unes vers les autres; ou pour par–
ler plus exaél:ement, l'
attraaLon
eíl: l'e/fet d'une plúf–
fance, par laquelle chaqne particule de matiere tend
vers une autre particlúe.
Voye{
MATIERE
&
PARTI–
CULEo Leslois & les phénomenes de
l'attrac1ion
font
un des points principaux de la philofophie Newto-:
nienne.
Voye{
PHILOSOPHIE NEWTONIENNE.
Quoiqt,e ce grand philofophe fe feAre du mot
d'at–
traaion,
comme les philofophes de
l'école
,
cepen–
dant, felon la plúpart de fes difciples , il
Y
attache
une idé« bien di/férente. Nons difons
filon la pbtpart
de fis dijeiples,
car nous ne fauons 9ue détailler ici ce
qui a été dit fur l'
attramon,
nous refervant
a
expofer
a
la fin de cet artiele notre fentiment particulier.
L'alVaaion
dans la Philofophie ancienne étoit, fe–
Ion eux, une efrece de qualité irthérente
a
.certains
corps, & qui refultoit de leurs
formes
partlculieres
&
fpécifiques ;
&
l'idée que les anciens philofophes
atta¡;hoient a ce mot de
forme,
étoit fort obfcllre.
Voye{
QUALITI~.
&.FORME.
















