
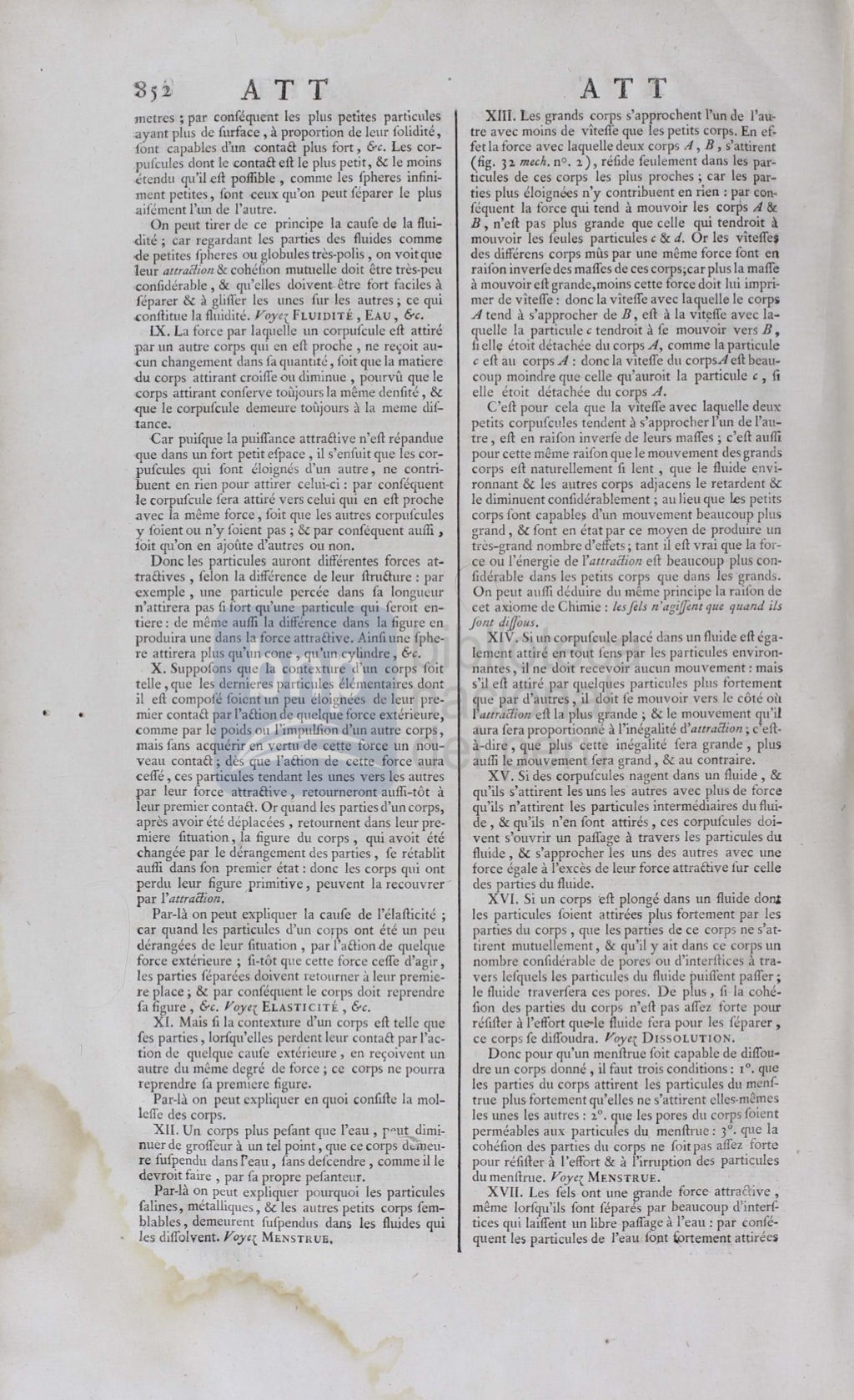
ATT
meHes ; par conféquent les plus petites particules
.ayant plus de Curface ,
a
proponion de leur folidite,
font capables d'ull oontaél: plus fon,
&e.
Les cor–
pu[cules dont le 'contaél: eíl: le plus petit,
&
le moins
étendu qu'il.eíl: poilibIe , comme les fpheres infin i–
lnent petites, font ceux qu'on peut féparer le plus
ai{ément l'tUl de l'autre.
On peut tirer de ce principe la cau{e de la flui–
dite; car regardant les pal1ies des fluides comme
de petites fpheres ou globules tres·polis , on voitque
leur
attraaiol2
&
cohefton muulelle doit <!tre tres-peu
eonlidérable,
&
qu'eIles doivent. <!tre fort faciles
a
feparer
&
a
gli([er les unes {m les autres; ce qui
,eonilitue la fltúdite.
Voye{
FLUlDITÉ, EAU,
&e.
IX.
La force par laquelle un corpufcule eíl: attire
,par un autre corps qui en eíl: proche , ne rec;oit au–
'eun changement dans fa C(uantite, foit que la mariere
'<iu
eorps attirant croiífe ou diminue , pOurVll que le
eorps attirant conferve toujours la m<!me denlite ,
&
que le corpu{cule demeure toújours a la meme di{–
.lance.
Car puifque la plúifance attraélive n'eíl: repandue
que dans un fort petit efpace , il s'en{uit que les cor–
pufcules qui font eloignés d'un autre, ne contri–
buent en rien pour attirer ce!ui-ci : par conféquent
le corpu{cule fera attire vers cehú qui en eíl: proche
avec la m<!me force, foít que les autres corpu{cules
y
{oient ou n'y {oient pas ;
&
par conféquent auili ,
foit qu'on en ajollte d'autres ou non.
Donc les panicules amont differentes forces at–
traél:ives , felon la difference de leur íl:mél:me : par
exemple , une particule percée dans fa longueur
n'attirera pas
li
fort qu'une particule qui feroit en–
tiere; de m<!me auffi la difference dans la figure en
produira une dans la force attrailive. Ainfi une fphe–
re attirera plus qu'un cone, qu'un cylindre,
&e.
X. Suppo{ons que la conte},:tme d'un corps {oit
telle ,que les dernieres particules elementaires dont
il eíl: compole foient un peu eloignees de leur pre–
mier contaél: par l'aél:ion de quelque force exterieure,
cornrne par le poids ou l'impulfion d'un autre corps,
mais fans acquerir en vertu de cette force un nou–
veau contaél:; des que l'aél:ion de cette force aura
ce([e, ces particules tendant les unes vers les autres
par leur force aHraél:ive, retourneront auffi-tot
a
leur premier contaél:.
01'
quand les parties d'un corps,
apres avoir ete déplacees , retournent dans leur pre–
miere fituation, la figure du corps, quí avoit ete
ehangee par le derangement des parties, fe retablit
auffi dans fon premier etat : donc les corps c¡ui ont
perdu lem figme primitive, peuvent la recouvrer
par
l'
attraaiol2.
'
Par-la on peut expliquer la caufe de l'eIailicité ;
ear quand les particules d'un corps ont eté un peu
derangees de leur fituation , par l'aélion de quelque
force extérieure ; íi-tot que cette force ce([e d'agir,
les parties féparees doivent retourner a leur premie–
re place;
&
par conféquent le corps doit reprendre
fa figure,
&e.
roye{
ELASTICITÉ ,
&e.
XI. Mais fi la contexture d'un corps eíl: telIe que
fes parties, 10rfqu'eIles perdent leur contaél: par l'ac–
tion de quelque caufe extérieure, en resoivent lUl
autre du m<!me degré de force; ce corps ne pourra
reprendre fa premlere figure.
Par-la on peut expliquer en quoi cOlútíl:e la mol–
leífe des corps.
XII. Un corps plus pefant que l'eau , rout dimi–
nuer de gro([eur
a
lU1
te! point, que ce corps dcmeu–
te fufpendu dans reau, fans defcendre , cornme il le
devroit faire , par fa propre pefanteur.
~ar-la
O?
pe.utexpliquer pomquoi les particules
falmes , metalhques ,
&
les auu'es petits corps fem–
blables , demeurent fufpendus dans les fluides qui
les diifolvent.
Voye{
MliNSTRUE.
ATT
XIrI. Les grands corps s'approchent l'un de l'att–
tre avec moins de vlteife que les petits corps. En ef–
fet la force avec laquelle deux corps
A, B,
s'attírent
(fig. 31.
meeh.
nO. 1.), réfide feulement dans les par–
ucules de ces corps les plus proches ; cal' les par–
ties plus éloignées n'y contribuent en rien : par con–
féquent la force qui tend a mouvoir les corps
A
&
B,
n'eíl: pas plus grande que celle qtÚ tendroit
a
mouvoir les {eules particules
e
&
d.
Or les vlte([e$
des dilférens corps mlts par une m<!me force font en
raifon inverfedes ma([es de ces corps;carplus la maife
a mouvoir eíl: grande,moins cette force doit lui impri–
mer de vlte([e: done la vlreife avec laquelIe le
corp~
A
tend
a
s'approcher de
B,
eíl: a la Vlt!:!ífe avec la–
quelle la particule
e
tendroit
a
fe mouvoir vers
B,
fielle étoit détachée du corps
A,
comme la particule
e
eíl: au corps
A
:
donc la vitefi"e du
corpsA
eíl: beau–
coup moindre que celle qu'auroit la particule
e
,
fi
elle etoit détachée du corps
A .
C'eíl: pom cela que la vlte([e avee Iaquelle deu>.:
petits corpufcules tendent
a
s'approcher l'tm de l'au–
u'e, eíl: en raifon inverfe de leurs maifes ; c'eíl: auffi
pour cette meme raifon que le mouvement des grands
corps eíl: naturellement fi lent , que le fIuide envi–
ronnant
&
les autres corps adjacens le retardent
&
le diminuent confidérablement ; au lieu que !.es petits
corps {ont capabies el'un mouvement beaucoup plus
grand,
&
font en état par ce moyen de produire un
tres-grand nombre d'elfets; tant iI eíl: vrai que la for–
ce oul'énergie de
l'attraBiol2
eíl: beaucoup plus con–
fidérable dans les petits corps que dans lesgrands.
On peut auili dédlúre du meme principe la raifon de
cet axiome de Chirnie :
LesJels l2'agiffom que quand
ils
fim dij[ous.
XIV.
Si un corpufenle placé dans un fluide eíl: éga–
lement attiré en tout fens par les particules environ–
nantes, il ne doit recevoir aucun mouvement : mais
s'il eíl: attiré par c¡uelques particules plus fortement
que par d'amres, il doit fe mouvoir vers le coté Ol!
l'auraBioll
eíl: la plus grande;
&
le mouvement qu'il
aura fera proportionné a l'inégalité d'
attraBiol2;
c'eíl:–
a-dire , que plus cette inégalité fera grande, plus
auíIi le mouvement {era grand,
&
au contraire.
XV.
Si des corpu{cules nagent dans un fluide ,
&
qu'ils s'attirent les uns les autres avec plus de force
qu'ils n'attirent les particules intermédiaires du fltÚ–
de,
&
qu'ils n'en font atrirés, ces corpu{cules doi–
vent s'ouvrir un paífage
a
travers les particules du
fluide,
&
s'approcher les uns des autres avec une
force égale a l'exces de leur force attraél:ive fur celle
des parties du fllúde.
XVI. Si un corps eíl: plongé dans un fluide don:
les particules foient attirées plus fortement par les
parties du corps , que les parties de ce corps ne s'at–
tirent mutuellement,
&
qu'il y ait dans ce corps un
nombre conf¡dérable de pores ou d'interíl:ices a tra–
vers lefquels les particules du fluide pUl([ent paífer ;
le fluide traverfera ces pores. De plus, fi la cohé–
fion des parties du corps n'eíl: pas a([ez forte pour
ré{tíl:er
a
I'elfort que-Ie fluide fera pour les féparer,
ce corps fe diífoudra.
V~e{
DISSOLUTION.
Done pour qu'un menftrue foit capable de diífOll–
dre un corps donné , il faut trois conditions: rO. que
les parties du corps attirent les particlúes du menf–
true plus fortement qu'elIes ne s'attirent eIles·memes
les lmes les autres: 1.°. que les pores du corps foient
perméables aux pal1icules du meníl:rue:
3°.
que la
cohéfion des parties du corps ne foitpas a([ez .forte
pour réfiíl:er
a
l'elfort
&
a I'irruption des partlclúes
du mení!:rue.
Yoye{
MENSTRUE.
XVII. Les fels ont une rande force attraél:ive ,
meme lorfqu'ils font {épares par beaucoup d'interf–
tices qui laurent un libre paífage a l'eau ; par confé–
quent les particules de l'eau fO)1t tPrtement attirée5
















