
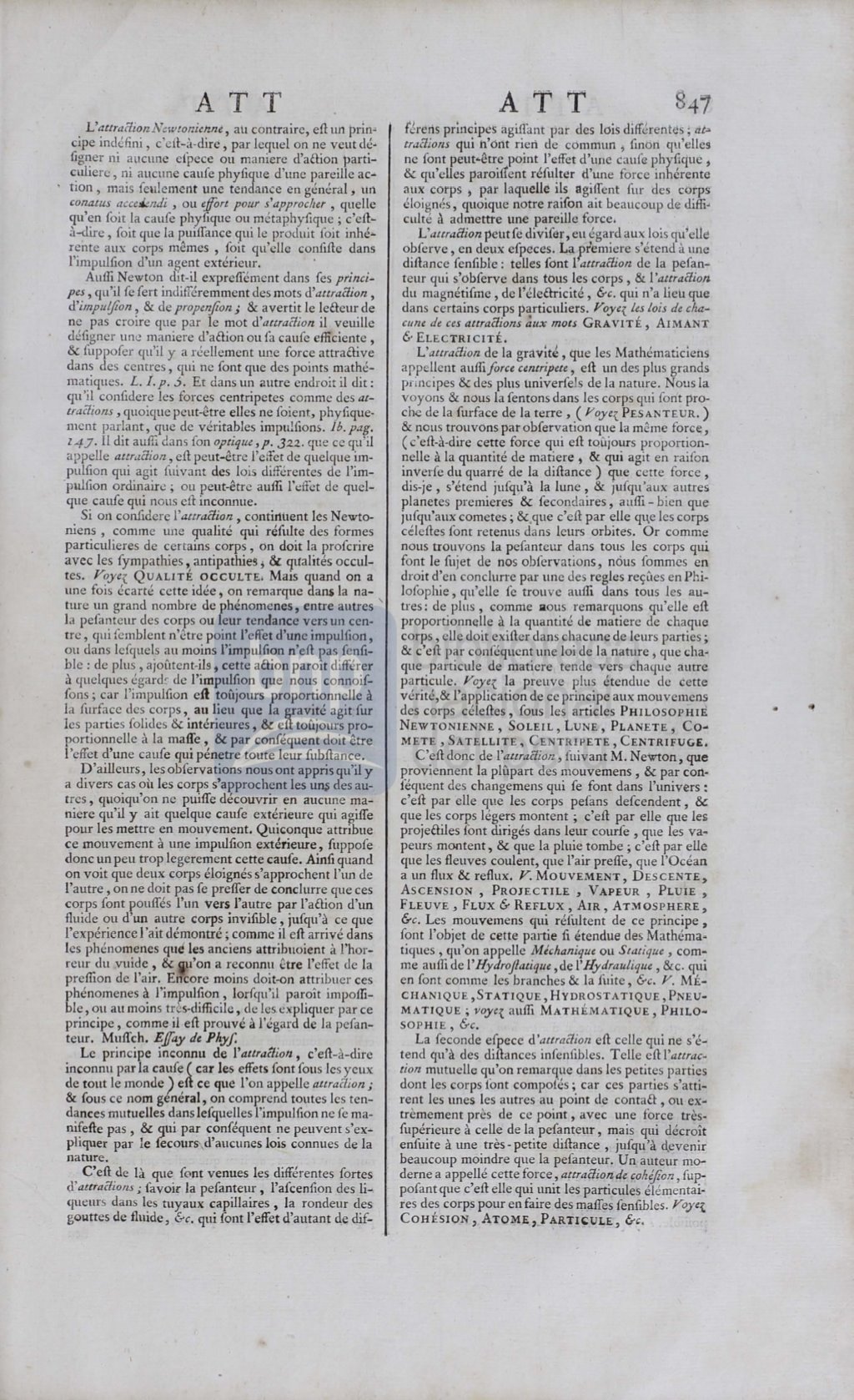
ATT
L'attraaionNew&onieizne,
ah contraire,
ell:
un prín"
cipe indéfini, c'cll:-a-dire, par lequel on ne veut dé·
figner ni ancune efpece ou maniere d'aé.l:ion parti–
culiere, ni aucune calúe phyfique d'une pareille ac–
tion, mais feulement une rendance en général, un
COlUZlUS acceJendi
,
ou
effort
pour s'approcller
,
'lueHe
qu'en foir la cau[e phyfique ou mérap.hyíi'lue ; c'eft–
a-dire, foir <[ue la puiífance qui le prodlúr foir inhé–
renre aux corps memes , foir qu'elle confifte dans
l'impuHion d'un
a~enr
exrérieur.
.
AlIffi Newton dir-il expreífémenr dans fes
prÍnci–
pes,
qu'il fe [err indifféremment des mors d'
auraaion,
d'impuifion,
& de
propenjion;
& averrir le leél:eur de
ne pas croire que par le mor
d'atlTaaion
il veuille
déíigner une maniere d'aél:ion ou Úl cau(e efficienre ,
&
[uppo(er qll'il y a réelIement une force artraél:ive
dans des centres , qui ne font qlle des poinrs marhé–
mati'lues.
L.
l.
p .
.5.
Et dans un mItre endroit il dit:
<In'il confidere les forces centripetes comme des
al–
lraaions ,
quoicllle peut-etre elles ne foient, phyfique–
ment parlant, que de vérirables impu!íions.
lb.pag.
l4.7.
Il dir auffi dans fon
oplique ,p.
322. que ce qu'il
appelle
aur..aÍon ,
eft peur-etre I'effet de quelque im–
pulfion qui agir ftÚVJnt des lois différentes de l'im–
·p\tlfion ordinaire; ou peut-etre auffi I'dfet de quel–
que cau(e qlli nous eil: inconnue.
Si on confidere
l'aurallion,
contir1lumt les Newto–
niens, comme une qualité 'lui ré(ltlte des formes
particulieres de certains corps, On doir la profcrire
avec les fympathies, antipathies;
&
qualirés occul–
tes.
Voye{
QUALITÉ OCCULTE. Mais quand on a
une fois écarté cette idée , on remarque dan¡ la na–
tlue un grand nombre de phénomenes, entre autres '
la pefanreur des corps ou leur tendance vers un cen–
tre, qui [emblent n'erre point l'elfet d'une impwfion,
ou daos le(quels au moins l'impwfion n'eil: pas feníi–
ble : de plus, ajoLlrent-ils
1
cette aél:ion paroit dilférer
a
<[uelques
égard~
de l'impulíion que nous connoi(–
rons; car l'impulíion ell toujours proportionnelle a
la íilrface des corps, au lieu que la gravité agit-fur
les parties folides
&
intérieures ,
&
eil: totijours pro–
portionnelle
a
la maífe,
&
par conféquent doit etre
l'elfet d'une cauCe qui pénetre toute leur (ubil:ance.
D'ailleurs, les obfervarions nous onr appris qu'il
y
a divers cas oil les corps s'approchent les un:; des au–
rres , <Juoiqu'on ne puiífe découvrir en aucune ma–
niere qu'il
y
ait quelque cau(e extérieure qui
a~iífe
pour les mettre en mouvement. Quiconque attnbue
ce mouvement
a
une impulfion extérieure, ruppo(e
donc un peu trop legerement cette caufe. Ainíi quand
on voit que deux corps éloignéss'approchent I'un de
l'autre, onne doit pas fe preífer de conchure que ces
corps [ont pOllífés l'un vers I'autre par l'aél:ion d'un
fluide ou d'un autre
corps
ínvifilile ,ju[qu'¡) ce que
l'expérience l 'ait démontré; comme il eil: arrivé dans
les phénomenes qué les anciens attribuoient 11 I'hor–
reur du vuide ,
&
¡u'on a reconnu etre I'effet de la
preffion de I'air. Encore moins doit-on attribuer ces
phénomenes a l'impwíion , lor(qu'il paroit impoffi–
ble,01l al! moins tres-difficile, de les.expliquer par ce
principe, comme il eil: prouvé
él
I'égard de la pe{an–
teur. MlI{fch.
EJ!ay
de
Phyf.
Le principe inconnu de
l'attratliofl,
c'efi-a-rure
inconnu par la cauCe ( car
les
effets font fous lesyeux
de tout le monde) eft ce que I'on appelle
allraaion;
& fous ce nom genéral, on comprend toutes les ten–
dances mutuelles dans lerquelles I'impulíion ne (e ma–
nifefie pas,
&
qui par con(équent ne peuvent s'ex–
pliquer par le fecourS\d'a1lcunes lois connues de la
nantre.
C'eil: de la que font venues les dilféremes (ortes
d'
allTaél¡ons
;
favoir la pefanteur, I'afceníion des li–
<lueurs dans les hlyaux capillaires , la rondeur des
gOllttes de fluide,
&c.
qui font l'elfet d'autant de dif-
ATT
téreris
prjncipe~
agiífant par des loís diff¿rentés ;
at..
traaions
qui h'ónt rieñ de COmmun , frnbn qu'elles
ne (ont
pellt·~rre
point I'effet d'une cJu(e phyfique ,
&
qu'elles paroií1'ent réfulter d'une force inhérente
aux corps ; par laquelle ils agiífent fur des corps
éloignés, <Juoique notre rai{on ait beaucoup de diffi·
culté a aelmettre une pareille force.
L'
auraaion
petltfe divifer, eu égard aux lois qu'eLle
obferve, en deux e(peces. La ,Pr'emiere s'étend
a
une
diil:ance fenfible: telles font 1
attraaiOIl
de la pefan–
teur qui s'ob(erve dans tbus les corps, &
l'allraaion
du magnéti(me, de l'éleél:ricité,
&c.
'luí n'a lielt que
dans certains corps particuliers.
Yoye{ Les Lois de cha–
CIIm
de
ces atlTaaiOIló
~=
mots
GRAVITÉ, AIMANT
&
ELECTRICITÉ.
L'attrallÍon
de la
grav;t~,
que les Mathématiciens
appellem
allffiforce centripete,
eil: un des plus grands
principes & des plus univer(els de la nantre. Nous la
voyons & nous la fentons dans les corps c¡ui {ont pro–
che de la furface de la terre,
(Voye{
Pf.SANTEUR.)
&
nous trouvons parobfervation que la meme force,
(c'efi-a-dire cette force qui eil: toujours proponion–
nelle
a
la quamité de matiere , & qui agit en raifon
inver(e du quarré de la difiance) que cette force,
dis-je, s'étend jufqu'a la lune , & ju(qu'aux autres
planeres premieres
&
fecondaires, auffi - bien que
ju(qu'aux cometes;
&
que c'efi par elle qt,e les corps
c¿lefies fom rerenus dans leurs orbites. Or comme
nous trouvons la pefameur dans tous les corps qui
font le fujet de nos obfervations, nOlls fomrnes en
eh'oit e1'en conclurre par une des regles reC¡:lles en Phi–
lofophie, qu'elle fe trollve auffi dans tous les au–
u·es: de plus, comme 1i0US remarquons qtl'elle eft
proportionm:lle a la quantité de matiere de chaqtle
corps, elle doit exifier dans chacune de leurs parties ;
& c'eil: par con(équcnt une loi de la nature , que cha–
que panicwe de matiere tende vers chaque autre
particule.
reye{
la preuve plus étendue de cette
vérité,& I'application de ce principe aux mouvemens
des corps célefies, {ous les articles PHILOSOPHIE
NEWTONlf.NNE, SOLEIL, LUNf.,
PLANf.TE, Co·
METE, SATELLlTE, CENTRIPETf., Cf.NTRIFUGf..
C'efidonc de
I'auraélion,
{uivant M. Newton, que
proviennent la plupan des mouvemens ,
&
par cort–
féquent des changemens qui re font dans I'univers :
c'eil: par elle que les corps pefans de(cendent,
&
que les corps légers montent; c'eil: par elle qtle les
projeél:iles (ont dirigés dans lem courre , que les va–
peurs montent,
&
que la pluie tombe ; c'eil: par elle
que les fleuves coulem, que I'air preífe, que I'Océan
a un flux
&
reflux.
V.
MOUVf.MENT, Df.SCENTE,
ASCENSION , PROJECTILE , VAPEUR , PLUIE ,
FLEUVE, FLUX
&
REFLUX, AIR,
ATMOSPHf.RE,&c.
Les mouvemens qui réfultent de ce principe ,
font l'objet de cette partie
fi
étenclue des Mathéma–
tiques, qu'on appelle
Méchanique
ou
SlalÍque,
com–
me auffi de
I'HydroJlalique
,de
I'HydrauLique,
&c. qui
en font comme les branches & la [uite,
&c.
V.
MÉ–
CHANIQUE ,STATIQUE, HYDROSTATIQUE, PNEU–
MATIQUE;
voye{
auffi MATHÉMATIQUE, PHILO–
SOPHIE,
&c.
La (econde e(pece d
'attraaion
efi celle qui ne s'é–
tend qu'a des difiances in(enfibles. Telle efi l'
aurac–
!ion
mutuelle qu'on remarque dans les petites parries
dom les corps font compofés; car ces parties s'atti–
rent les unes les autres au point de contaél:, ou ex–
tremement prt:s de ce point, avec trne force tres–
(upérieure
él
celle de la pe[anteur, mais qui décroit
enCuite a une tres -petite difiance , ju(qu
'¡\
d.evenir
beaucoup moindre que la pefanteur. Un ameur mo–
derne a appellé cette force,
attmaioflde cohéJion,
(up–
pofantque c'eil: elle qui unit les particules élémentai–
res des corps pour en faire des maífes (enfibles.
Vo.y'"
COHÉSION, ATOME, PARTIC;;VLE, &c.
















