
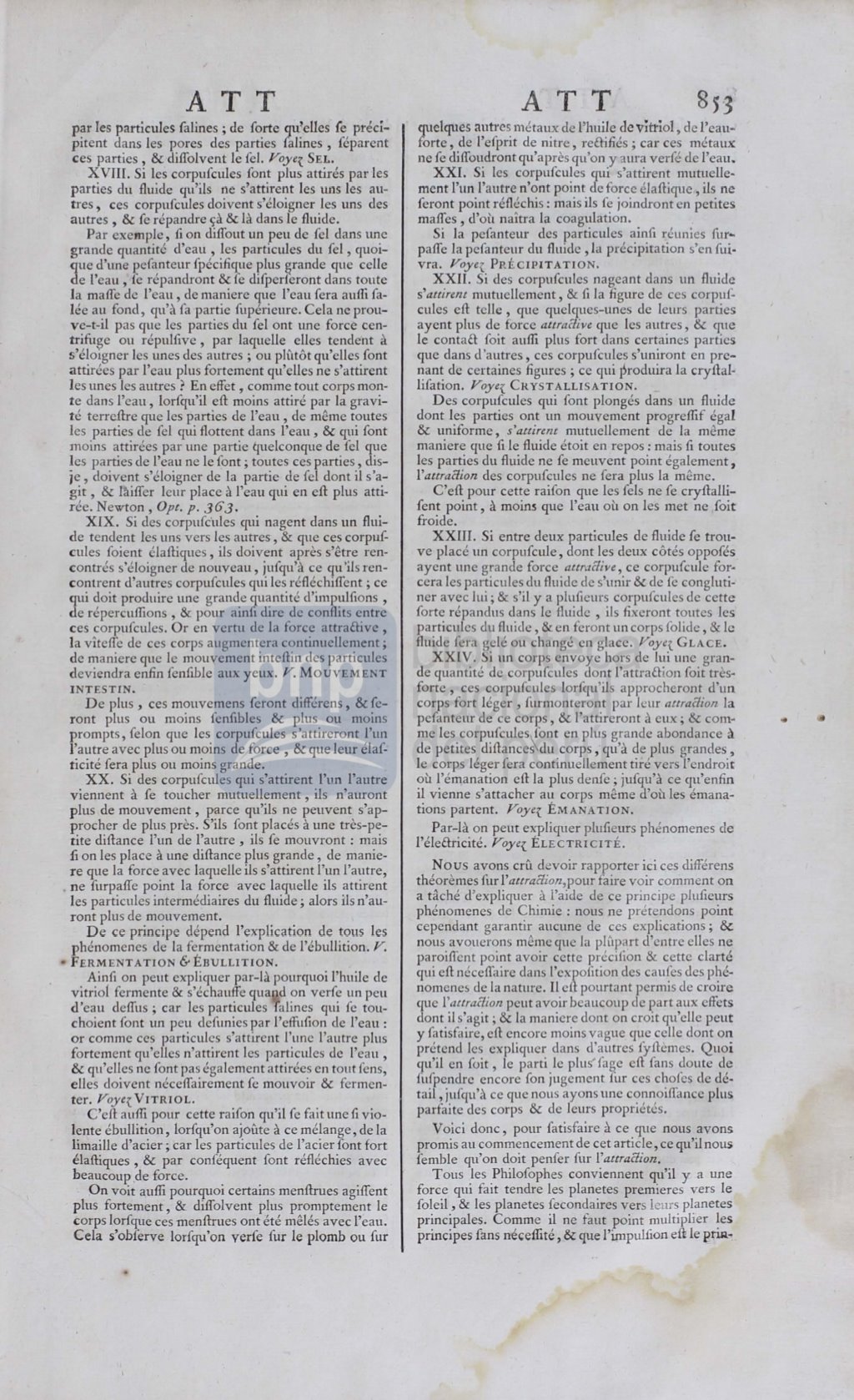
ATT
par les particuIes falines ; de forte qu'eUes fe précí–
pitent dans les pores des parries faJines, féparent
ces parties ,
&
diífolvent le fel.
Voyez
SEL.
XVIII. Si les corpufcuIes font plus attirés par les
parties du fluide qu'ils ne s'attirent les uns les au–
tres,
ces corpufcuIes doivent s'éloigner les uns des
autres ,
&
fe répandre c,:a
&
la dans le fluide.
Par exemple, fi on diífout un pel! de fel dans une
grande quantité d'eau , les particules du fel , quoi–
que d'une pefanteur fpécifique plus grande que celle
de I'eau , fe répandront
&
fe difperferont dans toute
la ma{[e de l'eau, de maniere que l'eau fera auffi fa–
lée au fond, qu'a fa partie fupérieure. Cela ne prou–
ve-t-il pas que les parties du fel ont une force cen–
trifi.l~e
on répulfive, par laquelle elles tendent a
s'élOlgner les unes des autres ; ou pllltot qu'elles font
attirécs par l'eau plus fortement qu'elles ne s'attirent
les unes les autres
?
En effet , comme tout corps mon–
te dans l'eau, lorfqu'il eí!: moins attiré par la gravi–
té terrefue que les parties de l'ean , de m&me toutes
les parties de fel
qui
flottent dans I'eau>
&
qui font
moins attirées par tU1e partie t¡uelconque de fe! que
les parties de l'eau ne le font; toutes ces parties, dis–
je, doivent s'éloigner de la partie de fel dont il s'a–
git,
&
ltliífer lem place a l'eau qui en eí!: plus atti–
rée. Newton,
Opto p. 363.
XIX. Si des corpllfc'ules qui nagent dans un flui–
de tendent les nns vers les aurres ,
&
que ces corpuf–
cules foient élailiques, ils doivent apres s'&tre ren–
contrés s'éloigner de nouveau, jllfqu'a ce qu 'ils ren–
contrent d'autres corpufcules qui les réfléchiífent ; ce
qui doit produire tU1e grande quantité d'impuIfions ,
de répercuffions ,
&
pour ainfi dire de conflits entre
ces corpufcules. Or en vertu de la force artraéhve ,
la vlte{[e de ces corps allgmentera continuellement;
de maniere que le mouvement intellin des particules
deviendra enlin fenfilile aux yeux.
V.
MOUVEMENT
IN¡'ESTlN.
De plus, ces monvemens feront différens,
&
fe–
ront plus Ol! moins fenfililes
&
plus ou moins
prompts, felon que les corpufcuIes s'attireront l'un
l'aurre avec plus ou moins de force,
&
que leur élaf–
ticité fera plus ou moins grande.
XX. Si des corpufcules qui s'attirent l'un l'autre
viennent
a
fe toucher mutuellement,
ils
n'auront
plus de mouvement, paree qu'ils ne peuvent s'ap–
procher de plus preso S'ils font placés a une tres-pe–
tite dií!:ance l'un de l'autre > ils fe mouvront : mais
fi
on les place a une dillance plus grande, de manie–
re que la force avec laquelle
ils
s'attirent I'un l'autre,
ne furpalTe point la force avee laquelle ils attirent
les particules intermédiaires du fluide; alors
ils
n'au–
ront plus de mouvement.
De ce principe dépend I'explication de tous les
phénomenes de la fermentarion
&
de l'ébullirion.
V.
• FERMENTATlON
&
ÉBULLITlON.
Ainfi on peut expliquer par-la pourquoi l'huile de
vitriol fermente
&
s'échauffe quand on verfe un peu
d'eau dd[us; cal' les particules falines qui fe tou–
choient font un peu defunies par l'effufion de l'eau :
01'
comme ces particules s'attirent l'une l'autre plus
fortement qu'elles n'attirent les particules de I'eau ,
&
qu'elles ne font pas égalemenr attirées en tout fens,
elles doivenr nécelTairement fe mouvoir
&
fermen–
ter.
Voyez
VITRIOL.
C'ell allffi pour cette raifon qu'il fe faitune fi vio–
lente ébullirion, lorfqll'on ajoute a ce mélange, de la
limame d'acier ; car les particules de l'acier font fort
élailiques ,
&
par conféquent font réfléchies avec
beaucoup de force.
On voit auffi pourquoi certains mení!:rues agilrent
plus fortement,
&
di{[olvent plus prol1lptemenr le
corps lorfque ces menllrues ont été m&lés avec I'eau.
Cela s'obierve lorfqu'on verfe
fuI'
le plomb ou fur
ATT
quelques <tutresmétaux de l'huile de vitriol, de I'eau–
forte, de I'efprit de nitre, reaifiés; cal' ces métaux
ne fe
di{[oudronrqu'alm~s
qu'on y aura verfé de l'eau.
XXI. Si les corpufcules qui s'attirent mutueUe–
ment l'un l'atltre n'ont point de force élaí!:ique,
ils
ne
feront point réfléchis : mais ils fe joindront en petites
maifes , d'oll nrutra la coagulation.
Si la pefanteur des particules ainfi réllnies furh
pa{[e la pcfanteur du fluide ,la précipitarion s'en
ftú·
vra.
Voyez
PP.ECIPITATION.
XXII. i des corpufcules nageant dans un fluide
s'actirent
nmtuellement,
&
fi la figure de ces corpuf–
cules ell telle, que quelques-unes de leurs parries
ayent plus de force
attraélille
que les alltres,
&
que
le contaél: foit au11i plus fort dans cerraines parties
que dans d'aurres, ces corpufcules s'uniront en pre–
nant de certaines figures; ce qui
l~roduira
la cryí!:al–
lifation.
Voyez
CH.YSTALLISATION.
Des corpufcules qui font plongés dans un fluide
dont les parties ont un mouvement progreffif égal
&
uniforme,
s'attirmc
mlltueUement de la meme
maniere que fi le fluide étoit en repos : mais fi routes
les parties du fluide ne fe meuvent point également ,
l'attraélion
des corpllfcules ne fera plus la m&me.
C'eí!: pour cette raifon que les fels ne fe cryí!:alli–
fent poinr, a moins que l'eau
011
on les met ne foit
froide.
XXIII. Si entre deux particuIes de fluide fe trou–
ve placé un corpufcule, dont les dellx cotés oppofés
ayent une grande force
attroaille,
ce corpufcllle for–
cera les particules dll fluide de s'unir
&
de fe congluti–
ner avec lui;
&
s'il y a plufieurs corpufcllles de cette
forte répandus dans le fluide , ils /Lxeront routes les
particules du flllide,
&
en feront un corps folide,
&
le
fluide fera gelé ou changé en glace.
Voyez
GLACE.
XXIV. Si un corps envoye hors de lui une gran–
de quantiré de corpufcules donr l'attraaion foir tres–
forte, ces corpufcules lorfqu'ils approcheront d'un
corps fort léger> fumlOnteront par leur
attraélion
la
pefanteur de ce corps ,
&
I'attireront a eux;
&
com–
me les corpufcules font en plus grande abondance
a
de petites
dillance~du
corps, qu'a de plus grandes,
le corps léger fera continuellement tiré vers l'endroit
ou l'émanation ellla plus denfe ; jufqu'a ce qu'enfin
il vienne s'attacher au corps m&me d'ou les émana–
tions partent.
Voyez
ÉMANATION.
Par-la on peur expliquer plufieurs phénomenes de
l'élefuiciré.
Voyez
ELECTRI CITÉ.
No us avons
crtl
d voir rapporter ici ces différens
théoremes fuI'
l'
attraélion,pour
faire voir comment on
a taché d'expliquer a l'aide de ce principe plufieurs
phénomenes de Chimie : nous ne prétendons point
cependant garantir aucune de ces explications;
&
nous avouerons m&me que la plCtpart d'entre elles ne
paroi{[ent point avoir cerre précifion
&
cette e!arté
qui ell nécelTaire dans l'expofition des caufes des phé–
nomenes de la nature. Il ell pourtant permis de croire
que
I'attraflion
peut avoir beaucoup de part aux effets
donr il s'agir ;
&
la maniere dont on croit qu'elle peut
y fatisfaire, ell encore moins vague que celle dont on
prétend les expliquer dans d'autres fyil:emes. Quoi
qu'il en foit, le parti le plus"fage ell fans doure de
fufpendrc encore fon jugel1lenr fur ces chofes de dé–
tail ,jufqu'a ce que nous ayons une connoi{[ance plus
parfaire des corps
&
de leurs propriétés.
Voici donc, pour fatisfaire a ce que nous avons
promis au commencement de cet article, ce
qu'il
nous
femble qu'on doir penfer fm
l'attraaion.
Tous les Philofophes conviennent qu'il y a une
force qui fair tendre les planetes premieres vers le
foleil,
&
les planetes fecondaires vers Ic-Irs planetes
principales. Coml1le il ne faut point multiplier les
principes fans néceffité,
&
que l'impul[ion
e~
le priA-
















