
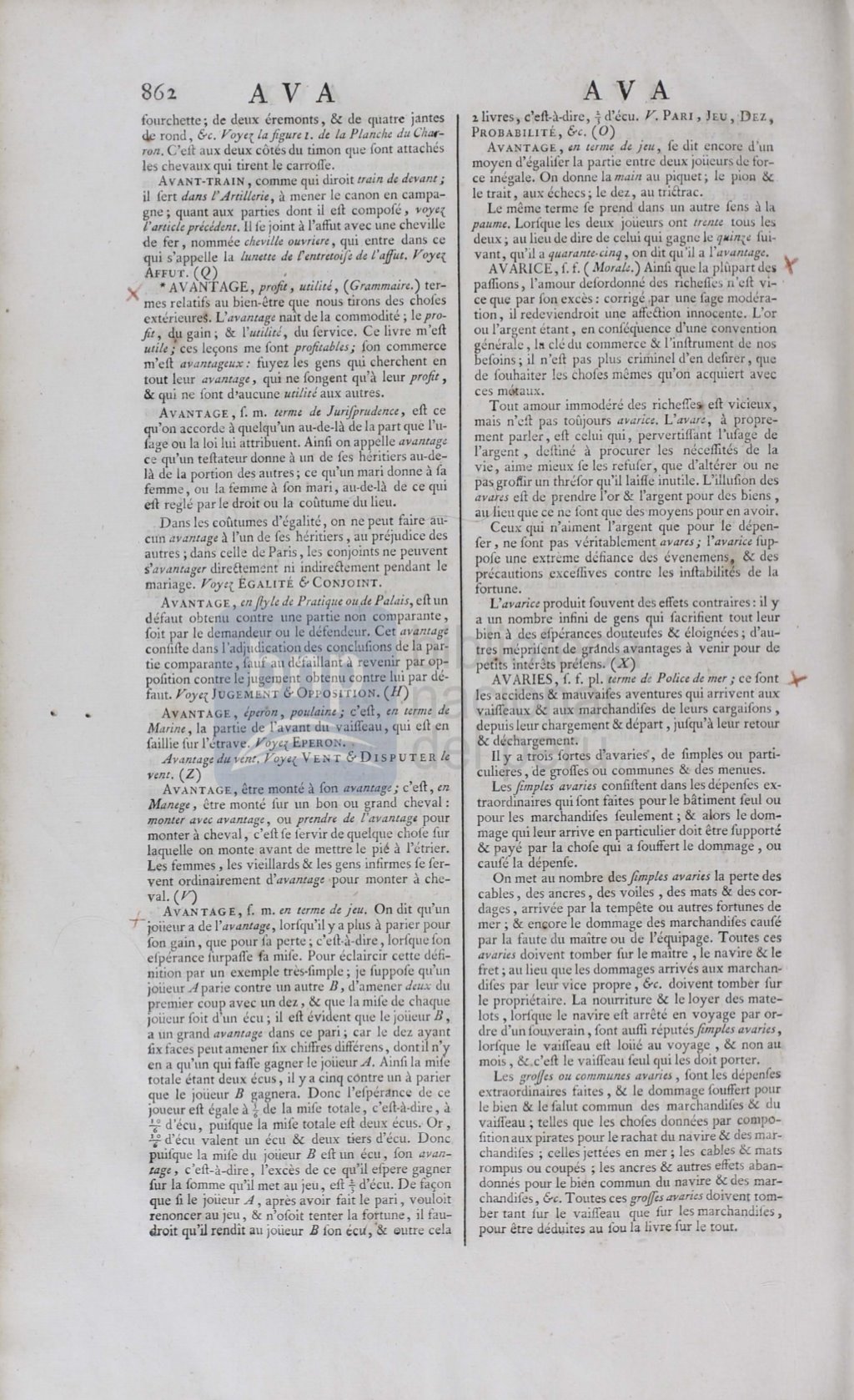
AVA
fourchette; de deux éremonts, & de cluatre jantes
de
rond,
&c. Voye{ la figure
1.
de la Planclze du Clza,.–
ron.
C'eft aux deux cotés du timon que {ont attachés
les chevaux qui tirent le carroire.
AVANT-TRAIN, cornme qui diroit
train de devant;
iI
(ert
dans l'Arállerie,
a
mener le canon en campa–
gne; quant aux parues dont il ell: compo(é,
-voy'{
l'
anicle pdcUent.
Il
(e joint
a
I'affm avec une cheville
de fer, nommée
elleville ou-vriere,
qui entre dans ce
qui s'appelle la
Illnette de l'elUretoift de t'affut. roye{
AFFUT.
(Q)
*
AVANTAGE,
profit, milité, (Grammaire.)
ter–
mes relatifs au bien-etre 'lue nous tirons des cho(es
extérieures. L'
avantage
nan de la commodité; le
pro–
fo,
du gain; &
l'utilicé,
du (ervice. Ce livre m'eíl:
utile
¡
ces
le~ons
me (ont
profitables;
(on commerce
m'eíl:
avantageux:
fuyez les gens qui cherchent en
tout leur
ayantage,
c¡ui ne {ongent c¡u'ii leuT
profit ,
&
qui ne (ont d'aucune
utitid
aux autres.
AVANTAGE, f. m.
tume de luriJPrudence,
eft ce
qu'on accorde
a
c¡uelqu'un au-de-lii de la part que l'u–
fage ou la loi lui attribuent. Ainli on appelle
ayantag~
ce qu'un teíl:ateur donne
11
un de (es héritiers au-de–
la de la portion des autres; ce qu'un mari donne
a
(a
femme, ou la femme ii (on mari, au·de-lá de ce c¡ui
efl
regl~
par le droit ou la colltume du lieu.
Dans les cOlltumes d'égalité, on ne peut faire au–
cun
avt1ntage
a l'un de (es héritiers, au préjudice des
autres ; dans celle d Paris, les conjoints ne peuvent
s'avamager
direélement ni indireétement pendant le
mariage.
Voy:{
ÉGALlTÉ
&
CONJOINT.
AVANTAGE,
en
ft.yle
de Pratiqlle oude Palais,
eíl: un
défaut obtenu contre une partie non comparanre,
{oit par le dema,ndeur ou le défendeur. Cet
aYt1ntage
confifie dans l'adjudicarion des concluúons de la par–
tie comparante, (auf a11 défaillant
11
revenir par op–
poJition conrre le jugellJent obtenu contre lui par dé–
faut. Voye{JUGEMENT &OPPOSITION.
(H)
AVANTAGE,
¡p,ron , pOlllaine;
c'eíl:,
en terme de
Marine,
la partie de l'avant du vailreau, qui ell: en
faillie (ur l'étrave.
Voye{
EPERO '.
AY'1ntagedu-vent. Voye{
VENT
&
D
1
SPUT ER
le
-vent. (Z)
AVANTAGE, erre monté
11
(on
a-vantage;
c'eíl:,
en
Manege,
etre monté (ur un bon ou grand cheval:
monter a-vec ayantage,
ou
prmdre de l'a-vantage
pour
monter
a
cheval, c'
el!
Ce (ervir de quelque chole (ur
laquelle on monte avant de mettre le pié
a
l'étrier.
Les femmes , les vieillards & les gens inlirmes (e fer–
venr ordinairement
d't1vt1ntage
pour monter
a
che–
val.
(1')
AVANTAGE,f.
m.entermedejm.
Onditqu'un
I
joiieur a de
l'avantoge,
lor(qu'il ya plus
11
parier pour
fon gain, que pour {a perte; c'efi·a-dire, lor(que (on
efpérance liupafre (a mire. Pour éclaircir cette déli–
nition par un exemple tres·úmple ; je fuppo(e qu'un
joüeur
A
parie contre un autre
B,
d'amener
deux
du
premier coup avec un dez, & que la mife de chaque
joüeur (oit d'un écu; il eíl: évident (Iue le joiieur
B ,
a un grand
avantoge
dans ce pari; car le dez ayant
fix faces peur amener {¡x chiffres différens, donril
n'y
en a qu'un qui fafre gagner le joiieur
A.
Ainft la mile
torale étant deux écus, il ya cinq cóntre un a parier
que le joiíeur
B
~agnera.
D onc l'e(péntnce de ce
joueur eíl: égale a
6
de la mue totale, c'eíl:-a-dire, a
7-
d'écu, pui{que la mire totale eíl: deux écus. Or,
7-
d'écu valent un écu & deux tiers d'éeu. Done
pujCque la mife du jolíeur
B
eíl: tm éCl!, ron
avan–
¡age,
c'efr-a-dire, l'exces de ce qu'il e{pere gagner
fur la {on:me qu'il met au jeu, eíl:
t
d'écu. De
fa~on
que file ¡oü:l1r
A
, apres avoir fait le pari, vouloit
renoncer au ¡eu, & n'o{oit tenter la fOTtune, il fau–
tlroit qu'il rendir au joiíeur
B
(on 6cti, '& (olll[re cela
AVA
2livres, c'eíl:-a-dirc,
1
d\:cu.
v.
PARI, JEU, DEZ
PROBABILlTÉ,
&c.
(O)
,
AVANTAGE,
m len/le
d~
jm,
fe dit encore d'un
moyen d'égali{er la partie entre deux joiíeurs de for–
ce mégale. On donne la
maill
au piquer; le piOR
&
le traít, aux échecs; le dez, au rriEtrac.
Le meme terme (e prend dans un autre fens
a
la
poume.
Lor((lue les deux joiíeurs ont
trellle
tous les
deux; aulieu de dire de celui qui gagne le
(l'till{~
fui–
vant, qu'il a
quarollle.cinq,
on dir qu'il a
l'avalllage.
AVARICE,f. f.
(Moraú.)
Ain1i
(IUC
la plí'lpartdCi
pailions, l'amour de(ordonné des richefres n 'cíl: vi- '
ce que par fon exces: corrigé .par une (age modéra–
tion, il redeviendroit une affeétion innocentc. L'or
oul'argenr érant, en con{éq'uence d'une convenrion
gén¿ralc, la clé du commerce & l'infuumem de nos
be(oins; il n'eíl: pas plus criminel d'en delirer, que
de (ouhairer les cho(es memes (Iu'on acquiert avec
ces móraux.
Tour amour immodéré des richefres eíl: vicieux,
mais n'c!l: pas ronjours
aVMice. L'aYore ,
a
prOpre–
ment parler, eíl: cclui qui, pervertifrant l'uCage de
l'argent, defiiné
11
procurer les néceilités de la
vie, aime mieux (e les refuCer, que d'altérer ou ne
pa~ gro~lf
un thr¿(or qu'illailfe inutile. L'illufion des
ayares
eíl: de prendre I'or
&
l'argent pour des biens ,
al,dieu que ce ne (ont que des moyens pour en avoir.
Ceux
C¡ltÍ
n'aimenr l'argent que pour le dépen–
{er, ne (om pas vérirablement
avares;
l'
avarice
(up–
pofe une extr' me déliance des évenemens, & des
précautions exceflives contre les inftabilités de la
fOffime.
L'
avarice
produit (ouvent des effets contraires:
il
y
a un nombre inlini de gens qui facrilient tout leur
bien a des e{pérances douteu(es & éloignées; d'au–
tres méprifcnt de gránds avanrages a venir pour de
petits
inrér~ts
prélens.
(X)
AVARIES,
f.
f. pI.
term~
de Poli" de mer;
ce (ont
les accidens & mauvaifes aventures qui arrivent aux
vailreaux & aux marchandifes de lems cargaifons ,
depuis leur chargemenr & départ, ju(qu'a lem retour
& déchargemenr.
Il
y a trois (ortes d'avaries', de fimples ou parti–
culieres, 'de grofres ou communes
&
des menues.
Les
jimpies ayaries
conliíl:ent dans les dépenfes ex–
traordinaires qui {ont faites pour le batimenr feul ou
pOLU' les marchandi{es (eulement; & alors le dom–
mage qui leur arrive en particulier doit etre (upporté
& payé par la chofe qlLÍ a fouffert le dommage , ou
cau{é la dépenfe.
On met au nombre
desjimpies ayt1ries
la perte des
cables, des ancres, des voiles , des mats
&
des cor–
dagcs, arrivée par la tempete ou autres fortunes de
mer;
&
encore le dommage des marchandj(es cauCé
par la faute du mrutre ou de l'équipage. Tomes ces
t1yories
doivent tomber (LU le maltre , le navire & le
frer; au lieu que les dommages arrivés aux marchan–
diCes par lelu vice propre,
&e.
doivenr tomber fur
le propriétaire. La nOltrriture & le loyer des mate–
lots , lor(que le navire eíl: arreté en voyage par or–
dre d'un (ollverain , (ont aulU réputés
jimples avories,
lor(que le vaifreau eíl: loiié au voyage , & non au
mois, &.c'eíl: le vaifreau (eul qui les doit portero
Les
groffes ou commllnts aVt1ri'5
,
font les dépenfes
extraordinaires faites, & le dornmage fouffert pour
le bien
&
le (alut commun des marchandifes & du
vailreau ; telles que les cho(es données par compo–
fttion aux pirares p01U le rachat du navire & des mar–
chandiles ; celles jertées en mer ; les
cables
&
mats
rompus ou coupés ; les ancres & autres effets aban–
donnés pour le bien commun du navire & des mar–
chandifes,
&c.
Tomes ces
groJ!es avaries
doivent rom–
ber rant lur le vaiífeau que fur les marchandiles ,
pour etre dédijites au fou la livre (ur le tour.
















