
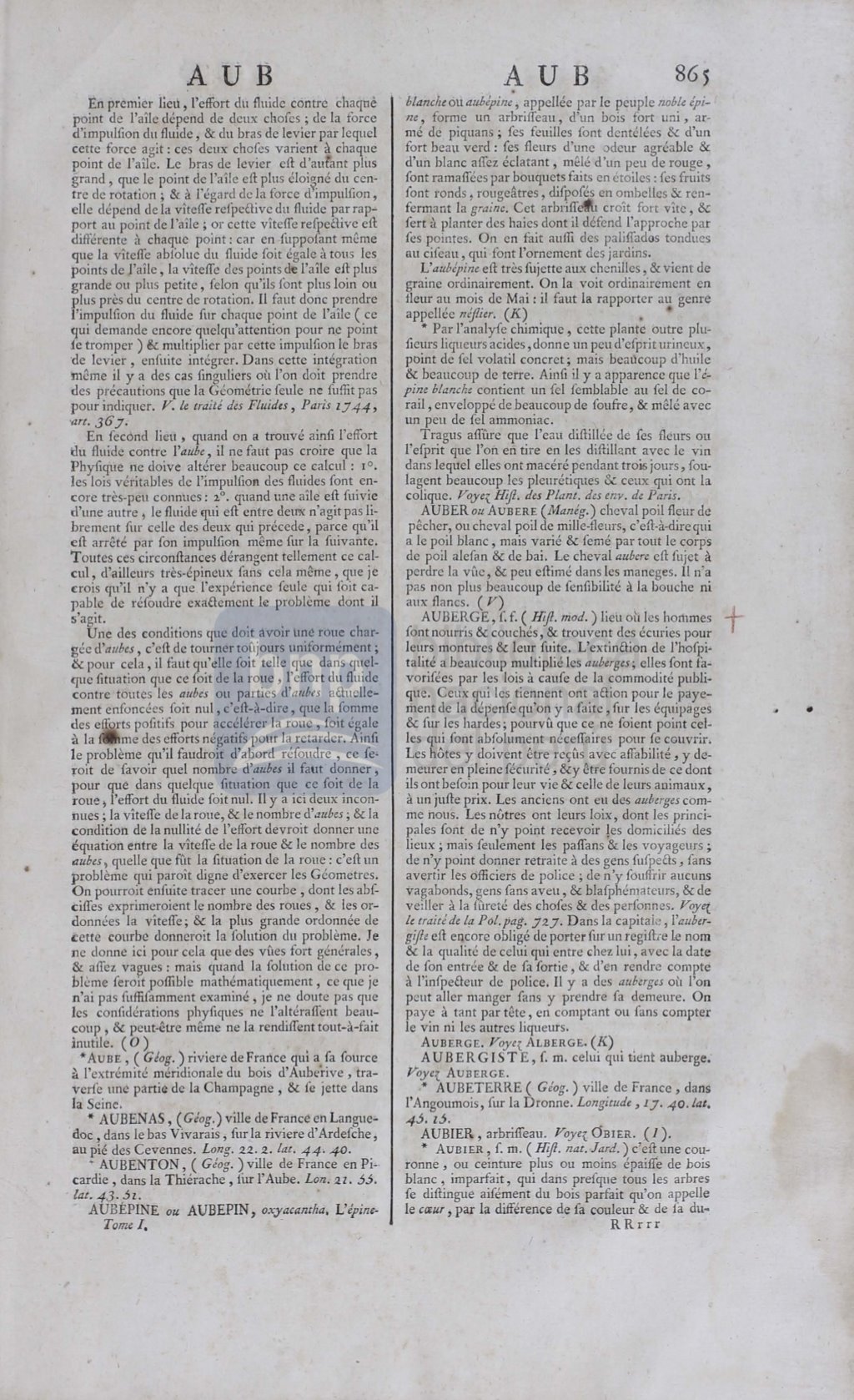
AUB
En premier rieú, I'elfo!"t du fluide contl'e chaqne
point de I'alle dépend de deux cho(es ; de la torce
d'impulíion du fluide,
&
du bras de levier parlequel
certe force agit : ces deux choCes varient achaque
point de I'alle. Le bras de levier eíl: d'autant plils
grand, que le point de I'alle eíl: plus éloi!?né du cen–
tre de rotation ;
&
a l'égard de la force d impulíion,
elle dépend de la vlte([e re(peélive du fluide par rap–
port au point de I'alle ; or cette vlte([e re(peélive eíl:
différente achaque point: car en fuppofant
m~me
que la vite/fe ablolue du fluide foit égale
a
tollS les
points de l'aile, la vite([e des points de I'alle eíl: plus
grande ou plus petite, {elon qu'ils font plusloin ou
plus pres du centre de rotation. 11 faut donc prendre
l'impulíion du fluide fur chaque point de I'aile ( ce
qui demande encore ql1elqu'attention pOUf ne point
fe tromper )
&
multiplier par cette impuHion le bras
'de levier , enCuite intégrer. Dans cette intégrarion
nl~me
il ya des cas fmguliers Oll I'on doit prendre
des précautions que la Géométl"ie {eule ne {uffit pas
pourincliquer.
Vole trailé des Fluides, Paris 1:144,
'art·36:1.
En fecond lieu, quand on a trouvé ainíi I'elfort
tiu fluide contl"e l'
aube,
il ne faut pas croire que la
Phyíique ne doive altérer beaucoup ce caleul:
1°.
les lois véritables de l'impulíion des fluides {ont en–
core tres-peu connttes:
2°.
quand une aile ea {uivie
d'une autre , le flLúde qui ea entre deu\\: n'agir pas li–
brement fur celle des deux qui précede, parce qu'il
eíl: arrcté par fon impulfion meme fur la {uivante.
'routes ces circoníl:ances dérangent tellement ce cal–
cu1, d'ailleurs tres-épineux fans cela meme , que je
erois qu'il n'y a que I'expérience {eule qui foit ca–
pable de ré{oudre exaélement le probleme dont il
s'agit.
Une des conditions que doit avoir Uné roue char–
aée
d'allbes,
c'ea
de tourner tottjours uniformément;
&:
pour cela, il faut qu'elle {oit telle que dans quel–
que íituation que ce {oit de la roue , I'elfort du fluide
contre toutes les
aubes
ou parties
d'a/lbes
aéluelle–
ment enfoncées foir nul , c'ea-a-dire, que la fomme
des elforts poíitifs pour accélérer la roue , foit égale
a
la
me des elforts négatifs polu la retarder. Ainíi
le probleme qu'il faudroit d'abord ré{oudre , ce {e–
roit de (avoir quel nombre
d'aubes
il faut donner,
pour que dans quelque íituation que ce foit de la
roue; l'elfort du fluide Coit nu!.
Il
ya ici deux incon–
nues; la vlte/fe de la roue, & le nombre
d'allbes;
& la
condition de la nullité de l'elfort devroit donner une
équation entre la vJte/fe de la roue & le nombre des
aubes,
quelle que [tlt la firuation de la roue : c'ea un
probleme 'lui parolt digne d'exercer les Géometres.
On pourroit enfuite tracer une courbe , dont
le~
abf–
ci/fes exprimeroient le nombre des roues,
&
les or–
données la víte/fe; & la plus grande ordonnée de
cette courbe donneroit la folutíon du probleme. le
ne donne ici pour cela que des vúes fort générales ,
&
a([ez vagues: mais c¡uand la folntion de ce pro–
blcme feroit poílible marhématic¡uement, ce que je
n'ai pas fLlffifamment examiné, je ne doute pas que
les coníidérations phyíiques ne l'altéra/fent beau–
conp , & peut-ctre mcme ne la rendiífent tout-a-fait
inutile.
(O)
*
AUBE, (
Ciog.
)
riviere de France
qui
a fa fource
a
I'extrérnité méridionale du bois d'Aubei-ive, tra–
verfe une
parti~
de la Champagne , & fe jette dans
la Seine.
*
AUBENAS, (Géog.)ville de Francé eh Langne–
doc , dans le bas Vivarais , fur la riviere d'ArdeCche,
au pié des Cevennes.
Long.
22.2.
lato
44.
40.
• AUBENTON , (
Géog.
)
ville de France en Pi–
cardie , dans la Thiérache , ílli l'Aube.
Lon.
2Z.
joS.
lato 43."l.
AUBÉPINE
ou
AUBEPIN,
o;r;yacanrlza. L'épine–
Tomel,
AUB
blancl,eou aubépine,
appellée par le peuple
noble épi–
ne,
forme un arbri([eau, d'un bois fort uní, ar–
mé de piquans; fes feuilles font dentélées & d'un
fort bea\l verd: {es fleurs d'une :>deur agréable
&
d'un blanc a/fez éclatant, m&lé d'un peu de rouge ,
font rama/fées par bouquets faits en étoiles : fes fruits
font ronds, rougeatl"es, diCpofés en ombelles
&
ren–
fermant la
grainc.
Cet
arbri([e~l
crOlt fort
VI
te ,
&
fert
a
planter des haies dont il défend l'approche par
fes peintes. On en fait auffi des pali([ados tondues
au ci{eau, qui font l'ornement des jardins.
L'
aubépine
ea tres fujette aux chenilles ,
&
vient de
graine ordinairement. On la voit ordinairement en
tleur au mois de Mai :
il
faut la rapporter au genre
appellée
nijlier. (K)
.
'
.. Par l'analyfe chimic¡ue, eette plante outl"e plu–
fieurs li'lueurs acides ,donne un peu d'efprit urineux,
point de (el volatil concret; mais beaúcoup d'huile
& beaucoup de terreo Ainíi il y a apparence que
I'é–
pille blanche
contient un fel ú!mblable au fel de co–
rail, enveloppé de beaucoup de {oufre,
&
n1~lé
avec
un peu de (el ammoniac.
Tragus a/fúre que I'ean diftillée de (es fléurs Ol!
l'e{prit que l'on en tire en les difrillant avec le vin
dans lequel elles ont macéré pendant trois jours, fou–
lagent beaucoup les plenrétiques
&
eeux qui ont la
colique.
Voye{
Hij!.
des Plant. des env. de Paris.
AUBER
ou
AUB ERE
(Manég.)
cheval poil fleur de
p~cher,
ou cheval poil de mille-íleurs, c'efr-a-direc¡ui
a le poil blanc , mais varié & femé par tout le corps
de poil ale(an & de bai. Le cheval
aubere
ea fujet a
perdre la vlle,
&
peu eaimé dansles maneges.
II
n'a
pas non plus beaucoup de fenfibilité a la bouche ni
aux flancs.
(V)
AUBERGE, f. f. (
Hijl.
modo
)
¡ieu otI les hortlmes
font nourrís & couchés,
&
trouvent des écnries pour
leurs montures & leur {uite. L'extinélion de I'hofpi–
talité a beaucoup multiplié les
auberges;
elles font fa–
vorifées par les lois a cau{e de la commodité publi–
que. Ceux qui les tiennent ont ailion pour le páye–
ment de la dépenfe qu'on y a faite, fur les équipages
& {ur les hardes; pourvu que ce ne foient point cel–
les qui font abfolument néce([aires pour {e couvrir.
Les hotes y doivent etl'e rcI':US avec affabilité , y de–
memer en pleine fécmiré, &y
~tre
fournis de ce dont
ils ont be{oin pour leur vie & celle de leurs aoimaux,
a un juíl:e prix. Les ancíens ont eu des
auberges
com–
me nous. Les notl"es ont leursloix, dont les princi–
pales Cont de n'y point recevoir les domiciliés des
lieux ; mais feulement les pa/fans
&
les voyageurs ;
de n'y point donner retraite a des gens fufpeéls, fans
avertir les officiers de police ; de n'y fOlLffrir aucuns
vagabonds, gens fans aveu, & bla{phémateurs, & de
"eiller a la (ftreté des chofes
&
des per(onnes.
Voy'1
le traitéde l{t Polo pago 72:1.
Dansla capital/! ,
I'auber–
gijle
eíl: eocore obligé de porter fur un regurre le nom
& la Cfualité de celui qui entre chez lui, avee la date
de fon entrée & de fa fortie, & d'en rendre compte
a
l'infpeéleur de police.
Il
y a des
auberges
011
I'on
peut aller manger fans y prendre fa demeure. On
paye a tant par tete, en comptant OLl fans compter
le vin ni les autl"es liqueurs.
AUBERGE.
Voye{
ALBERGE..
(K) .
AUBERGISTE,
f.
m. celui qui tiént auberge.
Voye{
AUBERGE.
*
AUBETERRE (
Géog.)
ville de France, dans
l'Angoumois, fur la Dronne.
Longitude, 1:1. 4 o .lat,
4.J. d.
AUBIER, arbriífeau.
Voye{
c5BIER.
(1).
*
AUBIER,
f.
m.
(HzjI.
nato lard.)
c'eft une cou–
ronne, ou ceinture plus ou moins épaiífe de bois
blanc, imparfait, qui dans pre{que tous les arbres
fe diaingue aiCément du bois parfait qu'on appelle
le
caur
,
par la différence de fa couleur
&
de
Úl
du.
RRrrr
t
















