
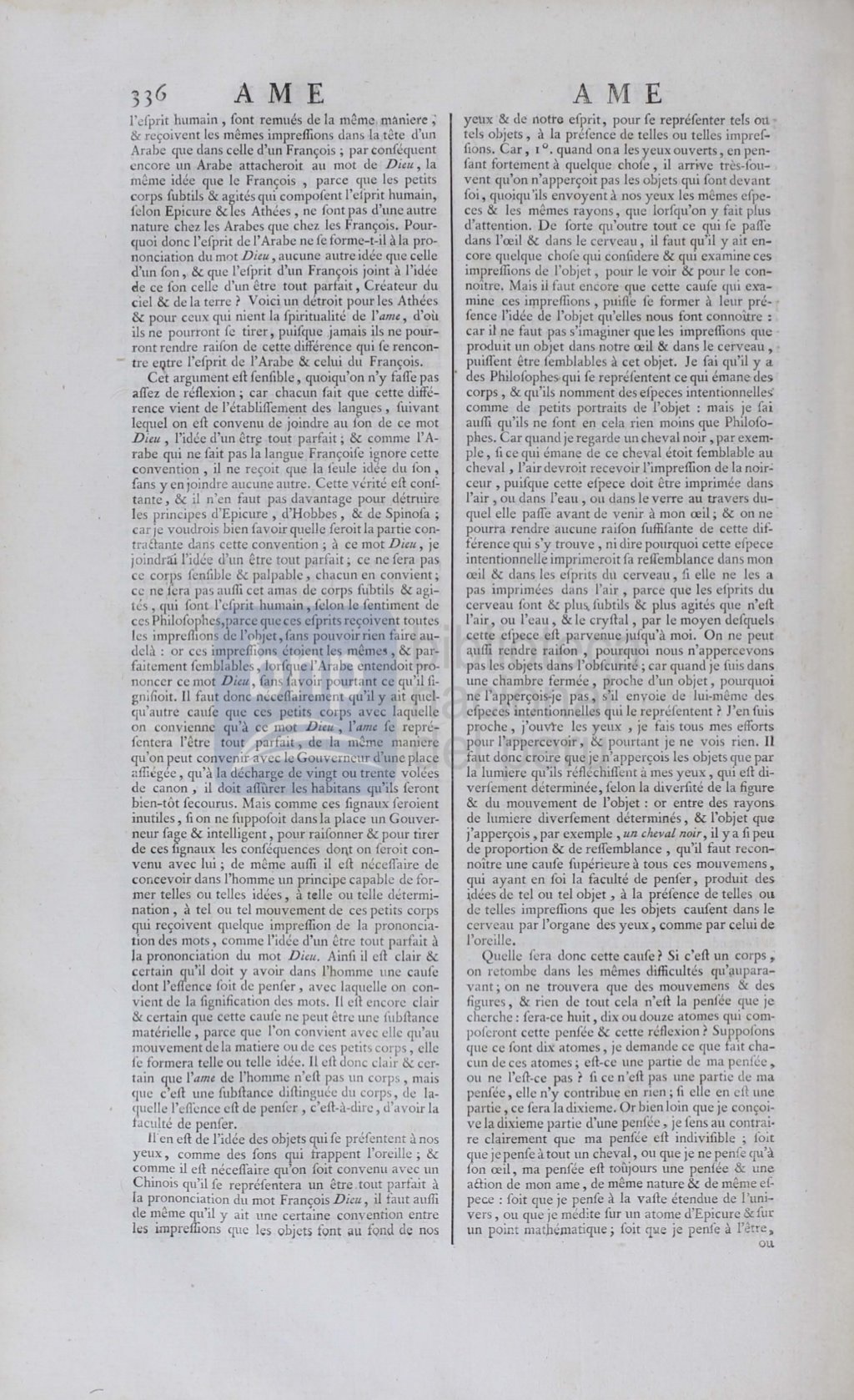
AME
l'c{prit humain , (ont remués de la
m~me m~niere
;
&
res:oivent les
m~mes
impreffions dans la
t~te
d'un
Arabe que dans ceHe d'un Frans:ois ; par con{équent
encore un Arabe artaeheroit au mot de
Dieu,
la
m~me
idée que le Frans:ois , paree que les petits
corps (ubtils
&
agités qui eompo{ent I'eiprit humain,
felon Epicure
&
les Athées , ne {ont pas d'une autre
nature chez les Arabes que ehez les Frans:ois. Pour–
<juoi done l'e(prit del'Arabe ne(eforme-t-il a la pro–
noneiation du mot
Dieu,
aucune autre idée que celle
d'un {on,
&
que l'e{prit d'un Frans:ois joint
a
l'idée
de ce (on eelle d'un
~tre
tout parfait, Créateur dll
cie!
&
de la teITe? Voici un détroit pour les Athées
&
pour ceux qui nient la (piritualité de
l'ame,
d'ou
ils ne pourront {e tirer, pllifqlle jamais ils ne pour–
ront rendre raifon de eette différence qui
(e
rencon–
tre eQtre l'e(prit de l'Arabe
&
celui du Frans:ois.
Cet argument eíl: (en(¡ble, quoiqu'on n'y faíre pas
¡¡írez de réflexion; car ehaeun {ait que eerte diffé–
rence vient de l'établiírement des langues , (uivant
leque! on eíl: convenll de joindre au (on de ce mot
Dieu,
I'idée d'un
~tr¡:
tout parfait;
&
conm1e I'A–
rabe qui ne (ait pas la langue Frans:oi{e ignore cette
convention , il ne
re~oit
que la íeule idée du fon ,
fans yen joindre aueune mItre. Cette vérité eíl: con!:
tante,
&
il n'en faut pas davantage pour détruire
les principes d'Epieure , d'Hobbes,
&
de Spino{a ;
ear je voudrois bien (avoir quelle {eroit la parrie con–
traaante dans cette convenrion ; a ce mot
Dieu,
je
joindrlÚ I'idée d'un
~tre
tout parfait; ce ne {era pas
ce eorps (en(¡ble
&
palpable) chacun en convient;
ce ne {era pas auíIi cet amas de corps fubrils
&
agi–
tés , qui {ont l'efprit humain, {clonle {enriment de
ces Philofophes,parce que ces ef¡Jritsres:oivent toutes
les impreíIions de
l'o~jet,
fans pouvoirrien faire au–
dcla : or ces impreffions étoient les
m~me5
,
&
par–
faitement {emblables, lorfque l'Arabe entendoit pro–
noncer ce mot
Dieu,
fans favoir pourtant ce qu'il (¡–
gni60it.
11
faut done néceírairement qu'il y ait quel–
qu'autre caufe que ces petits corps avec laquelle
on convienne qu'a ce mot
Dielt, l'ame
fe repré–
(entera
]'~tre
tout parfait ) de la
m~me
maniere
qu'on peut convenir avec le Gouverneur d'une place
aíIiégée, qu'a la décharge de vingt ou trente volées
de canon, il doit amlrer les habitans qu'ils {eront
bien-tot {ecouTlls. Mais comme ces (¡gnaux feroient
inutiles, (¡ on ne (¡Ippofoit dans la place un Gouver–
neur (age
&
intelligent, pour raifonner
&
pour tirer
de ces (¡gnaux les coniequences dOf\t on (eroit con–
venu avee lui ; de m&me auíIi il eíl: néceíraire de
concevoir dans l'homme un principe capable de for–
mer telles ou telles idées,
a
telle ou telle détermi–
nation, a tel ou tel mouvement de ces petits corps
qui res:oivent quelqlle impreíIion de la prononcia–
bon des mots, comme l'idée d'un &tre tout parfait a
ja prononciation du mot
Dieu.
Ainli il eíl: clair
&
certain qu'il doit y avoir dans l'homme une cau{e
dont l'eírence {oit de penter, avec laquelle on con–
vient de la lignification des mots.
Il
eH encore clair
&
eertain que cette caufe ne peut
~tre
une fubíl:ance
matérielle, paree que l'on convient avec elle qu'au
mouvement de la matiere ou de ces petitscorps , elle
fe formera telle ou telle idée.
Il
ea
donc clair
&
cer–
tain que
l'ame
de l'homme n'eíl: pas un corps, mais
que c'eíl: une (ubíl:ance dií1:inguée du corps, de la–
(¡uelle l'eilcnce ell: de pen{er , c'eíl:-a-dirc, d'avoir la
faculté de penfer.
lI"en ell: de l'idée des objets qui {e préfentent
a
nos
yeux, comme des fons qui trappent l'oreille;
&
comme il eíl: néceililÍre qu'on (oit convenu avec un
Chinois qu'il fe repré(entera un
~tre
tont parfait a
la prononciation du mot Frans:ois
D ieu,
il faut allíIi
ele meme qu'il y ait une certaine convent1on entre
lc:s impreffions (!ne les objcts
font
¡¡U
fQlld
de
nos
AME
yeux
~
de notre efprit, pour fe repré{enter tels oa
te!s obJets, a la pre{ence de telles ou telles impref–
(¡ons. Car ,
10.
quand on a les yeux ouverts, en pen–
fant fortcment a quelque cho{e, il arrive tres-{ou–
vent c¡u'on n'appers:oit pas les objets qui font devant
(oi, quoiqu'ils envoyent a nos yeux les
m~mes
e{pc–
ces
&
les memes rayons, que lorfqu'on y fait plus
d'artention. De forte Cfll'outre tout ce qui (e paíl'e
dans l'ceil
&
dans le cerveau, il faut qu'i! y ait en–
core Cjuelque chofe CflIÍ cOMdere
&
qlli examine ces
impreíIions de I'objet, pour le voir
&
pour le con–
noltre. Mais il faut encore que certe calúe qui exa–
mine ces impreíIions , puiíre fe former
a
leur pré–
fence l'idée de l'objet qll'elles nous font connoure ;
car il ne faut pas s'imaginer (Iue les impreíIions Cflle
produit un objet dans notre ceil
&
dans le cerveau ,
puiírent etre femblables a cet objeto Je (ai qu'il y a
des Philofophes qui (e repréfentent ce qui émane des
corps ,
&
Cju'ils nomment des efpeces intentionnelles'
comme de petits portraits de l'objet : mais
je
faj
auffi qu'ils ne [ont en cela rien moins Cflle phllo{o–
phes. Car quand je regarde un cheval noir , par exem–
plc,
Ii
ce qui émane de ce cheval étoit femblable au
cheval, l'air devroit recevoir l'impreffion de la noir–
ceur , puifc¡ue cene efpeee doit etre imprimée dans
I'air, ou dans l'eau, 011 dansleverre au travers du–
Cfllel elle paíre avant de venir
a
mon ceil;
&
on ne
pourra rendre aucune raifon fuffifante de cette dif–
férence qui s'y trouve , ni fue pOllTquoi cerre efpece
intentionnclle imprimeroit fa re1Temblance dans mon
ceil
&
dans les efprits du cerveau, (¡ elle ne les
a
pas imprimées dans l'air, parce que les efprits du
cerveall font
&
plus, {ubtils
&
plus agités que n'eíl:
l'air, on l'eau,
&
le cryíl:al , par le moyen de{quels
cette e{pece eíl: parvenue ju{qu'a moi. On ne peut
a.uíIi rendre rai{on , pourc¡uoi nous n'appereevons
pasles objets dans l'obfcurité ; car Cflland je fuis dans
une chambre fermée, proche d'un objet, pourquoi
ne l'appers:ois-je pas, s'il envoie de
lui-m~me
des
cfpeces intentionnelles qui le repréfentent
?
J'en fuis
proche, j'ouvte les yeux , je fais tous mes efforrs
pour l'appercevoir,
&
pourtant je ne vois rien.
n
faut donc croire Cflle je n'appen;ois les objets que par
la lumiere qu'ils réfl 'chilfent
a
mes yeux, CfllÍ eíl: di–
verfement déterminée, (e!on la diver(¡té de la figure
&
du mouvement de l'objet : or entre des rayons
de lumiere diver{ement déterminés,
&
l'objet CflIC
j'appers:ois , par exemple ,
un chevaL noir,
il ya
Ii
peu
de proportion
&
de reífemblance , Cfll'il faut recon–
nOltre une cauCe (upérieure a tous ces mouvemens,
Cflli ayant en (oi la faculté de penfer, produit des
idées de tel ou tel objet ) a la préfence de telles oa
de telles impreffions que les objets cau(ent dans le
cerveau par I'organe des yeux, comme par ce!ui de
I'oreille.
Quelle (era donc eette cau{e? Si c'eíl: un corps
~
on retombe dans les memes difficultés ql1'aupara–
vant; on ne trollvera Cflle des mouvemens
&
des
figures,
&
rien de tout cela n'eíl: la peniee que je
cherche: {era-ce huit, dix ou douze atomes qui com–
poferont cette penfée
&
cette réflexion ? Suppo(ons
que ce {ont dix atomes, je demande ce que f¡lit cha–
cun de ces atomes; eíl:-ce une partie de ma pen(ée ,
ou ne I'eíl:-ce pas
?
(¡ ce n'eíl: pas une partie de ma
penfée) elle n'y contribne en rien ;
Ii
elle en eft une
partie , ce fera la dixieme. Or bien loin que je
con~oi
ve la dixieme partie d'une penfée ) je {ens a11 contrai–
re clairement que ma penfée eíl: indivilible ; foit
que je penfe
a.
tout un cheval, ou que je ne penf< Cjl1'a
Ion ceil, ma pen{ée eíl: toujours une peniée
&
une
aaion de mon ame, de meme nature
&
de meme e[.
pece: foit que je penfe
a
la vaae étendue de l'uni–
vers, 011 que je médite fur un atome d'Epicure &(ur
un point mathéll1atiqlle; foit q!.le je penfc a l'etle.
011
















